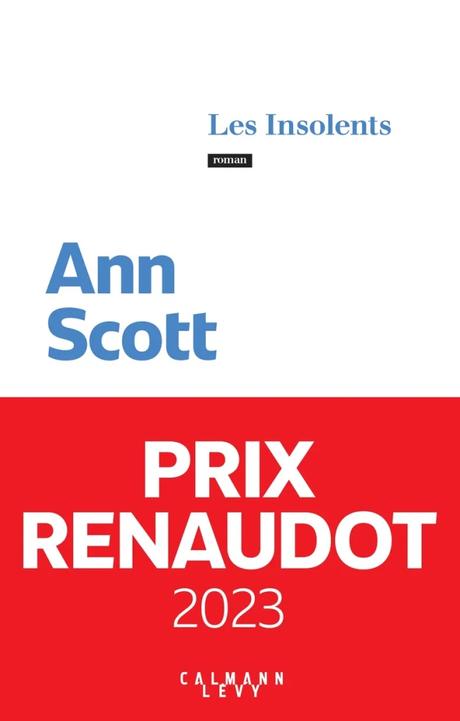
Prix Renaudot 2023
En deux mots
À l’approche de la cinquantaine, Alex décide de quitter Paris et de s’installer dans le Finistère. La compositrice de musique quitte son petit confort mais aussi Margot et Jacques, ses amis les plus proches. On va la suivre durant sa première année.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
«Dans cet autre Finistère»
Ann Scott a amplement mérité son Prix Renaudot avec ce roman d’une rare élégance qui suit l’installation d’une compositrice de musique en Bretagne. À l’approche de la cinquantaine, elle laisse ses proches et sa vie bien rangée pour une vie solitaire, recentrée sur l’essentiel.
Trente ans séparent les deux premiers chapitres de cette histoire. Dans le premier, une jeune fille part à New York s’acheter une guitare qu’elle va se faire voler avec sa valise. Son billet d’avion, resté dans la poche de son jean, va lui permettre de se faire faire des papiers provisoires et de rentrer chez elle.
Dans le second, à l’approche de la cinquantaine, elle repart en voyage. Elle quitte Paris pour aller s’installer dans une maison au bord de l’océan, dans un village du Finistère. Une maison où elle imagine dès son arrivée, qu’elle va se sentir bien. En entendant ses meubles et la visite du propriétaire, elle commence à apprivoiser son nouvel espace, essaie de faire du feu, se promène pieds-nus sur la plage. Mais elle ne peut se départir d’un sentiment de culpabilité à chaque fois que son portable sonne et qu’elle se rend compte qu’elle ne reverra sans doute plus nombre de ses amis et connaissances, à commencer par Jean. « Elle sait que ce qu’elle a fait est impardonnable. Ça n’existe pas de passer de meilleure amie à petite amie au bout de quinze ans. Quand quelqu’un confesse brusquement qu’il est amoureux depuis le début et qu’il a besoin de couper les ponts parce qu’il n’arrive plus à gérer, faut le laisser partir, pas envisager la chose pour le retenir. Même si le mail qu’on reçoit est sublime. Même si personne ne nous avait encore jamais rien dit d’aussi beau, d’aussi habité, d’aussi définitif. »
Puis, pendant trois ans environ, il y a eu Lou. Des mois à se chercher et à se rapprocher et des mois à hésiter, Lou ne voulant pas tromper son amie. Puis la force du désir, l’envie de se toucher, se sentir et se prendre, malgré la peur, malgré ce malaise qui signait pourtant la fin d’une relation avant qu’elle ne commence.
Alex essaie de l’oublier dans ce coin perdu de Bretagne où elle s’installe maintenant que les déménageurs sont passés et qu’elle va pouvoir installer son studio. Mais avant, il y a des dizaines de cartons à vider. « Mais comment les déballer sans qu’une chose ou une autre lui fasse penser à Jean. Ou à Lou. »
Avec le temps, elle va pourtant finir par prendre ses marques, même si, « à ce stade elle ne sait toujours pas si elle est venue ici pour se sentir en sécurité ou se mettre en danger, mais si elle veut danser toute seule au milieu du salon à trois heures du matin sur Losing My Religion à fond, elle peut.
À propos de danger, un homme croisé près de chez elle accapare ses pensées. Et réciproquement. Cabossé par la vie, il se dit que cette femme pourrait bien être celle avec laquelle il pourrait remonter la pente.
Découpé en trois parties, le roman va alors verser dans l’introspection, un peu comme le monde qui découvre avec la covid et le confinement de nouvelles raisons de s’interroger.
Ann Scott réussit à merveille à rendre cette atmosphère particulière, un peu suspendue, qui régnait alors. Et qui bousculera bien des certitudes, remettant en cause des vies trop formatées, trop artificielles. Le choix d’Alex d’aller se ressourcer en Bretagne n’était-il pas prémonitoire? Si elle est loin d’avoir trouvé les réponses qu’elle cherchait, elle a déjà trouvé un chemin pendant que d’autres errent toujours. Un roman à lire avec L’autre Finistère en bande-sonore:
Il est un estuaire
Un long fleuve de soupirs
Où l’eau mêle nos mystères
Et nos belles différences
J’y apprendrai à me taire
Et tes larmes, retenir
Dans cet autre Finistère
Aux longues plages de silence
Les Innocents – L’Autre Finistère (Clip officiel)
Les insolents
Ann Scott
Éditions Calmann-Lévy
Roman
194 p., 18 €
EAN 9782702180761
Paru le 24/08/2023
Où?
Le roman commence à New York avant de s’établir dans un village côtier du Finistère. On y évoque aussi dans voyages dans la Drôme, près de Bayonne ou encore à Berlin et Ischia.
Quand?
L’action se déroule de nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
«À la sortie de la petite gare, en sentant la moiteur dans l’air et en voyant les palmiers sur le parking, elle a eu l’impression de débarquer dans un autre coin que le Finistère, quelque chose d’étrangement chaud, humide, enveloppant, et elle a su qu’elle allait être bien ici.»
Alex, Margot et Jacques sont inséparables. Pourtant, Alex, compositrice de musique de films, a décidé de quitter Paris. À quarante-cinq ans, installée au milieu de nulle part, elle va devoir se réinventer. Qu’importe, elle réalise enfin son rêve de vivre ailleurs et seule.
Après La Grâce et les Ténèbres, Ann Scott livre un roman très intime. Son écriture précise et ses personnages d’une étonnante acuité nous entraînent dans une subtile réflexion sur nos rêves déçus, la solitude et l’absurdité de notre société contemporaine.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
VSD (Catherine Saladin)
Page des libraires (Frédérique Franco, librairie Le Goût des mots à Mortagne-au-Perche)
CulturAdvisor
Blog de Kitty la mouette
Blog de Sophie Songe
Ann Scott présente «Les Insolents» © Production Éditions Calmann-Lévy
Les premières pages du livre
« NYC, hiver 92
La plupart des gens sont seuls, ou se sentent seuls, ou ont peur de l’être. Peut-être est-ce pour ça que certains se comportent de manière vraiment merdique. Mais je ne me demande plus jamais pourquoi les gens font ce qu’ils font. Quand on relie entre elles les choses qu’ils choisissent de nous montrer d’eux-mêmes, on trouve facilement l’origine du problème, mais l’impuissance face à ça est toujours un crève-cœur. Et puis il y a ceux qu’on ne fait que croiser, qu’on ne côtoie pas assez longuement pour les comprendre, comme cette fois-là, au début des années quatre-vingt-dix, alors que je venais d’avoir dix-huit ans et que je m’étais retrouvée dans la foule d’un trottoir bondé, à New York, avec pour tout bagage, avant que les choses tournent mal, un flight case de guitare qui pesait un âne mort et un petit sac en bandoulière. Ma mère m’avait offert ce voyage pour mon anniversaire et, pour me récompenser de ne pas avoir abandonné le piano malgré mon obsession pour la guitare, elle m’avait aussi donné de quoi m’offrir une Gibson vintage que je m’étais empressée d’aller acheter dès la descente de l’avion. Je devais avoir l’air un peu idiote, sur le trottoir, sans manteau en plein mois de janvier, avec des badges du Velvet sur le revers de ma veste en jean et ce flight case trop lourd que je n’en finissais pas de changer de main. J’étais frigorifiée, crevée par les huit heures de vol, sonnée par le flux incessant de passants autour de moi, la cacophonie des embouteillages, la multitude de pubs gigantesques placardées partout. J’étais sur le point de retourner dans le métro quand un type m’avait abordée pour me demander du feu. Si je m’étais contentée de l’ignorer, ce séjour aurait probablement été tout autre. Mais il était d’une beauté saisissante, un genre de tête d’oiseau à la Beckett, émacié avec des cheveux en brosse décolorés et un regard bleu pâle à la fois fiévreux et complètement absent. En remarquant le flight case, il avait dit qu’il était aussi guitariste, qu’il connaissait tout le monde, qu’il pouvait me présenter qui je voulais, et une demi-heure plus tard, j’étais attablée en face de lui dans un café de Chinatown à me brûler la langue avec du thé bouillant. Il s’appelait Ritchie et, tandis qu’il dévorait un beignet qu’il trempait dans sa tasse en léchant la graisse luisante sur ses doigts, j’avais bien vu que ses ongles étaient trop longs pour jouer de la guitare. J’avais aussi remarqué que le vieux Chinois, derrière le comptoir, me jetait des regards appuyés par-dessus son journal comme s’il essayait de me faire comprendre quelque chose. Mais quand on était ressortis de là, à la nuit tombée, je l’avais quand même suivi au lieu de chercher un hôtel. Chez lui, dans un appartement qui consistait en une seule pièce avec un matelas à même le sol et quelques affaires éparpillées, j’avais hésité en le regardant faire chauffer une cuiller et, quand il avait commencé à se déshabiller, j’avais aussi halluciné que ce soit finalement une fille. Mais ces deux choses que j’essayais pour la première fois étaient assez cool pour que je ne trouve rien à redire. Le lendemain, quand j’avais émergé, Ritchie avait disparu, ma guitare aussi, et mon sac avec mon argent, mon passeport et mes quelques vêtements aussi. Ma veste en jean était toujours là mais Ritchie en avait fait les poches et embarqué mes cigarettes et mes chewing-gums. Je n’avais plus que mon billet d’avion, resté plié dans la poche arrière de mon jean que j’avais remis dans la nuit quand j’avais eu froid, et j’avais alors compris que l’appart était un squat et que Ritchie avait dû partir dans un autre sans intention de revenir dans celui-ci. Si j’avais été plus courageuse, j’aurais peut-être erré comme Joe Buck dans Macadam Cowboy ou, qui sait, croisé d’autres junkies ici ou là, et le matelas entre ces quatre murs serait devenu mon point d’ancrage, pour un temps, jusqu’à ce qu’on me retrouve toute bleue avec pour seule identité mes badges du Velvet sur ma veste en jean. Au lieu de ça, j’avais bloqué le bas de la porte pour l’empêcher de se refermer et j’étais partie à la recherche d’un commissariat où faire une déclaration de perte de passeport. J’étais restée calme pendant que le flic m’avait aidée à changer mon vol de retour, puis qu’il m’avait apporté un sandwich et donné de quoi prendre le métro pour me rendre à l’aéroport le lendemain. Mais plus tard, cette nuit-là, recroquevillée sur le matelas dans la pénombre, avec pour seule lumière le reflet orangé d’un lampadaire de la rue qui faisait ressortir les auréoles de la moquette crasseuse, transie de froid sous la couette que Ritchie avait dû laisser sur moi au lieu de l’embarquer aussi pour éviter que je me réveille, j’avais fini par fondre en larmes. Pas seulement parce que je n’avais plus la guitare et que je n’avais même pas eu le temps d’en jouer à part en l’essayant dans le magasin. Pas non plus parce que je ne verrais pas les endroits sur lesquels je fantasmais, sans savoir qu’ils n’existaient plus depuis longtemps, qu’ils avaient été rasés et remplacés par des parkings ou des chaînes de fast-food. Je pleurais parce que j’avais espéré qu’en une semaine, j’aurais le temps de rencontrer d’autres musiciens. Des gens dans le même trip que moi, qui me donneraient envie de revenir souvent ou même de déménager. Tout plutôt que de rester coincée à Paris où je ne croisais jamais personne qui me transporte, qui ait la même énergie, le même enthousiasme, la même incandescence. Personne avec qui monter un groupe ou ne serait-ce que partager ce qui était vital pour moi – la musique, les films, les livres dont je me nourrissais. Paris où ce décalage entre ce que j’étais et ce qui m’entourait me donnait le sentiment de ne pas avoir ma place dans le même monde que les autres sur les trottoirs.
PREMIÈRE PARTIE
L’EXTÉRIEUR
Trois décennies plus tard, c’est d’un train qu’elle vient de descendre, et Paris et tout ce qui allait avec est enfin terminé.
Elle est assise sur la terrasse de la maison, sur la marche d’une des portes-fenêtres, adossée à un volet fermé du salon, du moins de ce qu’elle suppose être le salon si elle a bien compris le plan qu’on lui a envoyé. Elle n’est même pas encore entrée dans cette maison qu’elle vient de louer sans la visiter. En arrivant, elle a seulement fait le tour du jardin qui continue derrière avant de revenir s’asseoir de ce côté et, depuis deux heures, elle contemple ce qu’elle a sous les yeux. L’herbe de la pelouse un peu haute remplie de pâquerettes. Le magnolia à une extrémité de la terrasse avec quelques fleurs blanches qui tiennent encore, tandis que la plupart qui ont déjà fané jonchent l’herbe en dessous. L’érable couleur prune qui se dresse dans le fond avant la haie qui sépare du voisin. Les autres arbres au-delà de la haie, dans les jardins plus loin, certains immenses, encore verts, d’autres déjà flamboyants des couleurs de l’automne. Et les quelques nuages d’un blanc immaculé qui dérivent dans le ciel bleu de cette matinée radieuse de septembre.
À Paris, il faisait encore nuit et il pleuvait quand elle est montée dans le taxi à six heures du matin. À un moment, sur l’île de la Cité, ils se sont fait doubler par quelqu’un à vélo qui fonçait sous la pluie battante avec un poncho noir. Gonflés par le vent, les pans du poncho flottaient sur les côtés et s’étalaient presque à l’horizontale, on aurait dit Batman surgi de nulle part, et elle s’était demandé si les apparitions incongrues de la vie urbaine allaient lui manquer. À l’arrivée aussi il pleuvait, mais pas de la même façon. Quand elle est descendue sur le quai en plein air, hagarde d’avoir dormi pendant tout le trajet, les gouttes qui tombaient étaient éparses, grosses, tièdes, et en même temps le soleil brillait entre les nuages. À la sortie de la petite gare, en sentant la moiteur dans l’air et en voyant les palmiers sur le terre-plein du parking, elle a eu l’impression de débarquer dans un autre coin que le Finistère, différent de ce qu’elle avait imaginé, pas tropical mais presque avec cette averse malgré le soleil, quelque chose d’étrangement chaud, humide, enveloppant, et elle a su qu’elle allait être bien ici.
La clé que le propriétaire lui a laissée dans la boîte aux lettres est posée à côté d’elle sur la marche mais, pour l’instant, elle n’a toujours pas besoin d’entrer. Elle a un abri de jardin sur le côté de la maison, deux poubelles dont une jaune pour elle seule et, derrière, une cuve de fioul qu’elle a fait remplir en appelant de Paris, et un branchement pour le gaz dont elle a fait livrer deux bouteilles. Derrière se trouvent aussi un autre portail – la maison fait l’angle avec deux rues – et un garage qui abrite l’escalier qui mène à l’étage qu’elle ne loue pas. Le propriétaire y entrepose des meubles que ses deux fils ou lui viennent prendre ou déposer de temps en temps. Apparemment ils entrent par le portail à l’arrière sans venir dire bonjour pour ne pas déranger, et ça lui va, elle n’aurait pas su quoi faire de l’étage. Elle n’a pas eu de mal à les convaincre de lui louer la maison sans qu’elle fasse l’aller-retour pour la visiter. Le fils qui a mis l’annonce a compris qu’elle cherchait depuis longtemps et il a simplement demandé qu’elle appelle sur Skype pour voir à qui il avait affaire. Le lendemain, elle a reçu un mail avec des photos et un plan de l’intérieur de la maison, le surlendemain le bail est arrivé par courrier ; un an qu’elle cherchait, et en quarante-huit heures c’était réglé.
Elle ne s’attendait juste pas à ce que ça ressemble à ce point à la campagne, en plus du bord de la mer. En se mettant en Street View sur Google Maps, elle avait surtout regardé l’emplacement de la maison, pas vraiment ce qu’il y avait autour. En dehors des deux rues sur lesquelles elle donne, ou plutôt des deux chemins de terre avec des bas-côtés remplis de touffes d’herbe, il n’y a rien d’autre que des petites départementales bordées de champs, de prés ou de sous-bois. Quant au nombre de maisons le long de ces deux chemins, il ne dépasse pas la dizaine, et elles ont l’air d’être des résidences secondaires, la plupart des volets étaient fermés quand elle est passée devant avec le taxi.
La sienne est une construction banale des années soixante-dix, blanche avec des volets en bois marron et des vasistas dans le toit d’ardoise. Pas une vieille bâtisse en pierre, pas de véranda sous laquelle regarder la pluie tomber, pas non plus de charme dans le jardin, pas de recoins, pas de massifs, rien de plus qu’un grand rectangle de pelouse précédé de dalles en guise de terrasse. Mais elle a enfin sa maison. Un an à regarder tous les jours, à ne voir que des horreurs dans des lotissements, à élargir à toutes les communes voisines, même loin de la côte, et ça y est. Finie la cage à lapins de l’hôtel particulier du Marais qui n’avait d’enviable que l’adresse et la façade. Finies les fêtes constantes des bureaux de presse et des showrooms du rez-de-chaussée qui débordaient dans la cour. Fini le voisin du dessus qui refusait de mettre des tapis pour atténuer les bruits sur son parquet ; celui du dessous qui claquait sa porte chaque fois qu’il rentrait ou sortait ; celui de gauche chez qui des coursiers défilaient en sonnant chez elle ; et finie la connasse à droite qui vivait la nuit avec un caisson de basses. Ne jamais emménager dans un immeuble réputé pour son nombre de créatifs au mètre carré. On se dit qu’on ne risque pas de s’emmerder avec autant de passage ni de rester célibataire longtemps et, trois ans plus tard, au lieu d’être galvanisée d’habiter au cœur de la foutue culture, on se retrouve à fuir vers la campagne pour ne plus jamais avoir de voisins.
Cent mètres carrés. Trois fois plus grand qu’à Paris pour moitié moins cher. Un jardin plein sud, la mer à un kilomètre et quelques avec trois plages dans trois directions, et le silence. Ce silence dont elle se moquait toujours chaque fois qu’elle entendait quelqu’un parler de quitter la ville. Une pièce pour travailler, une autre pour traîner, une autre pour dormir, une autre encore pour recevoir qui voudra. Et ce n’est ni Margot ni Jacques qui ont essayé de la dissuader alors que c’est à eux qu’elle va le plus manquer, mais Anne-Marie, leur vieille copine partie vivre dans le Morbihan il y a des années, qui l’a soutenue mois après mois quand elle se décourageait de ne rien trouver, et qui brusquement s’est mise à essayer de l’accabler à la seconde où elle a enfin signé. Irresponsable de choisir une maison sans l’avoir visitée. Insensé de s’installer dans une région qu’on ne connaît pas sans savoir si on va aimer le climat ou la mentalité. Eau trop froide toute l’année pour se baigner sans combinaison, même l’été. Parcours du combattant, en province, pour trouver un généraliste qui prend encore des nouveaux patients. Et complètement inconscient d’aller vivre dans ce genre de coin sans voiture. Distances trop grandes pour être faisables à pied, et les supermarchés ne livrent pas. Mais Alex s’en fout de tout ça. Il y a une épicerie à un kilomètre, un village un peu plus loin et une ville à trois kilomètres. En voyant les photos du jardin, Anne-Marie a aussi bloqué sur le peu d’ombre qu’apportera l’érable. Ingérable en été tant le soleil tape, pas viable sans parasol, mais trop dangereux d’en avoir un à cause du vent qui peut se lever n’importe quand, à moins de lester le pied avec du sable, mais impossible d’aller prendre du sable sur la plage si pas de voiture, et de toute façon c’est interdit, et quand bien même, vraiment trop dangereux avec le vent qui pourrait s’engouffrer dedans et – et quoi, Anne-Marie, le faire voler au-dessus des jardins voisins jusqu’à la route où l’encastrer dans un pare-brise ? Anne-Marie est juste dégoûtée parce qu’elle est passée d’attachée de presse de Balenciaga à prof de yoga qui vit en jogging et qui crève de solitude, alors qu’Alex va continuer à s’habiller normalement et ne se sentira pas seule. Quant aux gens qui viennent bien moins souvent qu’ils l’ont promis, voire jamais, de ça aussi elle s’en fout. Il n’y aura que Margot et Jacques qu’elle aura envie de voir et ils viendront. Margot qui n’en finit pas d’envoyer des textos depuis ce matin, qui vient encore de faire vibrer le téléphone dans sa poche pour dire Alors ??? Il y en a aussi un de Jacques qui demande qu’elle appelle pour raconter une fois qu’elle se sera posée, un de sa mère qui demande si la maison est aussi bien en vrai qu’en photo, un de son père qui demande si elle ne manque de rien, et aux quatre elle répond enfin : Paradis. »
Extraits
« Elle sait que ce qu’elle a fait est impardonnable. Ça n’existe pas de passer de meilleure amie à petite amie au bout de quinze ans. Quand quelqu’un confesse brusquement qu’il est amoureux depuis le début et qu’il a besoin de couper les ponts parce qu’il n’arrive plus à gérer, faut le laisser partir, pas envisager la chose pour le retenir. Même si le mail qu’on reçoit est sublime. Même si personne ne nous avait encore jamais rien dit d’aussi beau, d’aussi habité, d’aussi définitif. Même si on est fatigué d’alterner passions ineptes et périodes de célibat. Même si la complicité donne le sentiment que jamais on ne s’ennuierait ensemble. Même si on pense que l’affection qu’on a pour la personne est telle que ça compenserait le fait de ne pas être amoureux. S’il n’y a pas de désir, c’est même pas la peine.
p. 24-25
Maintenant il lui reste à s’attaquer à la chambre 2 pour installer le studio. Mais tout d’un coup, pour ça non plus elle n’est plus si pressée. Elle a eu tort de dire aux déménageurs de tout y entasser, la pièce est impraticable maintenant, remplie jusqu’au plafond comme dans une cave. Elle va devoir retransvaser la moitié du contenu dans le couloir avant de pouvoir ouvrir les cartons. Mais surtout, comment les déballer sans qu’une chose ou une autre lui fasse penser à Jean. Ou à Lou. p. 76
Il ne voulait pas qu’on le regarde avec compassion, qu’on lui parle avec précaution. Il ne voulait pas être cette personne qui avait subi ça. Il voulait se réinventer, devenir quelqu’un qu’on ne puisse jamais imaginer en victime. Son moteur intérieur avait changé. Il s’était mis à devenir imprévisible, ironique, cynique, et pour finir complètement nihiliste. Il défiait les gens en permanence, les regardait droit dans yeux quand ils lui parlaient, attendait les remarques ou conseils de chacun pour ensuite détruire leurs croyances. Il leur assenait que la vie n’avait pas de sens réel, pas de logique, pas de rapport de cause à effet, que ça ne servait à rien de tout faire bien, de travailler dur, d’être poli ou gentil, que tout était arbitraire, absurde et gratuit. Plus il rencontrait de gens, plus il attendait qu’ils le déçoivent et ça ne ratait pas. Et avec les filles il était odieux, il ne s’attachait plus à aucune, débarquait juste pour les baiser puis, une fois qu’il avait éjaculé, il devenait indifférent et repartait en se sentant vide, inhabité. p. 128
Avoir un compte sur un réseau social sans être beaucoup liké, c’est comme la cage de l’animal au fond du zoo devant laquelle personne ne s’arrête. C’est la même violence que de jouer devant une salle vide, excepté que ce n’est pas uniquement en tournée, c’est tous les jours à chaque seconde. » p. 163
À propos de l’autrice
 Ann Scott © Photo Philippe Matsas
Ann Scott © Photo Philippe Matsas
Ann Scott est l’auteure, entre autres, de Superstars (2000), Cortex (2017) et La Grâce et les Ténèbres (2020). Les Insolents (2023) est son neuvième roman, couronné du Prix Renaudot. (Source: Éditions Calmann-Lévy)
Site internet de l’autrice
Compte Twitter de l’autrice
Page Facebook de l’autrice
Compte Instagram de l’autrice







Tags
#lesinsolents #AnnScott #editionscalmannlevy #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2023 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #PrixRenaudot #coupdecoeur #MardiConseil #RentreeLitteraire23 #rentreelitteraire #rentree2023 #RL2023 #lecture2023 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie

