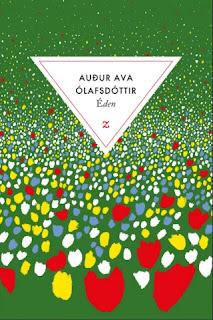
Éden – Auður Ava Ólafsdóttir
Éditions Zulma (2023)
Traduit de l’islandais par Éric Boury
Alba est islandaise, linguiste, professeur à l’université et relectrice-correctrice pour une maison d’édition de romans policiers de Reykjavík. Elle se rend très souvent dans des endroits reculés partout dans le monde pour assister à des colloques consacrés aux langues menacées de disparition et elle prend un jour conscience de l’impact de ses nombreux voyages en avion sur l’environnement. Grâce à son père et à un ami de celui-ci, Hlynur - prénom qui signifie érable en islandais - qui tous deux s’intéressent aux arbres, elle est sensibilisée au reboisement du pays. Elle réalise alors que pour compenser ses seize vols de l’année précédente, elle devrait planter cinq mille six cents arbres. Elle décide alors d’acquérir un terrain de vingt-deux hectares en pleine nature et d’y planter des arbres. La propriété, qui comprend une bâtisse à rénover, a appartenu à une célèbre autrice de romans policiers, Sara Z, dont Alba a relu les épreuves avant parution quelques années auparavant. Au fur et à mesure de son installation sur place, la vie d’Alba va changer du tout au tout.
C’est un livre curieux, que j’ai beaucoup aimé, plus encore que les deux précédents livres d’Auður Ava Ólafsdóttir déjà lus, Rosa Candida et Miss Islande, que j’avais appréciés. Peut-être que celui-ci m’a captivée parce qu’il est question d’une femme qui abandonne progressivement sa vie de citadine pour se créer son propre univers à la campagne et que c'est un sujet qui me parle. Sa reconnexion avec la nature lui ouvre de nouvelles perspectives et semblent la dégager d'un carcan qui la bloquait.
J’ai aussi aimé la façon dont les pensées d’Alba se baladent d’un mot à l’autre, créant des digressions linguistiques et imagées qui font rêver et voyager. Comme dans l’extrait ci-après, qui suit une évocation de sa mère, Stella Bjarkan, une actrice qui a interprété le rôle de Lady Macbeth, et dont le nom de Bjarkan est dérivé de björk, birki – bouleau.
Hier soir, je me suis documentée sur les bouleaux, betula pubescens en latin. L’adjectif pubescens signifie duveteux ou à feuilles pelucheuses, ce qui explique que dans beaucoup d’autres langues, le bouleau se nomme arbre velu, hairy birch en anglais et dunbjørk en norvégien. Il va pour ainsi dire de soi que les Féroïens parlent de birki comme les Islandais. Le terme birki ne trouve d’ailleurs pas son origine dans les langues de notre famille, mais dans le sanskrit bhurja qui signifie l’arbre clair ou lumineux en raison de son écorce d’un blanc crayeux. Lorsque je me plonge dans l’étymologie, je ne vois plus le temps passer et, à une heure avancée de la nuit, je suis tombée sur un document expliquant que le latin betula avait la même racine que le terme celte bete qui donne en irlandais médiéval beithe et, comme la fatigue commençait à se faire sentir, tout cela se mélangeait dans ma tête, betha et beithe, le latin, le gaélique médiéval et le sanskrit, ma mère, la vie, la lumière et le bouleau, la femme qui m’a donné naissance et les rôles qu’elle a endossés. Quand j’ai enfin éteint l’ordinateur pour aller me coucher, j’ai pensé que ce serait plutôt cocasse si Macbeth était en effet Fils de Bouleau, fils de Birki, et si Stella Bjarkan jouant Lady Macbeth devenait par là Lady Birkisson. (Page 41).
De même, son exploration des environs l’entraîne à la fois à l’évocation de la dure vie des éleveurs locaux et à l’analyse de sa langue. L’extrait ci-dessous se poursuit d’ailleurs par la liste des déclinaisons des mots rivière (á ) et brebis (ær).
Remontée en voiture, je pense à une rivière qui déborde, ce qui me conduit droit à landbrot, érosion, puis à vatnavextir, inondation, et aux adjectifs gruggugur et kolmórauður qui décrivent une chose boueuse et sombre, puis je pense à umflotinn, entouré d’eau, et à sjatna qui signifie se retirer en parlant de l’eau, j’attends tranquillement que le liquide s’évacue de mon cerveau de linguiste, je pense au mot innlyksa, coincé, je pense à une route affaissée sur une centaine de mètres, je pense à des coupures d’électricité, à des vaches aux mamelles gonflées, à des fermiers forcés de jeter leur lait parce que le camion n’arrive pas jusqu’à leur ferme, je pense à des poèmes sur les rivières, sur les ruisseaux qui babillent et je pense qu’en secret la rivière ravine, pierre après pierre, galet après galet, sous mes pieds, jusqu’au moment crucial, je pense à Ella Fitzgerald chantant Cry Me A River et voici brusquement que la déclinaison du mot á, rivière, me vient au bout des lèvres – nominatif, accusatif, datif, génitif, singulier et pluriel –, je me dis que les destins de l’eau des glaciers et des brebis sont liés à travers l’une des formes les plus courtes de la langue islandaise, á, et que dans sa déclinaison se cache le temps lui-même, se cache le mot ár qui signifie année. (Page 46).Ce qui m’a plus aussi dans cette histoire, c’est la façon dont l’autrice nous fait découvrir petit à petit la vie passée de son personnage, jamais directement mais toujours par des éléments que fournissent d’autres personnes autour d’elle, comme son père et surtout sa demi-sœur, ou encore son éditrice, comme par exemple l’insistance avec laquelle celle-ci lui demande de lire avant parution le livre de poèmes d’un de ses anciens étudiants. Au début, on ne comprend pas trop où l’autrice nous emmène puis on devine, par des détails apparemment insignifiants laissés ici et là, un épisode passé de la vie d’Alba dont elle-même ne parle pas mais qui justifie sans doute son changement de vie.
Il y a aussi l’ouverture aux autres qui s’installe petit à petit dans l’existence d’Alba. Ainsi, lorsqu’elle côtoie son voisin ou bien les habitants et commerçants du village, elle est toujours surprise de constater qu’ils s’intéressent à elle, que les informations la concernant circulent, mais toujours à bon escient, que ses capacités sont sollicitées dans un but solidaire. Son implication au côté d’un migrant adolescent va donner un nouveau sens à sa vie et à celle de ses proches.
Je prépare des lasagnes pour un adolescent qui a erré de par le monde et qui a appris le mot stinningskaldi – vent glacial – bien qu’il ne lui soit d’aucune utilité pour affronter les bourrasques pendant ses allées et venues. Pas plus qu’il n’a besoin de savoir qu’il existe plus de cent termes pour désigner le vent en fonction de sa direction, de son degré d’humidité, des frimas ou de la douceur qu’il apporte. (Page 86).Vous l’aurez compris, je recommande fortement la lecture d’Éden d’Auður Ava Ólafsdóttir, l’air de rien ce livre est un petit bijou.
N.B. Mention spéciale à Éric Boury, le traducteur de ce texte, pour en avoir si bien fait ressortir les aspects linguistiques.