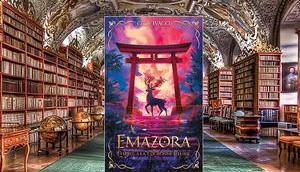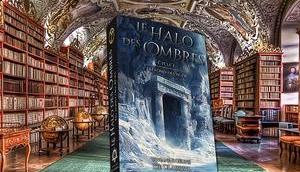En deux mots
Le narrateur, exilé au Canada, revient pour quelques jours en Hongrie, sa terre natale. Un séjour qui va lui permettre de retrouver Petya, son ami d’enfance, avec lequel il va chercher la maison de son père au bord du lac Balaton, quelques membres de sa famille ou encore son premier amour. Avec des émotions contrastées et la nostalgie de l’enfance à jamais perdue.
Ma note
★★★ (bien aimé)
Ma chronique
Le retour en Hongrie
Aujourd’hui Québécois, Akos Verboczy retrace dans ce premier roman, le court séjour de son narrateur dans sa Hongrie natale. L’occasion de retrouver son histoire familiale, des amis ou encore un premier amour. Une Odyssée nostalgique chargée d’émotion.
À la fois autobiographique et poétique, ce premier roman explore les thèmes de l’exil, de la mémoire et de la quête identitaire avec une sensibilité qui touche en plein cœur.
Le narrateur, alter ego de l’auteur, revient à Budapest après trente ans d’absence pour assister aux funérailles de son père et tenter de rassembler son passé, ses souvenirs d’enfance, à son présent d’éxilé, avec des sintements aussi forts que contradictoires : « à mesure que je découvrais le Nouveau Monde, il m’est apparu qu’il ne suffit pas de fouler des territoires inconnus pour en tirer profit ou quelque histoire fabuleuse. Il faut affronter les créatures qui les habitent, apprivoiser faune et flore, prudemment, trouver ses repères sans toujours chercher à regarder en arrière. »
Et pourtant, il va se plonger avec délectation dans ce pèlerinage émotionnel. Chaque rue, chaque immeuble devient un prétexte pour raviver des souvenirs, souvent teintés de nostalgie et de mélancolie. Verboczy excelle dans l’art de faire revivre ces moments, rendant palpable l’atmosphère de la Hongrie d’antan, celle où il arpentait les rues de la capitale et les environs avec Petya et les autres amis de l’école primaire. « Un noyau de six garçons, mais qui au gré du temps, des occasions et du jeu des alliances pouvait doubler. Les Gars de la rue Kárpát, comme on aimait s’appeler avant que les filles se greffent au groupe. Une bande forgée par huit années à partager la vie quotidienne d’une même classe, entre l’âge de six et quatorze ans — certains se connaissaient depuis la garderie. »
C’est d’ailleurs avec Petya qu’il décide de retrouver la maison de son père sur les bords du lac Balaton, symbole de sa relation épisodique avec le défunt. Car c’est dans cette demeure que le père a tenté de restaurer non seulement des murs, mais aussi sa relation fragile avec son fils. Le récit est parsemé d’anecdotes qui, tout en révélant les failles du père, témoignent d’une tendresse sous-jacente.
C’est avec cette même émotion qu’il raconte les retrouvailles avec les quelques membres de sa famille, branches ténues de l’arbre généalogique : « Ses branches basses sont plutôt dégarnies, Ma mère est enfant unique, tout comme trois de mes grands-parents, tandis que le frère du quatrième est mort déporté avant d’avoir eu une descendance. Mon père et mon oncle ne sont plus de ce monde, mais à deux, ils ont engendré cinq enfants et quatre petits-enfants. De la fratrie, seuls mon cousin et ma cousine habitent encore en Hongrie. »
Au fil du récit, on fera aussi la connaissance d’Andréa, la nounou, que le narrateur n’hésite pas à appeler la mère suppléante pour signifier leur relation très forte ou encore de Beáta, la première amoureuse. Sauf que cette fois, la magie ne fonctionne pas.
Akos Verboczy manie la plume avec une justesse de ton remarquable. Il parvient à capturer l’essence des lieux et des émotions sans tomber dans le sentimentalisme. Le style, à la fois léger et profond, permet de naviguer entre les époques et les générations avec aisance. Les descriptions de Budapest, en particulier, sont d’une précision qui ravive les sens, faisant presque sentir l’odeur des pâtisseries locales et entendre le brouhaha des rues animées.
Le roman pose des questions universelles sur l’appartenance et l’identité. Le narrateur, déchiré entre deux cultures, se demande s’il est encore hongrois ou s’il est devenu un étranger dans son propre pays. Une belle et inspirante méditation sur le temps qui passe et sur la complexité de l’identité.
La maison de mon père
Akos Verboczy
Éditions Le Bruit du Monde
Roman
290 p., 21 €
EAN 9782493206954
Paru le 4/01/2024
Où ?
Le roman est situé principalement en Hongrie, à Budapest et dans les environs, au bord du lac Balaton et de celui de Velence, à Vác, à Szentendre. On y évoque aussi l’exil au Canada, à Montréal.
Quand ?
L’action se déroule il y a quelques années.
Ce qu’en dit l’éditeur
« Chaque matin, je remettais au lendemain le projet d’aller à la maison de mon père. Pour la seule fois de ma vie, c’est lui qui m’a attendu en vain. »
Un homme débarque à Budapest, sa ville natale, par un chaud matin d’automne, pour un séjour d’une semaine. Il a l’intention de revoir ses anciens amis, sa famille, son premier amour. De parcourir de bas en haut son arbre généalogique, ou du moins ce qu’il en reste, du petit cousin hooligan aux grands-parents qui dorment paisiblement, l’espère-t-il, sous les pierres moussues du cimetière.
Avec Petya, son compagnon d’enfance, il forme le projet d’aller retrouver la maison que son père a chérie pendant des années, qu’il a longtemps espéré recevoir en héritage, mais qui a sombré avec tout le reste. Cette maison du lac Balaton, ancien pressoir de vignoble, à flanc de colline, où l’on entrait en passant par le grenier. Il faut donc s’empresser de griffonner sur un napperon le plan pour s’y rendre, mais ce geste n’est-il pas aussi dérisoire que de vouloir retracer les contours d’un rêve dont on émerge à peine avant qu’il nous échappe à jamais ?
Les critiques
Babelio
La Presse (Éric Clément)
RTS (Nicolas Julliard)
Journal Ventilo
Blog Les Vapeurs de l’Est
Blog La nuit sera mots
Akos Verboczy présente « La maison de mon père » © Production Éditions Le Bruit du Monde
Les premières pages du livre
« Prologue
FUNÉRAILLES
Les cendres de mon père ont été dispersées à l’aide d’un dispositif rapide et bon marché sur la terre qui l’avait vu naître soixante-trois ans plus tôt. L’urne en métal a été placée dans une sorte de canon qui, actionné à distance, a déclenché une fontaine. Les gouttes d’eau pulvérisées emmêlées aux particules d’os ont formé de grandes arches symétriques avant de se déposer sur la pelouse. Une des Saisons de Vivaldi accompagnait la scène. « L’hiver », si ma mémoire est bonne.
L’opération a pris, au plus, soixante secondes, à peine suffisantes pour que je comprenne le fonctionnement du mécanisme, mais surtout que je comprenne que ce serait tout. Déjà la cérémonie qui avait précédé n’avait duré que quinze minutes, se limitant à un service religieux, inclus dans le forfait « Crémation, hommage, dispersion des restes ».
Rien ne pouvait plus mal résumer ce qu’était mon père que le kitsch d’une fontaine musicale et les bondieuseries d’un prêtre. En même temps, personne n’avait envie de partager des anecdotes touchantes ou cocasses, ni d’écouter une version magyare de My Way.
Le prêtre, assigné par l’entreprise de pompes funèbres, a adopté le ton requis par les circonstances. Il a prononcé des mots comme rédemption, amour, miséricorde. À plusieurs reprises, il a évoqué le défunt comme « notre estimé frère », ce qui aurait bien fait rire le principal intéressé. Personne parmi la vingtaine de convives ne pensait que mon père était « désormais et pour toujours assis auprès de notre Seigneur Jésus-Christ ». Ni sa veuve maintes fois trompée, ni ses amantes déçues, ni ses amis jamais remboursés, ni ses enfants délaissés, ni même sa vieille mère depuis longtemps désillusionnée. Mais personne dans l’assistance ne croyait qu’il eût pour autant mérité les flammes éternelles de l’enfer. Il faut dire que ma mère n’était pas présente.
J’étais arrivé au cimetière de l’avenue de Fiume une demi-heure avant la cérémonie, décalage horaire aidant, le lendemain de mon vol Montréal-Budapest. J’étais au début de la trentaine et cela faisait vingt ans que nous avions quitté la Hongrie pour le Canada, ma mère, ma grande sœur et moi. Alors qu’à Montréal on annonçait une tempête de neige, le début du printemps avait ici des airs d’été. Aux fleurs bourgeonnantes des arbres s’ajoutaient celles, coupées, des seaux en aluminium placés devant l’entrée principale pour rappeler les endeuillés à leur devoir.
Ah oui, faudrait acheter des fleurs, me suis-je dit devant l’étalage.
Dans ce pays, on vend des fleurs un peu partout. Il est coutume d’en offrir en toute occasion, ou non-occasion, selon une étiquette qui m’a toujours semblé trop floue pour que la visite chez le fleuriste m’enchante particulièrement. En fonction de la saison, du contexte et du destinataire, il faut choisir la variété, les couleurs, la taille, l’emballage – papier ou cellophane, monsieur ? – sous le regard d’une vendeuse qui croit que la raison de mes hésitations est budgétaire alors que mon but, comme pour tant de choses au fond inutiles, est de n’en faire ni trop ni trop peu.
« Ah oui, faudrait acheter des fleurs. »
J’ai reconnu derrière moi la voix de ma grande sœur, qui venait d’arriver. Et j’ai reconnu ce ton qui, chez elle, traduit l’envie que les choses se terminent avant même qu’elles aient commencé.
Ma sœur habitait en Hongrie à cette époque et maîtrisait les mœurs locales, mais elle ne s’est révélée d’aucune utilité pour choisir des fleurs. Nous avons tergiversé devant l’échoppe de la fleuriste jusqu’à ce que notre tante arrive à la rescousse avec une proposition, « parce qu’on n’a plus le temps et Klára commence déjà à s’énerver » :
« Prenez un œillet blanc au nom de chaque enfant. »
Nous avons aussitôt acquiescé. Si nous avons une chose en commun dans la famille, c’est bien l’allergie au flafla.
« Et prenez-en trois, bien sûr, a-t-elle ajouté.
– Bien sûr », avons-nous répondu à l’unisson, même si, je l’avoue, je n’avais pas pensé à notre demi-sœur sur le coup.
Son absence était compréhensible, elle vivait aux États-Unis, où elle avait fondé une famille avec un soldat américain rencontré quelques années plus tôt dans un pub de Londres. Elle m’avait raconté ça la dernière fois que nous nous étions vus, quelques années auparavant. Sinon, on ne se parle que rarement. C’est pourtant elle qui m’avait informé, dix jours plus tôt, de la mort de notre père. L’objet du courriel n’annonçait rien de bon : « Papa ».
Ma sœur et moi sommes arrivés juste à temps pour l’oraison funèbre. Elle s’est chargée de déposer les fleurs devant l’urne tandis que je me plaçais à côté de Grand-Mère, qui m’a pris le bras et m’a chuchoté à l’oreille : « Tu es venu, de si loin… »
Il y avait, debout en demi-lune, la petite famille et d’autres visages connus. Klára en noir de la tête aux pieds dans son rôle de veuve officielle. Personne d’autre ne s’était donné cette peine, même que ma sœur portait une drôle de veste colorée. J’ai reconnu Anikó, la mère de ma demi-sœur, et quelques amis de mon père, dont cet éditeur-écrivain rencontré lors de notre dernière promenade, voilà quelques années, et son ami d’enfance devenu un célèbre bluesman, que je voyais en personne pour la première fois. Ils m’ont adressé des signes de tête et des sourires compatissants, avant que je baisse les yeux au moment où le curé entamait le Notre Père.
Tout le long des obsèques, Grand-Mère est restée accrochée à mon bras et n’a pas quitté les trois œillets du regard. Au milieu des quelques couronnes, de la dizaine de bouquets, ils faisaient bonne figure sans prendre toute la place. Un bon choix, ai-je pensé. Je n’ai pas pleuré. Si Grand-Mère a versé des larmes, ce ne fut que discrètement, comme pour tout ce qu’elle a jamais fait. De toute manière, y aurait-il eu assez de larmes dans les yeux de cette mère qui, avec ses quatre-vingt-cinq ans et toute sa tête, assistait ce matin-là aux funérailles de son fils aîné, trente ans après avoir enterré son cadet ? Le moins que je pouvais faire, c’était de lui offrir mon bras pendant qu’elle fixait les trois œillets blancs.
* * *
Le seul souvenir que je garde des funérailles de mon oncle, c’est que je n’avais pas eu le droit d’y aller car, à sept ans, j’étais trop jeune pour ça, alors que mon cousin, qui n’en avait que quatre, pouvait y être parce que c’était son père, ce qui me semblait être une profonde injustice.
De mon oncle, il ne me reste qu’une image floue en contre-plongée. Il est debout dans une cuisine, la cigarette entre les doigts, le cœur à la fête – ce devait être un dîner de Pâques ou de Noël chez Grand-Mère. Ses cheveux noirs recouvrent son front et ses oreilles, il a des sourcils épais et porte une barbe touffue à une époque où personne n’en portait, sauf les clochards et les poètes. Lui faisait partie de cette dernière catégorie, ce qui m’a toujours impressionné. La fierté de voir mon nom sur la couverture d’un livre remonte à loin.
Enfant, je lisais ses contes pour enfants. Adulte, ses poèmes pour adultes. Les premiers ont eu un succès populaire remarquable et les seconds ont fait de mon oncle une figure émergente des cercles littéraires hongrois des années 1970.
Mon intérêt pour son œuvre vient sans doute du fait que ses écrits évoquent souvent notre histoire familiale, avec un mélange de cynisme et de gravité. À commencer par la naissance de mon père, en mars 1945, au milieu d’une forêt, alors que mon grand-père fuyait la guerre avec ma grand-mère enceinte. Un drôle de voyage de noces sur un itinéraire encore pauvre en fosses communes et plaques commémoratives. Le jeu du chat et de la souris avec les soldats amis et ennemis s’est conclu dans une bourgade en Autriche, le ventre et les seins vides. Mon père reçoit alors, à l’âge de deux mois, son premier papier d’identité officiel, celui d’un prisonnier de guerre. Amorce comique à toute biographie, il faut bien l’admettre.
À la fin des hostilités, il s’en est fallu de peu que mes grands-parents ne restent à l’Ouest pour toujours avant de décider, sans trop de conviction, de rentrer en Hongrie. Mon père n’a plus jamais traversé la frontière de son pays.
Les livres pour enfants de mon oncle racontent les aventures anodines d’une petite famille ordinaire. Papa-à-Barbe, l’alter ego de l’auteur, est l’observateur indolent des tribulations de ses deux enfants, Ti-Frisé et Frangine-Taquine, qui ont chacun leur propre mère pour éviter les chicanes les fins de semaine. Grand-Mère est un des personnages récurrents, Mémé-Maniaque, dont la mission permanente consiste en un combat vain contre les germes. Dans ses histoires, on croise d’autres membres de la famille : il y a Maman-Rouquine, Tante-Tannante, Pépé-Empiffreur… Mais moi, jamais ! Ça me peinait à l’époque. Moi aussi, je me trouvais digne d’avoir un double littéraire. Moi aussi, j’aurais aimé apparaître dans une de ses histoires, une fois au moins. Dans le rôle de Cousin-Zinzin, au pire !
Mon père aussi est absent des récits. Cela ne reflète pas une animosité entre frères, mais plutôt la distance qui a toujours existé entre ces deux garçons fort différents – quoique sur leurs vieilles photos ils soient parfois impossibles à distinguer. « Il faut chercher le grain de beauté », disait Grand-Mère en pointant cette marque sur la joue gauche de mon père qui, c’est vrai, le rendait encore plus beau.
Ce que Grand-Mère ne disait pas, c’est qu’en observant les clichés de près, la timidité et la fragilité de mon oncle se révèlent sur le papier glacé, comme si on devinait dans ses traits en noir et blanc l’attention maternelle qu’il a toujours réclamée et reçue, depuis ses maladies infantiles jusqu’à son séjour aux soins palliatifs. À côté de lui, l’aplomb de mon père, le fils aîné dégourdi et charismatique, est manifeste. De son avenir à lui, il ne fallait pas s’inquiéter.
Les deux frères n’auront jamais été très proches, en fin de compte, même s’ils ont laissé tomber l’école, fui le service militaire, se sont mariés, divorcés, remariés, et ont eu leurs enfants au même rythme. Pourtant, à peu de chose près, ils avaient les mêmes centres d’intérêt : la poésie, les filles, la boisson, le tabac, tous les ingrédients essentiels, en somme, à une vie menée à la va-comme-je-te-pousse. Pour mon père, c’était Villon et les classiques hongrois, pour mon oncle, c’était Salinger et Brecht ; pour les filles, mon père lorgnait les bourgeoises juives côté Pest tandis que son frère avait un faible pour les étudiantes de Buda qui sortaient de la faculté des lettres ; mon père buvait de la pálinka, mon oncle, de la bière ; c’était la pipe ou le cigare pour le premier, les Fecske, cigarettes sans filtre, pour le second. Chacun sa posture, chacun son rapport au monde et aux choses.
Mon père aurait pourtant pu inspirer un personnage fort comique dans les histoires pour enfants de son frère. En Tonton-Moustache qui arrive toujours trop tard et repart toujours trop tôt, car des missions mystérieuses l’ont retenu et l’attendent, mais qui, pendant son court passage, prend toute la place et finit debout sur la table de la cuisine à déclamer une vieille ballade d’un vieux poète, à la joie de tous, sauf de Mémé-Maniaque, évidemment, à qui revient la tâche de nettoyer la boue qui tombe de ses gros sabots.
Ma mère se souvient de la dernière fois qu’elle a vu mon oncle. Quelques semaines avant sa mort, il est passé nous voir à notre appartement du Körút, en chemin vers sa maison d’édition. Probablement dans l’idée de nous faire ses adieux, mais ma grande sœur et moi étions absents. En ouvrant la porte, ma mère n’a pas reconnu son ex-beau-frère. Le cancer avait dévasté son corps, et le traitement avait dégarni son crâne, ses joues et ses arcades sourcilières. Heureusement, il portait au cou, enfilé sur une cordelette, son bracelet de naissance avec son nom bien visible, tel qu’il y avait été inscrit, trente-trois ans plus tôt, à la maternité de l’hôpital Szent-János. « C’est mon dog tag », expliquait-il, le visage pâle et souriant, en référence à ces plaquettes de métal qui identifient les soldats tombés au champ de bataille.
Ma mère a déniché dans le vestibule mon vieux manteau d’hiver. « Il est rendu trop petit pour mon fils, mais devrait faire au tien, pour au moins deux saisons. » Mon oncle a refusé en s’excusant. Ses muscles atrophiés supportaient à peine le poids de ses propres vêtements. « Ça vient d’Allemagne de l’Ouest », insistait ma mère, sans le convaincre, et mon oncle est parti chez son éditeur porter ses derniers poèmes, qui eux, apparemment, ne pesaient rien.
Un des textes fourrés dans sa poche de jean cet après-midi-là a été publié après sa mort. Ça s’adresse à son fils, je crois.
dans le ravin
de mes cernes
tu trouveras mon dog tag
contrôle mon identité
assure-toi de l’exactitude des données
quand tu allumeras le projecteur
pour interroger les souvenirs
tu seras rassuré
à toi l’avenir
moi j’ai déjà vu la mort
je suis poupon tétant le téton
qui s’est cassé du Taygète
J’ai dû vérifier sur Wikipédia : « Le Taygète est une chaîne de montagnes grecque située dans le Péloponnèse. » C’est de ses hauteurs que, selon un mythe, les enfants mal formés ou trop faibles étaient poussés dans le précipice. Finalement, ils n’étaient pas si légers, ses poèmes.
Dans un de ses textes inédits, mon oncle avait proposé une épitaphe :
Ici, il me reste plus de temps
pour atteindre l’immortalité.
Elle n’a pas été retenue. Dans la famille, on a toujours opposé une limite aux caprices des enfants et on s’est contenté de graver dans la pierre son nom et ses dates de naissance et de mort avec, tout de même, l’ajout de ce mot qui résumait son être et rendait ses proches fiers : Poète.
Pour mon père, il n’y aurait pas de pierre tombale. Nul endroit pour inscrire un mot d’esprit ou son métier – photographe publicitaire ? vigile de centre commercial ? –, nul endroit pour graver son nom avec ses années de naissance et de mort, nul endroit pour se recueillir. De mon père, il ne resterait même pas une poignée de cendres qu’aurait dispersées un jour, dans un endroit où il aurait été heureux, quelqu’un qui l’aurait aimé malgré tout.
Chapitre 1
RETOUR
Quand j’étais enfant et que j’allais passer la nuit dans un endroit nouveau (chez un copain, en colonie de vacances, au chalet d’été de la coopérative des coiffeuses et esthéticiennes du XIIIe arrondissement, ou la fois où nous avons dormi à l’hôtel en Allemagne de l’Ouest), ma mère me disait toujours de compter les coins au plafond avant de m’endormir. Pour que je fasse de beaux rêves. Paroles rassurantes pour rappeler que, même quand on est loin de chez soi, il y a des choses qui ne changent pas. J’ai gardé cette habitude, peu importe l’endroit où je me couche, même si mon sommeil est facile et que mes nuits sont rarement agitées de cauchemars. Et ça m’amuse encore quand le total dépasse quatre.
Au plafond de la chambre louée pour mon séjour en Hongrie, le premier depuis les funérailles de mon père, voilà douze ans, il y a très exactement quatre coins. L’ancien appartement de luxe, transformé en hébergement touristique, a été subdivisé par des cloisons orthogonales, gagnant en rentabilité ce qu’il a perdu en élégance. On m’a accordé la plus grande chambre, avec le balcon, souligne la jeune réceptionniste, puisque je resterai plus qu’un week-end, « ce qui est plutôt rare ». Elle me remercie de l’avoir prévenue de l’heure tardive de mon arrivée avant de m’expliquer, longuement, le règlement de la maison.
Un nom archihongrois sur un passeport canadien l’a intriguée et je sens que si elle prolonge la conversation, ce n’est pas seulement par ennui ou par professionnalisme, mais par curiosité. Un client qui reste dans l’établissement dix jours, c’est rare, et un client qui parle hongrois, encore plus.
« Tu remarques un accent ? lui ai-je demandé, espérant une réponse négative.
– C’est davantage ta façon de parler », m’a-t-elle avoué, notant que plus tôt j’ai dit rezervácio, mot qu’elle a compris, mais qui, en hongrois, n’existe pas.
Durant les premiers jours dans mon pays natal, ma parole est hésitante, les mots restent suspendus au bout de ma langue, le temps que le français rende provisoirement sa place au hongrois, qu’il lui a ravie jadis. Quelques heures de conversation suffisent pour que la fluidité de ma langue maternelle revienne, mais là il est minuit, je viens de traverser l’Atlantique et, aussi sympathique que soit cette réceptionniste, je dois dormir – après avoir compté les quatre coins du plafond.
L’appartement est au deuxième des cinq étages de l’immeuble et il donne directement sur l’artère principale de Budapest : le Körút. Après avoir écarté les rideaux, remonté les stores, ouvert les portes-fenêtres, je sors sur le balcon qui surmonte l’entrée de l’édifice. L’intense agitation du boulevard me happe. La circulation automobile, le passage incessant des tramways et les trottoirs envahis de piétons ont un effet hypnotisant et je reste là, debout sous le soleil matinal, pendant de longues minutes.
Le balcon de pierre est sculpté à même la façade particulièrement travaillée. Le style art nouveau, à la sauce viennoise, avec ses frises, médaillons et guirlandes, témoigne de l’âge d’or que fut la Belle Époque pour cette ville, alors confiante et insouciante, se croyant à jamais au cœur de la civilisation européenne. C’est un peu comme ça que je me sens ce matin. Cela me prend un moment avant de remarquer les deux imposantes statues de Titans qui me flanquent et qui portent l’étage supérieur sur leurs épaules. Comparé à eux, comparé à la faune urbaine qui se presse sous mes yeux, comparé à quiconque peut-être en ce lundi matin, je me sens léger : je suis en vacances. En vacances chez moi.
Je ne suis peut-être pas chez moi à proprement dit, mais très certainement en terrain connu. Un peu plus bas, vers le pont Marguerite, je vois l’immeuble où j’ai grandi et, plus loin, le parc Jászai, le terrain de jeux de mon enfance. Je reconnais notre épicerie, l’échoppe du fleuriste sur le trottoir, aujourd’hui spécialisé en bonsaïs, alors que les boulangeries, cafés, coiffeurs et autres boutiques et restaurants ont eu le temps de changer maintes fois de vocation.
Je fais directement face au Théâtre de la Gaieté avec sa coupole néobaroque, sa façade jaune, ses colonnes corinthiennes, son escalier élégant – le tout fraîchement rénové. Dans le temps, ma mère y a été maquilleuse surnuméraire, seul contrat qui lui restait dans le milieu du spectacle qu’elle avait dû délaisser, à contrecœur, après son divorce. Les horaires des représentations et des tournages ne convenaient pas à une femme qui élève seule deux jeunes enfants. Je l’accompagnais de temps en temps en coulisses lorsqu’elle était appelée d’urgence et n’avait pas eu le temps de prévenir Mamie ou ma gardienne. J’aimais beaucoup la regarder poser des perruques et de fausses barbes, appliquer des maquillages flamboyants, papoter avec des vedettes que j’avais parfois déjà vues à la télé. Mais je préférais quand elle travaillait de l’autre côté du boulevard, dans une des rares discothèques de la ville dans les années 1980. Tous les samedis soir, à neuf heures trente, la piste de danse faisait place à un spectacle de lip-sync donné par des sosies de Boy George, Michael Jackson, Cyndi Lauper et la drag queen Divine, mon numéro préféré. Eux, on ne les voyait jamais à la télévision, ni nulle part ailleurs dans le bloc de l’Est, sauf donc – le mot s’était donné – dans le sous-sol de cette discothèque, une fois par semaine, grâce aux maquillages et aux perruques créés par ma mère. Elle s’acquittait de son boulot d’esthéticienne plus haut sur le boulevard, près de la place Karl-Marx, dans un salon de beauté où je passais mes jours de congé, mais où l’épilation des jambes à la cire chaude me captivait quand même moins que le spectacle d’une boîte de nuit. Cela dit, je n’avais pas à me plaindre. (J’ai eu une enfance heureuse.)
La ville semble plus propre que jamais. La grisaille qui se déposait jadis sur les murs et les esprits s’est dissipée, on dirait. La cime des arbres est plus haute, la population s’est embourgeoisée, il y a davantage de touristes, de clochards aussi, faut dire, mais l’aspect général des lieux, l’ambiance, l’énergie du Körút semblent être sauvegardés malgré les guerres, les révolutions, les changements de régime et de gouvernement, malgré mon émigration. Quelqu’un qui, avant de prendre son café, serait sorti sur ce balcon cinquante ou cent vingt-cinq ans plus tôt, après avoir écarté les rideaux, remonté les stores, ouvert les portes-fenêtres, aurait été happé par une vue et une énergie semblables à celles qui se présentent à moi ce matin.
* * *
La sonnerie de mon téléphone interrompt ma contemplation matinale. C’est Petya, qui me dit d’emblée :
« Je suis en bas, dans la fourgonnette blanche.
– Lève la tête ! lui dis-je. Tu vois les géants au balcon, au-dessus du portail ?
– Tu es celui du milieu, non ? » rétorque-t-il en me faisant un signe de la main.
Petya, mon meilleur ami d’enfance. Je suis heureux qu’ils soient, lui et son ironie, comme prévu, au rendez-vous.
Mes premières amitiés, je les dois à ma mère, qui trouvait bien pratique, bien mignon de voir sa progéniture socialiser avec les enfants de son entourage. Ces derniers, pour la plupart, je les ai perdus de vue assez vite, oubliés même. Les amitiés suivantes ont été déterminées par les lieux que je fréquentais, comme pour tout le monde. L’école bien sûr, puis les clubs de sport, les camps de vacances, les fêtes, le boulot.
Je serais incapable de relater l’événement précis qui aurait officialisé notre lien, à Petya et à moi. Au mieux, j’ai le vague souvenir d’un moment, quelque part au milieu de la deuxième année, où j’ai acquis la ferme conviction – au détour d’une blague qu’on trouvait tous les deux drôle, ou de l’intervention de l’un de nous en faveur de l’autre, ou durant une de nos aventures entre les tours de la rue Kárpát – que Petya resterait mon ami à jamais.
Pas plus que je n’ai de souvenir net d’une anecdote originelle, je ne saurais nommer les passions, intérêts ou ennemis communs qui auraient noué cette amitié. Certes, on aimait tous les deux les ordinateurs (il en avait un), les parties de foot l’après-midi, le cinéma, la kermesse annuelle des pionniers, l’illusion de faire les quatre cents coups après l’école, mais, au fond, c’était pareil avec tous nos copains. Notre intérêt commun, si on peut le considérer comme tel, était de survivre au rythme imposé par une vie scolaire plutôt stricte, mais là encore, nous n’étions pas différents des autres élèves. Des ennemis communs, nous n’en avions pas vraiment, à part peut-être M. Bodrogi, le prof de gym qui nous tapait sur le crâne avec son trousseau de clés, ou cet abruti de Faragó, qui nous tapait sur les nerfs. Bête et méchant, il m’avait déjà dénoncé à la directrice pour une balle de ping-pong piquée dans la remise du gymnase, frustré d’un de mes smashs reçus dans les couilles.
Celui-ci n’en valait certainement pas la peine. Il m’avait cherché depuis le jour un de la première année jusqu’au dernier de la cinquième, quand j’ai annoncé mon départ pour l’Amérique. Comme un coureur médiocre qui dépasse un concurrent blessé, il avait déclaré triomphalement, devant tout le monde, de sa voix nasillarde, être ravi que la classe et le pays soient bientôt débarrassés de moi pour toujours, et que ce n’était certainement pas trop tôt. Et quand il a appris que mon émigration n’était rendue possible que grâce au mariage de ma mère avec un citoyen canadien, il l’a traitée de pute. C’est un des rares coups de poing que je regrette de ne pas avoir donnés dans ma vie. Il faut dire que de coup de poing, je n’en ai jamais donné ni reçu. (Tout compte fait, j’ai eu une vie facile.)
Petya ne m’a jamais tapé sur les nerfs, nous ne nous sommes jamais dit de vacheries, nous avons toujours embarqué volontiers dans les plans foireux de l’autre sans jamais le regretter. Il n’y a jamais eu non plus entre nous cet esprit compétitif qui rend les relations lassantes. À bien y penser, si nous sommes devenus des amis, et que nous le sommes restés, c’est pour ce simple plaisir partagé que nous avons toujours eu d’être ensemble et de nous retrouver malgré le temps qui fuit. Elle a le défaut d’être banale, mais c’est la plus juste explication de cette amitié durable.
Petya gesticule depuis le trottoir. Il m’indique de le rejoindre sur une terrasse de l’autre côté du Körút. « Café Kino, ça s’appelle », crie-t-il à travers le tohu-bohu du boulevard.
Il s’est installé à l’extérieur, sous l’auvent, et m’a attendu avant de commander. J’ai à peine le temps de m’asseoir que le serveur me tend un menu énumérant une dizaine de choix de cafés aux noms italiens.
« Celui qui équivaut à un café au lait », dis-je, blagueur, et le garçon m’informe qu’il m’apportera un latte.
Petya commande un chocolat chaud.
« Tu ne bois toujours pas de café ?
– Pas depuis la fin de l’école primaire. »
Je le regarde, interrogateur.
« Tu te souviens, on nous servait chaque matin du café au lait à l’école ? Du lait au café, ce serait plus exact. »
Nos phrases débutent souvent par ces mots – tu te souviens ? – et la plupart du temps la réponse est oui, mais là, j’hésite.
« Ça me dit vaguement quelque chose. Peut-être parce que je choisissais la boisson au caramel.
– Je détestais ça », me dit-il en grimaçant.
Le serveur revient avec notre commande et dépose à côté de nos tasses un tract annonçant la programmation de la semaine au cinéma jouxtant le café.
« Il y a une salle de projection à l’intérieur ? je demande.
– Il y en avait une dans notre temps aussi : le Cinéma des Conseils, ça s’appelait. En l’honneur de la glorieuse révolution bolchevique de 1919 », m’informe Petya, fier de son érudition, reprenant une de ces formules pompeuses qu’on nous balançait année après année lors des célébrations nationales.
Mais cette salle de cinéma ne me dit rien.
« Nous ne venions jamais ici, n’est-ce pas ?
– Bien sûr que non, à ce jour on ne joue ici que des films d’auteur hongrois.
– Ça explique que je ne m’en souviens pas.
– Nous, on allait au Duna, un peu plus loin, rue Hollán.
– Ça, crois-tu vraiment que je pourrais l’oublier ? lui dis-je d’un air faussement vexé. On y a vu tous les films de l’Ouest, les Bud Spencer, les Belmondo, les films américains.
– C’est là qu’on a vu La Guerre des étoiles, tu te souviens ?
– Je me souviens que nous sommes restés cachés dans la salle sous les sièges pour le voir une seconde fois.
– J’avais oublié que c’était pour Star Wars.
– Tu y vas encore ?
– Au Duna ? Il a malheureusement fermé, mais je n’ai jamais cessé d’aller au cinéma. Avec mon ex-femme, je venais même voir des films d’auteurs hongrois ici. Ça ne l’a pas empêchée de me quitter. Mais je vais surtout dans les complexes multisalles voir les suites de Star Wars en bouffant du pop-corn. C’est l’avantage d’avoir des enfants.
– De ça, j’ai pas mal décroché.
– Des enfants ?
– Ça, c’est une question plus compliquée. Je parlais de ces sagas interminables de science-fiction.
– Tu te souviens de la figurine de Yoda que tu m’as offerte avant ton départ pour le Canada ? »
De cela, on se souvient tous les deux.
* * *
La figurine du vénérable personnage de La Guerre des étoiles, offerte à Petya avant mon départ, était une de mes possessions les plus précieuses. On ne trouvait pas ces jouets facilement de notre côté du rideau de fer, et même quand on en voyait dans une vitrine, l’acheter relevait d’un luxe qu’on ne m’accordait jamais – à Petya, qui était quand même fils d’ingénieur, un peu plus souvent. J’ai reçu mon Yoda en cadeau dans un de ces colis envoyés par l’amie ouest-allemande de ma mère deux fois l’an, à Noël et à Pâques, après son ménage du printemps. La boîte était remplie des anciens jouets et vêtements de son fils, d’habits neufs pour ma sœur, ainsi que de Nescafé et de vieux magazines de couture Burda pour ma mère, et quand on était particulièrement chanceux, de pots de Nutella. Petya possédait déjà plusieurs de ces figurines, au point où il pouvait prétendre être un collectionneur, ambition que nous ne partagions pas. Je n’étais pas surpris qu’une addition aussi prestigieuse à sa collection fasse son bonheur, même s’il manquait à Yoda la moitié de son sabre laser. Il m’a tout de suite rassuré : « Mon père lui en fabriquera un neuf. »
Ma mère exhibait une fierté inédite les mois précédant notre départ, convaincue – à raison, je crois – que notre émigration était perçue comme une réussite en soi. Pour une fois, c’est elle que tout le monde jalousait et non l’inverse. Et au diable les mauvaises langues ! Même à la caissière de l’épicerie, elle a fini par annoncer la nouvelle : « Je me suis mariée, je pars en Amérique avec mes enfants. »
Presque tous les jours, nous recevions des amis à la maison, invités à faire leurs adieux, laissant soir après soir nos armoires et nos bibliothèques de plus en plus vides. Elle était heureuse de pouvoir faire table rase du passé. Ma sœur et moi devions l’imiter.
Nous avons reçu la consigne de n’apporter au Canada que le strict minimum, car dans ce pays, « il y a absolument tout ». Nous n’avions le droit d’emporter que nos vêtements et nos livres préférés. Je n’ai pas réussi à négocier avec ma mère l’empaquetage de mon extraordinaire collection de trains électriques (que nous avons plutôt rendue à son précédent propriétaire, tout comme mon vélo), ni mon ballon de foot en cuir véritable (que j’ai laissé au voisin), ni ma boîte à chaussures remplie de voiturettes Matchbox qui, pourtant, essayais-je de raisonner ma mère, venaient d’Allemagne de l’Ouest. J’ai réussi à dissimuler dans nos valises quelques petits jouets et autres trésors d’enfant – comme cette paire de raquettes de tennis en plastique, un cadeau de mon père. Mon Yoda dans sa tunique blanche, haut de douze centimètres, avec sa moitié de sabre laser, aurait pu se glisser dans la cargaison sans attirer l’attention, ce qui laisse penser que mon cadeau d’adieu impliquait un certain sacrifice de ma part, et conséquemment, on pourrait qualifier mon geste de généreux, à la mesure de l’événement et de notre amitié.
De son côté, Petya m’a offert comme cadeau d’adieu une lettre. Une lettre qu’il avait pliée en forme d’animal. Une tête d’animal, mais je ne me rappelle pas lequel. Il avait attendu un moment après l’école, à l’écart de témoins, pour me la remettre cérémonieusement. « Parce que tu t’en vas pour toujours », m’a-t-il dit avec une gêne que je ne lui connaissais pas. Sur sa proposition, nous avons déchiré l’origami en deux. C’est un truc qu’on avait vu dans une série télé tchécoslovaque. « Chacun devra garder sa moitié, a-t-il expliqué, et nous pourrons ainsi – dans le futur, quand nous serons vieux – nous assurer de l’identité de l’autre, du moment que les deux parties s’emboîtent. »
Petya m’avait aussi offert un livre sur les grands explorateurs, un peu ennuyeux, acheté par sa mère, que j’ai eu le droit d’emporter avec moi. Il l’avait dédicacé tout simplement « avec amitié », d’une écriture scolaire des plus soignées. Ça s’appelait Le Livre des découvertes. Je l’ai encore.
Je ne m’identifiais pas trop à ces aventuriers qui arpentent des contrées lointaines sur les cinq continents à la recherche de l’inconnu. Moi, je me satisfaisais amplement du monde connu, à tout le moins du rythme lent et naturel avec lequel les nouveautés se présentaient à moi. Au mieux, je voulais aller en Amérique pour profiter de ses richesses, pour cette promesse d’y trouver « tout » : ordinateurs, Walkman, voitures de sport, gratte-ciel, jouets électroniques, Nesquik, hamburgers. Et encore là, ce n’était pas tellement de jouir de tout cela dont j’avais si hâte que de m’en vanter auprès des copains restés derrière.
Contrairement au Livre des découvertes, cette moitié de lettre pliée en origami, je ne l’ai plus depuis longtemps. Elle a été jetée à la poubelle à mon insu quelques jours après mon arrivée au Canada par le nouveau mari de ma mère. « Ça t’apprendra à laisser traîner tes affaires », m’a-t-il dit avant de se moquer des larmes d’un garçon de onze ans versées pour un morceau de papier déchiré. J’ai su dès lors que ma mère allait, pour une seconde fois, rater son mariage, mais l’incident m’a surtout appris qu’il y a des choses qui ne se remplacent pas.
Durant les années suivantes, à mesure que je découvrais le Nouveau Monde, il m’est apparu qu’il ne suffit pas de fouler des territoires inconnus pour en tirer profit ou quelque histoire fabuleuse. Il faut affronter les créatures qui les habitent, apprivoiser faune et flore, prudemment, trouver ses repères sans toujours chercher à regarder en arrière.
Cela dit, un talisman n’aurait peut-être pas été superflu.
* * *
« Cette lettre déchirée en deux, ça ne me dit rien, mais le Yoda, je l’ai encore quelque part. J’ai donné le reste de la collection à mes filles. T’imagines comme elles étaient impressionnées, en plus ça vaut une fortune aujourd’hui ! »
Le téléphone de Petya, posé sur la table, vibre et sonne simultanément. Il jette un coup d’œil sur son appareil et m’informe, avec une lassitude subite, qu’il est neuf heures moins dix et que les commandes commencent à arriver.
« Ça rappelle la cloche du matin qui annonce le début des cours. »
Petya ignore ma métaphore. Des yeux, il cherche le serveur et soudain, un peu nerveusement, comme s’il venait de réaliser qu’après quasiment une heure de conversation, il n’avait pas posé de question digne d’intérêt, il opte pour la plus fondamentale :
« En fait, dis-moi, en quel honneur es-tu de retour à la maison ? »
Je balaie le Körút du regard, encore plus animé qu’à mon réveil, puis j’examine le fond de ma tasse vide.
« Je te laisse du temps pour y penser », dit Petya en se levant, et il entre dans le café pour régler l’addition, avant que je puisse protester.
Les mots employés me désarçonnent autant que le fond de la question. Elle est curieuse, cette manière de dire « à la maison » pour signifier « dans son pays natal », et je me demande si l’expression s’applique à mes retours en Hongrie. Mais si la question me surprend, c’est surtout parce que – parti de Montréal sur un coup de tête – je ne me l’étais pas encore posée.
Exceptionnellement, j’ai obtenu deux semaines de congé durant l’automne et j’ai eu l’idée de consulter les promotions de basse saison sur un site de voyages en ligne. J’avais depuis des mois les mots évasion, liberté, changement d’air à la bouche. Comme je suis récemment séparé, le choix de la destination me revenait entièrement, ce qui était plus déboussolant qu’autre chose. Avec Marianne, nous en aurions discuté des semaines, serions allés à la librairie Ulysse rue Saint-Denis, j’aurais dit : « L’Islande, il faudrait vraiment y aller un jour », elle m’aurait répondu : « Oui, et retourner en Asie du Sud-Est, tu en penses quoi ? Ou la Biennale de Venise, toi qui aimes te prendre pour un artiste ? Et si on faisait juste louer un chalet avec jacuzzi dans les Laurentides ? » J’avais l’idée d’aller dans un tout-inclus des Caraïbes pour une fois, lire sous un cocotier ces livres qui s’accumulent sur ma table de chevet ; ou d’aller me la jouer à Paris, manger une entrecôte dans Saint-Germain avec un vieux copain ; ou, pourquoi pas, découvrir une ville pas trop loin, Chicago peut-être ; ou encore faire cette randonnée en bivouac dans les Alpes suisses qu’on m’avait vantée récemment dans une soirée entre amis. J’aurais pu aussi me forcer et aller à Toronto voir ma mère et ma sœur, jouer au Tonton-Marrant avec ma nièce.
L’aller-retour Montréal-Budapest est apparu « en vedette » à l’écran, probablement parce que les algorithmes, comme tout mon entourage, connaissent mes origines. Savaient-ils que je n’y étais pas allé depuis douze ans, depuis les funérailles de mon père ? Le billet était des plus abordables, tout comme cette chambre avec balcon donnant sur le Körút. Après vingt-cinq minutes, j’ai reçu la confirmation d’achat et de réservation. À moi la planète, et voilà que je rentre au bercail ! Il me restait quelques affaires à régler avant le départ, quarante-huit heures plus tard : acheter une petite valise, demander à ma voisine d’arroser mes plantes en mon absence, écrire des courriels pour annoncer mon arrivée en Hongrie, boucler mes bagages. Et aussi faire le ménage pour trouver un appartement accueillant à mon retour à la maison dix jours plus tard. Me poser des questions existentielles sur les raisons, profondes et superficielles, conscientes et inconscientes, qui m’attiraient vers mon pays natal, trente ans après mon émigration, ne figurait pas sur la liste de mes tâches.
Au retour de Petya, je tente cette réponse, sans conviction :
« Pour voir si j’y suis encore. »
Je réalise que ce sont exactement les mots de ma mère quand elle veut justifier un énième retour en Hongrie.
Les yeux et les pouces sur son téléphone, en train d’organiser ses rendez-vous de la journée, Petya lève la tête, cherchant la question qu’il m’a posée deux minutes plus tôt. Après un moment, il me lance :
« Si tu n’as pas mieux à faire, monte dans le camion, je pourrais me prévaloir d’un copilote de ta trempe. »
Je n’ai rien de mieux à faire. Un tour de ma ville natale ?
Si ça se trouve, j’y suis encore.
Chapitre 2
LES GARS DE LA RUE KÁRPÁT
En observant Petya conduire, je me souviens à quel point, plus que le cinéma, il aimait jadis les voitures. Il pouvait décrire dans le détail les caractéristiques techniques des modèles de fabrication soviétique, tchécoslovaque, est-allemande et roumaine. Il en savait presque autant sur ceux venus de l’Ouest, surgissant parfois dans la rue Kárpát, mais qu’on voyait surtout à l’écran dans des films italiens, français, ouest-allemands ou américains.
Son père lui a appris à conduire dès que ses pieds ont pu toucher les pédales de son Trabant 601. À quatorze ans, au lac de Velence, on faisait le tour du village à bord d’une Lada VAZ-2104. Et pendant l’été de nos dix-huit ans, c’est dans une Renault Fuego Turbo, prêtée par une marraine insouciante, que nous avons roulé jusqu’en Allemagne pour visiter les musées de Porsche et de Mercedes-Benz, ses marques préférées. À ce moment-là, mon intérêt pour les autos était déjà, et à jamais, remisé, tout comme ma collection de Matchbox. Mais l’idée impromptue de traverser la moitié de l’Europe avec Petya suffisait pour que je monte sans hésiter dans la Fuego, côté passager. L’important, ce n’est pas la destination, c’est le voyage, ça, je le savais déjà. Mais plus encore, avais-je l’intuition, l’important, par-dessus tout, est le compagnon de route.
« Ce sera comme dans L’Aventure, c’est l’aventure », m’avait-il promis dans son français qui ne lui sert encore aujourd’hui qu’à citer des titres de film.
Les faits saillants de notre périple Budapest-Stuttgart n’avaient eu que peu à voir avec les tribulations mafieuses de Lino Ventura et de ses acolytes. Mais nous étions, comme eux, animés par cette liberté originelle qui accompagne toute aventure réussie entre copains. Les nuits d’orage sous une tente de fortune, un record de vitesse de cent soixante kilomètres-heure sur l’Autobahn, la tentative ratée d’aborder deux Autrichiennes dans une piscine à vagues, la fois où nous étions certains d’avoir croisé le chanteur des Scorpions dans les toilettes d’un Shell et, pour conclure notre périple de deux mille kilomètres en six jours, un léger accrochage en garant la Fuego dans la rue Kárpát sous les yeux de la marraine de Petya constituaient un matériel insuffisant pour Hollywood, tout juste bon pour la Berlinale, mais inépuisable pour nous faire encore rigoler des décennies plus tard.
Extraits
« A chaque pèlerin ses raisons. Celles qui me poussent à revisiter les lieux de ma jeunesse, je me les explique déjà mal, alors celles qui m’entraînent sur les pas de mon père me sont encore plus mystérieuses. Et question encore plus déroutante: faut-il avoir la foi pour entreprendre un pèlerinage? »
« Durant les années suivantes, À mesure que je découvrais le Nouveau Monde, il m’est apparu qu’il ne suffit pas de fouler des territoires inconnus pour en tirer profit ou quelque histoire fabuleuse. Il faut affronter les créatures qui les habitent, apprivoiser faune et flore, prudemment, trouver ses repères sans toujours chercher à regarder en arrière. » p. 32
« Les Gars, c’étaient les amis de l’école primaire. Un noyau de six garçons, mais qui au gré du temps, des occasions et du jeu des alliances pouvait doubler. Les Gars de la rue Kárpát, comme on aimait s’appeler avant que les filles se greffent au groupe. Une bande forgée par huit années à partager la vie quotidienne d’une même classe, entre l’âge de six et quatorze ans — certains se connaissaient depuis la garderie. Huit années scolaires, en plus de toutes les activités parascolaires plus ou moins obligatoires qui soudaient l’esprit de corps d’une jeunesse socialiste : colonies de vacances, brigades de pionniers, journées communautaires. Une bande tissée d’autant plis serré que tout le monde, ou presque, était voisin, habitant de l’imposante cité de la rue Kárpát. » p. 42
« Sur papier, la maison appartenait à Klára, la troisième femme de mon père. Un héritage dont elle ne savait que faire avant qu’il entre dans sa vie. Lui le sut tout de suite. Juchée sur la crête d’une colline viticole au nord du lac Balaton, il s’agissait en fait d’une maison de vigneron construite au début du xix° siècle et oubliée depuis des décennies sur les hauteurs d’un village reculé. Aucune route n’y menait, il n’y avait pas d’électricité, de téléphone, d’eau courante ou d’espace habitable. Mais mon père avait bien vu que les désavantages de la maison — son inaccessibilité, sa rusticité — étaient, pour qui sait marier savoir-faire et savoir-être, des atouts. Pour une fois dans sa vie, il n’était pas impossible quil réussisse un mariage. » p. 60
« Le programme de mon séjour inscrit dans mon téléphone dresse la liste de mes ancrages dans mon pays natal, Je coche « les Gars ». Il reste : ma cousine et mon cousin, ma tante, ma marraine et mon parrain de Szentendre, Gábor, l’ami de ma mère (pour une histoire d’argent) et mon amour de jeunesse, Avec cette proposition de Petya hier soir, sortie de nulle part, j’ajoute : « Balaton ». Il faudrait aussi rendre visite à Mamie et Papou, me dis-je, et j’inscris « cimetière » à la liste. Contrairement à ces derniers, et pour les mêmes raisons que son fils, Grand-Mère n’a pas de sépulture. » p. 95
« Mon arbre généalogique tient sur un tronc gracile que je soigne assez peu. Ses branches basses sont plutôt dégarnies, Ma mère est enfant unique, tout comme trois de mes grandbsparents, tandis que le frère du quatrième est mort déporté avant d’avoir eu une descendance. Mon père et mon oncle ne sont plus de ce monde, mais à deux, ils ont engendré cinq enfants et quatre petits-enfants. De la fratrie, seuls mon cousin et ma cousine habitent encore en Hongrie. Ce matin, devant mon café au lait, je me demande si quiconque dans la ramure de cet arbre s’en désolerait.
Mon cousin m’a appelé à mon réveil. Nous nous sommes donné rendez-vous devant mon immeuble à onze heures et demie. De là, nous irons en voiture chez ma cousine (sa demi-sœur à lui) pour y passer l’après-midi tous les trois. Ça fait longtemps, depuis les funérailles de mon père, que nous ne nous sommes pas vus. » p. 110
« L’histoire de ma famille illustre assez bien l’épopée des Juifs hongrois à travers les siècles. Les ancêtres de ma mère, probablement artisans ou petits commerçants, se sont établis en Europe centrale il y a on ne sait combien de générations, traversant successivement, tant bien que mal, des périodes de tolérance et d’oppression. Il aura fallu que les Lumières jaillissent sur l’est du continent pour que les politiques discriminatoires à l’égard des Juifs soient abolies une par une, et que ces derniers bénéficient, après les valses-hésitations du XXe siècle, d’une citoyenneté pleine et entière. L’émancipation leur a ouvert les portes des universités, de la magistrature, de l’armée, de la fonction publique, et a grandement contribué à leur fierté hongroise. Le plus ancien de ces ancêtres dont je connais le métier devient, vers 1900, le premier Juif de son comitat à obtenir un poste de haut fonctionnaire : celui de chef de gare adjoint. » p. 169
À propos de l’auteur
 Akos Verboczy © Photo DR
Akos Verboczy © Photo DR
Né en Hongrie, Akos Verboczy est arrivé au Québec à l’âge de onze ans. Il a été chroniqueur, rédacteur de discours et de rapports officiels. En 2016, il publie Rhapsodie québécoise, récit de son itinéraire, finaliste du prix de la diversité Metropolis Bleu en 2017 en plus de faire partie pendant deux ans des « Incontournables » de Radio-Canada. La Maison de mon père est son premier roman. (Source : Éditions Le Bruit du Monde)
Site internet de l’auteur
Page Wikipédia de l’auteur
Page Facebook de l’auteur
Compte X (ex-Twitter) de l’auteur
Compte Instagram de l’auteur
Compte LinkedIn de l’auteur

Tags
#Lamaisondemonpere #AkosVerboczy #editionslebruitdumonde #hcdahlem
#premierroman #68premieresfois #roman #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancophone #litteraturecontemporaine #lundiLecture #LundiBlogs #primoroman #litteraturequebecoise #68premieresfois #Hongrie #RentreeLitteraire24#rentree2024#livre #lecture #blogueurlitteraire #books #blog #parlerdeslivres #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livreaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie #librairie #livrelover