Voici un livre particulièrement nourri par la prose fraîche de David Bosc. Le verbe est recherché, les phrases se scandent mélodieusement et l'écriture éblouit par sa propreté. La claire fontaine décrit de façon romanesque les dernières années du peintre Gustave Courbet en exil en Suisse, fuyant le fisc français, s'adonnant aux plaisirs de l'existence (contemplation de la nature environnante, ébats sexuels à profusion -plus ou moins monnayés-, consommation immodérée d'alcool). Courbet envoie paître les communards et répond aux commandes de peinture (plus pour gagner sa vie que par plaisir artistique). Continuellement observé voire fliqué, il agit en homme libre, se fiche des recommandations médicales, s'entoure d'hôtes fidèles et plus stables que lui (le couple Alexandre et Marie Morel), côtoie un temps le spleen artist Baudelaire et conçoit volontairement une exposition avec de faux Rembrandt, Véronèse etc achetés trois francs six sous. Bref, Courbet s'amuse et abuse à la Tour-de-Reiz, avant de tirer sa révérence.
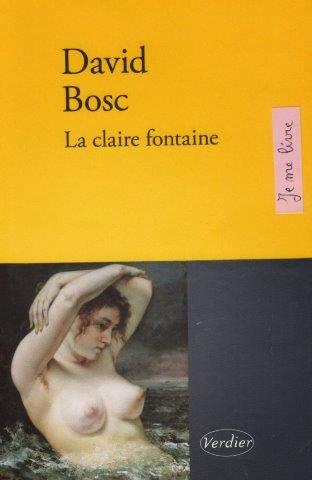 La claire fontaine représente un portrait -une fiche d'identité un temps donné- ni flatteur ni morbide de ce grand peintre un peu sur le déclin mais toujours bouillonnant de désir, une bouffée d'oxygène malgré l'époque pesante de suspicion et d'assassinats fréquents où l'échafaud n'est jamais très loin. David Bosc réveille son écrit avec un brin d'humour et un sens indéniable de la répartie, produit un texte riche des recherches bibliographiques entreprises et un effort impressionnant sur la biographie aussi remarquable par la qualité des citations qu'il laisse sur son sillage. Très bien.
La claire fontaine représente un portrait -une fiche d'identité un temps donné- ni flatteur ni morbide de ce grand peintre un peu sur le déclin mais toujours bouillonnant de désir, une bouffée d'oxygène malgré l'époque pesante de suspicion et d'assassinats fréquents où l'échafaud n'est jamais très loin. David Bosc réveille son écrit avec un brin d'humour et un sens indéniable de la répartie, produit un texte riche des recherches bibliographiques entreprises et un effort impressionnant sur la biographie aussi remarquable par la qualité des citations qu'il laisse sur son sillage. Très bien.
page 33 Lorsqu'il était ivre de vin, ou de laudanum, sa présence devenait plus dérangeante que celle d'un mort, parce qu'il accaparait toute la solitude.
page 36 Ils furent nombreux à relever le dénuement de cet étrange contemporain. On en était plus frappé, et pour tout dire, blessé, qu'il semblait volontaire ou pire, la conséquence d'une liberté. Les pauvres avaient au moins le tact d'avoir envie de toutes les choses dont ils étaient privés. Tandis que celui-là vous gâchait le plaisir par son indifférence, par ce ni chaud ni froid que lui faisait toute marchandise.
page 49 Et Marie eut envie de lui demander : pourquoi cracher, pourquoi toujours cette colère ? mais elle passa son bras dans le sien. L'aplomb des montagnes, en face, occupait le silence mais ne l'humiliait pas.
page 72 Courbet disait : « je peins ce que je vois », mais il a travaillé, lui aussi, à se rendre voyant. Vraiment, les opinions n'ont aucune importance. La pensée des hommes se tient dans ce qu'ils font, et peu importe si leurs bavardages énoncent tout le contraire.
page 73 ..., le peintre laissa monter en lui un doux chagrin de peintre : l'espace ne s'ouvrait, ne se disposait qu'à l'oreille, au nez : la brise, le bruissement des feuilles, une barque dont les amarres grincent, un grillon qui se tait soudain à l'approche d'on ne sait quoi, d'un campagnol, d'un orvet, l'odeur des ifs, sur la gauche, l'odeur de la pierre qui fraîchit et, sous le pied, celle du pissenlit qu'on écrase ; par touches, par notes longues ou vives, le paysage se compose, laissant le peintre sans grand pouvoir de transposition. Courbet se prit à rêver d'une peinture au noir, sonore et odorante.
 Éditions Verdier (106 pages consacrées au texte)
Éditions Verdier (106 pages consacrées au texte)
rentrée littéraire 2013
Lu dans le cadre du prix Biblioblog 2014.
avis : Jérôme, Maryline
et un de plus pour les challenges de Shelbylee et d'Asphodèle (trois prix pour ce roman dont le Prix Marcel Aymé 2013)

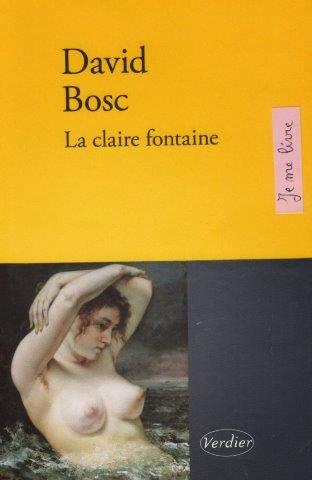 La claire fontaine représente un portrait -une fiche d'identité un temps donné- ni flatteur ni morbide de ce grand peintre un peu sur le déclin mais toujours bouillonnant de désir, une bouffée d'oxygène malgré l'époque pesante de suspicion et d'assassinats fréquents où l'échafaud n'est jamais très loin. David Bosc réveille son écrit avec un brin d'humour et un sens indéniable de la répartie, produit un texte riche des recherches bibliographiques entreprises et un effort impressionnant sur la biographie aussi remarquable par la qualité des citations qu'il laisse sur son sillage. Très bien.
La claire fontaine représente un portrait -une fiche d'identité un temps donné- ni flatteur ni morbide de ce grand peintre un peu sur le déclin mais toujours bouillonnant de désir, une bouffée d'oxygène malgré l'époque pesante de suspicion et d'assassinats fréquents où l'échafaud n'est jamais très loin. David Bosc réveille son écrit avec un brin d'humour et un sens indéniable de la répartie, produit un texte riche des recherches bibliographiques entreprises et un effort impressionnant sur la biographie aussi remarquable par la qualité des citations qu'il laisse sur son sillage. Très bien.
page 33 Lorsqu'il était ivre de vin, ou de laudanum, sa présence devenait plus dérangeante que celle d'un mort, parce qu'il accaparait toute la solitude.
page 36 Ils furent nombreux à relever le dénuement de cet étrange contemporain. On en était plus frappé, et pour tout dire, blessé, qu'il semblait volontaire ou pire, la conséquence d'une liberté. Les pauvres avaient au moins le tact d'avoir envie de toutes les choses dont ils étaient privés. Tandis que celui-là vous gâchait le plaisir par son indifférence, par ce ni chaud ni froid que lui faisait toute marchandise.
page 49 Et Marie eut envie de lui demander : pourquoi cracher, pourquoi toujours cette colère ? mais elle passa son bras dans le sien. L'aplomb des montagnes, en face, occupait le silence mais ne l'humiliait pas.
page 72 Courbet disait : « je peins ce que je vois », mais il a travaillé, lui aussi, à se rendre voyant. Vraiment, les opinions n'ont aucune importance. La pensée des hommes se tient dans ce qu'ils font, et peu importe si leurs bavardages énoncent tout le contraire.
page 73 ..., le peintre laissa monter en lui un doux chagrin de peintre : l'espace ne s'ouvrait, ne se disposait qu'à l'oreille, au nez : la brise, le bruissement des feuilles, une barque dont les amarres grincent, un grillon qui se tait soudain à l'approche d'on ne sait quoi, d'un campagnol, d'un orvet, l'odeur des ifs, sur la gauche, l'odeur de la pierre qui fraîchit et, sous le pied, celle du pissenlit qu'on écrase ; par touches, par notes longues ou vives, le paysage se compose, laissant le peintre sans grand pouvoir de transposition. Courbet se prit à rêver d'une peinture au noir, sonore et odorante.
 Éditions Verdier (106 pages consacrées au texte)
Éditions Verdier (106 pages consacrées au texte)
rentrée littéraire 2013
Lu dans le cadre du prix Biblioblog 2014.
avis : Jérôme, Maryline
et un de plus pour les challenges de Shelbylee et d'Asphodèle (trois prix pour ce roman dont le Prix Marcel Aymé 2013)


