Vous le comprendrez au titre de ce billet qu'on ne va pas parler du livre le plus rigolo de l'année. C'est même un roman qui réunit littérature anglo-saxonne, roman noir et roman historique, dans une ambiance très sombre, crépusculaire, même. Avec, à la clé, la découverte d'un jeune auteur dont le talent s'affirme, puisque son deuxième roman, sorti lors de cette récente rentrée littéraire, fait beaucoup parler. Parallèlement, son premier livre, lui, sort au Livre de Poche et c'est de lui dont nous allons parler aujourd'hui. Avec "Un ciel rouge, le matin", Paul Lynch, romancier irlandais, trentenaire, nous entraîne dans une course poursuite sans merci, une quête d'absolu d'un côté, de vengeance de l'autre, en un duel à distance qui, on le pressent, ne peut que mal se finir... Un drame en trois actes, une illustration saisissante de l'effet papillon à l'échelle humaine, un fait de rien du tout déclenchant des catastrophes en série. Servi par une écriture puissante (la traduction est de Marina Boraso), ce roman laisse entrevoir un talent certain qu'on a vite envie de retrouver.
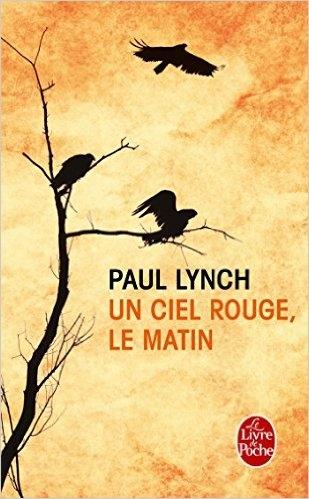
Coll Coyle est un jeune père de famille et son épouse attend déjà un second enfant. L'homme, comme son frère et ses parents avant eux, est métayer. Autrement dit, il cultive une terre qui ne lui appartient pas mais est la propriété d'un homme riche. En l'occurrence, de la famille Hamilton, une famille anglaise qui a acheté des terres sur le sol de la verte Irlande.
Un jour de 1832, sans signe avant-coureur, sans que rien ne laisse présager cette décision, sans que les Coyle, Coll le premier, ne comprenne pourquoi, ils apprennent qu'ils sont purement et simplement chassés des terres des Hamilton. C'est le fils de la famille, un joyeux luron à la réputation exécrable, qui a pris cette décision incompréhensible...
Les Coyle sont pantois, incapables de se résoudre à devoir déménager. Pour où, d'ailleurs ? Où vont-ils trouver, dans ce coin perdu d'Irlande, un nouveau domaine qui acceptera de les recevoir et de leur donner du travail ? Cette décision et le délai très court qui leur est laisser pour déguerpir, sont une véritable condamnation...
Alors, Coll décide d'aller à la rencontre de son employeur. De ce jeune et insupportable Hamilton qui ne se conduit guère mieux qu'un esclavagiste du sud des Etats-Unis et préfère dilapider la fortune familiale aux jeux et vaquer à divers plaisir que de s'occuper des terres familiales. Coll sait bien que cette visite est dérisoire, sans doute inutile, mais comment se résoudre à partir ?
Lorsqu'il parvient chez les Hamilton, Coll découvre le fils près à partir en chasse, à cheval, accompagné de son chien. Il l'interpelle, mais l'autre ne veut rien entendre, avec l'arrogance de celui qui est bien né conte celui qui n'est rien. L'incarnation même d'un arbitraire. Sous le coup de l'injustice, Coll, en bon Irlandais, sent la colère monter en lui.
Il essaye alors de faire entendre raison à cet homme qui tient dans sa main le destin de sa famille. La situation dégénère alors franchement et, accidentellement, Coll tue Hamilton. Oh, le mot "accidentellement" est bien inutile. Coll en a aussitôt conscience : personne ne croira qu'un métayer menacé d'expulsion aura tué son propriétaire sans le vouloir.
Coll le sait, son sort est déjà scellé, si on l'attrape, la justice l'enverra à la potence, sans sourciller. Alors, il se cache, en attendant mieux. Mais, bientôt, il se rend compte que la justice sera le dernier de ses problèmes... En effet, Faller, l'homme à tout faire, ou plutôt l'homme de main de Hamilton, s'est mis en chasse. La justice, cet Irlandais s'en moque comme de sa première chemise. Seule compte pour lui la vengeance.
Faller est une brute, un tueur. Il ne s'embarrasse pas de détails pour remonter la piste de Coll. Et ce dernier va vite comprendre qu'il va lui falloir mettre la plus grande distance entre lui et son poursuivant, s'il veut espérer protéger sa famille et la retrouver en bonne santé un de ces jours... Alors, bien que ça lui fende le coeur, il laisse derrière lui femme et enfants et trace la route.
Par un concours de circonstance, alors qu'il essaye d'échapper à Faller qui semble toujours flairer sa piste comme le ferait un limier, voilà Coll contraint de prendre la mer. Mais, alors qu'il s'attendait à gagner l'Angleterre ou l'Ecosse, il se rend bien vite compte que le bateau qui le transporte l'emmène bien plus loin. En Amérique...
Je n'en dis pas plus, car, même s'il semble difficile de classer ce roman en thriller ou en polar, il n'en reste pas moins un roman à suspense où la traque de Faller oblige Coll à agir, se déplacer, se faire oublier, souvent en vain... Toutefois, il va être intéressant de faire un point sur les contextes différents dans lesquels le personnage principal évolue au fil des pages.
L'Irlande, d'abord. Une terre que connaît bien Paul Lynch, puisqu'il y est né et y vit toujours. Pourtant, sa description de la rudesse de la vie en Irlande dans les années 1830 n'est pas précisément une invitation au voyage... La misère des métayers, la mainmise anglaise, le climat rude, le développement de centres urbains qui inspireront Dickens et London...
Bref, pas vraiment l'image romantique qu'on peut avoir de l'Irlande, mais bien un lieu où chacun doit s'accrocher pour avancer et accepter la modestie et la difficulté de l'existence. On est avant la famine provoquée par la destruction des pommes de terre par une maladie, et l'énorme émigration que cela va entraîner vers les Etats-Unis.
Pourtant, en cette année 1832, nombreux sont déjà les Irlandais qui partent chercher un certain salut de l'autre côté de l'océan, dans ce Nouveau Monde aux perspectives dorées. Mais, les catholiques irlandais retrouvent bien souvent des conditions analogues une fois la traversée effectuée, la jeune Amérique étant aux mains de protestants d'origine anglaise...
C'est dire que le voyage entrepris par Coll n'est vraiment pas un séjour au paradis... A commencer par cette traversée, dantesque, qui va durer plus de deux mois et constitue la deuxième partie du roman à elle seule. La description de la promiscuité, de la maladie, qui frappe au hasard, de l'adaptation des survivants, leur vie quotidienne et leur façon de faire passer le temps... Tout cela est remarquablement rendu.
Et quand je dis rendu... On en aurait presque le mal de mer, tant on a l'impression de se trouver dans ces cales nauséabondes, ces troisièmes classes qu'on n'appelle même pas comme ça et qui sont sans doute encore pire que cela. Tout le livre est remarquable, mais je dois dire que cette partie précisément m'a profondément marqué.
Suit la troisième partie, sur le sol américain, où Coll va trouver du travail, participant à la construction des premières lignes de chemin de fer, du côté de Philadelphie. Une autre forme d'exploitation, bien planquée derrière de belles promesses, parfaites pour nourrir l'espoir d'un retour prochain au pays, auprès des siens...
Ce désir profond de retrouver sa femme et ses enfants, d'apprendre à connaître cet enfant qu'il a quitté alors qu'il était encore à naître, tout cela pousse Coll à ne jamais renoncer au long de son périple. Il doit surveiller sans cesse ses arrières, de peur de voir surgir Faller, qu'il sent en permanence sur ses talons, mais aussi affronter un territoire qui sait, lui aussi, se montrer hostile.
Faller... Il faut bien s'arrêter un instant sur ce personnage-clé. Une brute, je l'ai dit. Un homme sans aucun sentiment, si ce n'est cet attachement assez particulier à un autre malade, ce jeune Hamilton, dénué de tout scrupule. Comment vous dire ? Faller, je n'ai pu m'empêcher de lui donner les traits de Lee Van Cleef. Le même, avec ou sans le cadrage à la Leone, mais en plus balèze. Impitoyable, déterminé, ultra-violent et cynique. Pas le genre d'homme qu'on a envie de se mettre à dos.
C'est un vrai beau, grand personnage de méchant, ce Faller et il mène la danse d'une étonnante galerie de personnages, qui ne dépareraient pas dans différents westerns, tant ils ont tous une gueule et une personnalité particulière. Des plus petits rôles aux plus importants protagonistes secondaires, chacun marque, chacun apporte sa folie ou sa mesure à une histoire qui oscille constamment entre les deux.
On trouve aussi tout le spectre du genre humain, de la bonté à la pire ignominie, de la solidarité et de l'amitié à la froideur la plus glaciale, qui peut pousser un homme à faire subir à son prochain les pires souffrances. Cette comédie humaine, fresque dramatique, parfois lyrique, mais sans excès, vaut autant par les personnages qu'elle met en scène que par les situations qu'elle leur fait traverser.
Ce livre, ce premier roman, est porté par un incroyable souffle romanesque. L'écriture de Lynch, descriptive, réaliste, rend parfaitement toute la dureté des lieux et des situations et la tension dramatique qui porte le récit presque des premières pages jusqu'aux dernières lignes. Le titre français respecte le titre original ("Red morning sky") et c'est une bonne chose.
Car, d'une certaine façon, l'histoire de ce livre, pourtant étalée sur plusieurs mois, peut-être même une année, se lit comme si tout cela se déroulait en une seule journée. Une journée qui a débuté dans le calme d'un matin comme les autres, lorsque le soleil levant darde ses premiers rayon, rougissant le ciel pendant quelques minutes.
Faut-il y voir le signe d'une journée sanglante à venir ? "Un ciel rouge, le matin", est un livre violent, et pas seulement en raison de tout ce que j'ai décrit jusqu'ici, la violence de l'existence. Faller laisse dans son sillage une traînée de sang qu'il prend plaisir à répandre. Du moins, tant qu'il est en Irlande, où il se sait craint. Car, en Amérique, lui aussi devra s'adapter à une société où il n'est plus rien.
Le roman file comme une journée et, de cette rouge aurore, il achemine les personnages vers le crépuscule, entre chien et loup, comme on dit, lorsque, là encore, le ciel s'ensanglante avant de s'obscurcir. Ah, le crépuscule, ces images de duels dans les westerns, alors que le soleil se couche, tout ça... Oubliez tout, le soleil se couche, oui, les ténèbres approchent, mais rien ne va se passer comme vous pouvez l'imaginer.
Au fil du récit, et malgré les différences géographiques évidentes, je me suis mis à penser à l'écriture de Faulkner, oppressante, sombre, qui est effectivement une des références revendiquées par Paul Lynch. Ce n'est pas la seule, la quatrième de couverture de l'édition de poche évoque aussi Don De Lillo et Saul Bellow... De grandes influences dont Paul Lynch s'avère digne.
On a là de la littérature, de la vraie, de la grande, et accessible, en plus, dans le fond comme dans la forme. On pourra trouver que Lynch utilise une trame sans originalité, celle de la traque d'un homme par un autre, mais il sait la magnifier, la rendre forte et puissante et parvient à la renouveler par un dénouement inattendu.
Oh, j'en vois qui diront qu'ils restent sur leur faim, parce qu'ils n'auront pas eu ce qu'ils attendaient depuis le début. Mais, justement, Lynch prend un parfait contre-pied, qui correspond bien au déracinement des deux personnages centraux. Dans ce nouveau monde, si proche et pourtant si différent, les règles en vigueur ne sont plus celles qu'ils ont enfreinte sur leur terre natale. Et cela se paie.
Un dernier mot : tout au long du livre, on se dit que l'expropriation est la simple conséquence du bon vouloir d'un homme puissant exerçant son arbitraire sur ceux qui n'ont pas la chance d'être né sous la même bonne étoile que lui. Dans les dernières pages, presque subrepticement, on découvre la cause de cette histoire, tellement insignifiante qu'elle est encore plus violente que le simple arbitraire...
Et cela donne encore plus de puissance à ce livre. Celle de la gifle que reçoit le lecteur en entrant dans l'univers de Lynch. Pas David, mais Paul. Et il va falloir se souvenir de ce prénom-là car, lui aussi marque ses lecteurs de son empreinte, comme le fait depuis si longtemps le réalisateur avec ceux qui voient ses films.
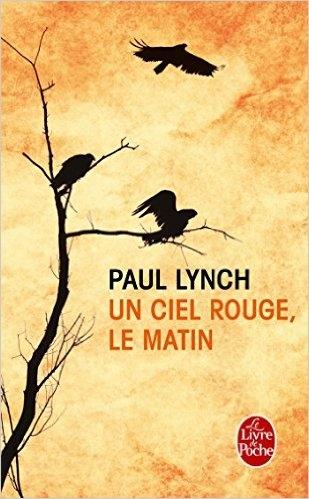
Coll Coyle est un jeune père de famille et son épouse attend déjà un second enfant. L'homme, comme son frère et ses parents avant eux, est métayer. Autrement dit, il cultive une terre qui ne lui appartient pas mais est la propriété d'un homme riche. En l'occurrence, de la famille Hamilton, une famille anglaise qui a acheté des terres sur le sol de la verte Irlande.
Un jour de 1832, sans signe avant-coureur, sans que rien ne laisse présager cette décision, sans que les Coyle, Coll le premier, ne comprenne pourquoi, ils apprennent qu'ils sont purement et simplement chassés des terres des Hamilton. C'est le fils de la famille, un joyeux luron à la réputation exécrable, qui a pris cette décision incompréhensible...
Les Coyle sont pantois, incapables de se résoudre à devoir déménager. Pour où, d'ailleurs ? Où vont-ils trouver, dans ce coin perdu d'Irlande, un nouveau domaine qui acceptera de les recevoir et de leur donner du travail ? Cette décision et le délai très court qui leur est laisser pour déguerpir, sont une véritable condamnation...
Alors, Coll décide d'aller à la rencontre de son employeur. De ce jeune et insupportable Hamilton qui ne se conduit guère mieux qu'un esclavagiste du sud des Etats-Unis et préfère dilapider la fortune familiale aux jeux et vaquer à divers plaisir que de s'occuper des terres familiales. Coll sait bien que cette visite est dérisoire, sans doute inutile, mais comment se résoudre à partir ?
Lorsqu'il parvient chez les Hamilton, Coll découvre le fils près à partir en chasse, à cheval, accompagné de son chien. Il l'interpelle, mais l'autre ne veut rien entendre, avec l'arrogance de celui qui est bien né conte celui qui n'est rien. L'incarnation même d'un arbitraire. Sous le coup de l'injustice, Coll, en bon Irlandais, sent la colère monter en lui.
Il essaye alors de faire entendre raison à cet homme qui tient dans sa main le destin de sa famille. La situation dégénère alors franchement et, accidentellement, Coll tue Hamilton. Oh, le mot "accidentellement" est bien inutile. Coll en a aussitôt conscience : personne ne croira qu'un métayer menacé d'expulsion aura tué son propriétaire sans le vouloir.
Coll le sait, son sort est déjà scellé, si on l'attrape, la justice l'enverra à la potence, sans sourciller. Alors, il se cache, en attendant mieux. Mais, bientôt, il se rend compte que la justice sera le dernier de ses problèmes... En effet, Faller, l'homme à tout faire, ou plutôt l'homme de main de Hamilton, s'est mis en chasse. La justice, cet Irlandais s'en moque comme de sa première chemise. Seule compte pour lui la vengeance.
Faller est une brute, un tueur. Il ne s'embarrasse pas de détails pour remonter la piste de Coll. Et ce dernier va vite comprendre qu'il va lui falloir mettre la plus grande distance entre lui et son poursuivant, s'il veut espérer protéger sa famille et la retrouver en bonne santé un de ces jours... Alors, bien que ça lui fende le coeur, il laisse derrière lui femme et enfants et trace la route.
Par un concours de circonstance, alors qu'il essaye d'échapper à Faller qui semble toujours flairer sa piste comme le ferait un limier, voilà Coll contraint de prendre la mer. Mais, alors qu'il s'attendait à gagner l'Angleterre ou l'Ecosse, il se rend bien vite compte que le bateau qui le transporte l'emmène bien plus loin. En Amérique...
Je n'en dis pas plus, car, même s'il semble difficile de classer ce roman en thriller ou en polar, il n'en reste pas moins un roman à suspense où la traque de Faller oblige Coll à agir, se déplacer, se faire oublier, souvent en vain... Toutefois, il va être intéressant de faire un point sur les contextes différents dans lesquels le personnage principal évolue au fil des pages.
L'Irlande, d'abord. Une terre que connaît bien Paul Lynch, puisqu'il y est né et y vit toujours. Pourtant, sa description de la rudesse de la vie en Irlande dans les années 1830 n'est pas précisément une invitation au voyage... La misère des métayers, la mainmise anglaise, le climat rude, le développement de centres urbains qui inspireront Dickens et London...
Bref, pas vraiment l'image romantique qu'on peut avoir de l'Irlande, mais bien un lieu où chacun doit s'accrocher pour avancer et accepter la modestie et la difficulté de l'existence. On est avant la famine provoquée par la destruction des pommes de terre par une maladie, et l'énorme émigration que cela va entraîner vers les Etats-Unis.
Pourtant, en cette année 1832, nombreux sont déjà les Irlandais qui partent chercher un certain salut de l'autre côté de l'océan, dans ce Nouveau Monde aux perspectives dorées. Mais, les catholiques irlandais retrouvent bien souvent des conditions analogues une fois la traversée effectuée, la jeune Amérique étant aux mains de protestants d'origine anglaise...
C'est dire que le voyage entrepris par Coll n'est vraiment pas un séjour au paradis... A commencer par cette traversée, dantesque, qui va durer plus de deux mois et constitue la deuxième partie du roman à elle seule. La description de la promiscuité, de la maladie, qui frappe au hasard, de l'adaptation des survivants, leur vie quotidienne et leur façon de faire passer le temps... Tout cela est remarquablement rendu.
Et quand je dis rendu... On en aurait presque le mal de mer, tant on a l'impression de se trouver dans ces cales nauséabondes, ces troisièmes classes qu'on n'appelle même pas comme ça et qui sont sans doute encore pire que cela. Tout le livre est remarquable, mais je dois dire que cette partie précisément m'a profondément marqué.
Suit la troisième partie, sur le sol américain, où Coll va trouver du travail, participant à la construction des premières lignes de chemin de fer, du côté de Philadelphie. Une autre forme d'exploitation, bien planquée derrière de belles promesses, parfaites pour nourrir l'espoir d'un retour prochain au pays, auprès des siens...
Ce désir profond de retrouver sa femme et ses enfants, d'apprendre à connaître cet enfant qu'il a quitté alors qu'il était encore à naître, tout cela pousse Coll à ne jamais renoncer au long de son périple. Il doit surveiller sans cesse ses arrières, de peur de voir surgir Faller, qu'il sent en permanence sur ses talons, mais aussi affronter un territoire qui sait, lui aussi, se montrer hostile.
Faller... Il faut bien s'arrêter un instant sur ce personnage-clé. Une brute, je l'ai dit. Un homme sans aucun sentiment, si ce n'est cet attachement assez particulier à un autre malade, ce jeune Hamilton, dénué de tout scrupule. Comment vous dire ? Faller, je n'ai pu m'empêcher de lui donner les traits de Lee Van Cleef. Le même, avec ou sans le cadrage à la Leone, mais en plus balèze. Impitoyable, déterminé, ultra-violent et cynique. Pas le genre d'homme qu'on a envie de se mettre à dos.
C'est un vrai beau, grand personnage de méchant, ce Faller et il mène la danse d'une étonnante galerie de personnages, qui ne dépareraient pas dans différents westerns, tant ils ont tous une gueule et une personnalité particulière. Des plus petits rôles aux plus importants protagonistes secondaires, chacun marque, chacun apporte sa folie ou sa mesure à une histoire qui oscille constamment entre les deux.
On trouve aussi tout le spectre du genre humain, de la bonté à la pire ignominie, de la solidarité et de l'amitié à la froideur la plus glaciale, qui peut pousser un homme à faire subir à son prochain les pires souffrances. Cette comédie humaine, fresque dramatique, parfois lyrique, mais sans excès, vaut autant par les personnages qu'elle met en scène que par les situations qu'elle leur fait traverser.
Ce livre, ce premier roman, est porté par un incroyable souffle romanesque. L'écriture de Lynch, descriptive, réaliste, rend parfaitement toute la dureté des lieux et des situations et la tension dramatique qui porte le récit presque des premières pages jusqu'aux dernières lignes. Le titre français respecte le titre original ("Red morning sky") et c'est une bonne chose.
Car, d'une certaine façon, l'histoire de ce livre, pourtant étalée sur plusieurs mois, peut-être même une année, se lit comme si tout cela se déroulait en une seule journée. Une journée qui a débuté dans le calme d'un matin comme les autres, lorsque le soleil levant darde ses premiers rayon, rougissant le ciel pendant quelques minutes.
Faut-il y voir le signe d'une journée sanglante à venir ? "Un ciel rouge, le matin", est un livre violent, et pas seulement en raison de tout ce que j'ai décrit jusqu'ici, la violence de l'existence. Faller laisse dans son sillage une traînée de sang qu'il prend plaisir à répandre. Du moins, tant qu'il est en Irlande, où il se sait craint. Car, en Amérique, lui aussi devra s'adapter à une société où il n'est plus rien.
Le roman file comme une journée et, de cette rouge aurore, il achemine les personnages vers le crépuscule, entre chien et loup, comme on dit, lorsque, là encore, le ciel s'ensanglante avant de s'obscurcir. Ah, le crépuscule, ces images de duels dans les westerns, alors que le soleil se couche, tout ça... Oubliez tout, le soleil se couche, oui, les ténèbres approchent, mais rien ne va se passer comme vous pouvez l'imaginer.
Au fil du récit, et malgré les différences géographiques évidentes, je me suis mis à penser à l'écriture de Faulkner, oppressante, sombre, qui est effectivement une des références revendiquées par Paul Lynch. Ce n'est pas la seule, la quatrième de couverture de l'édition de poche évoque aussi Don De Lillo et Saul Bellow... De grandes influences dont Paul Lynch s'avère digne.
On a là de la littérature, de la vraie, de la grande, et accessible, en plus, dans le fond comme dans la forme. On pourra trouver que Lynch utilise une trame sans originalité, celle de la traque d'un homme par un autre, mais il sait la magnifier, la rendre forte et puissante et parvient à la renouveler par un dénouement inattendu.
Oh, j'en vois qui diront qu'ils restent sur leur faim, parce qu'ils n'auront pas eu ce qu'ils attendaient depuis le début. Mais, justement, Lynch prend un parfait contre-pied, qui correspond bien au déracinement des deux personnages centraux. Dans ce nouveau monde, si proche et pourtant si différent, les règles en vigueur ne sont plus celles qu'ils ont enfreinte sur leur terre natale. Et cela se paie.
Un dernier mot : tout au long du livre, on se dit que l'expropriation est la simple conséquence du bon vouloir d'un homme puissant exerçant son arbitraire sur ceux qui n'ont pas la chance d'être né sous la même bonne étoile que lui. Dans les dernières pages, presque subrepticement, on découvre la cause de cette histoire, tellement insignifiante qu'elle est encore plus violente que le simple arbitraire...
Et cela donne encore plus de puissance à ce livre. Celle de la gifle que reçoit le lecteur en entrant dans l'univers de Lynch. Pas David, mais Paul. Et il va falloir se souvenir de ce prénom-là car, lui aussi marque ses lecteurs de son empreinte, comme le fait depuis si longtemps le réalisateur avec ceux qui voient ses films.
