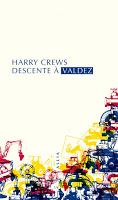 1974. Harry Crews débarque en Alaska, à Valdez (à prononcer Valdiiiz pour que ça rime avec disease selon les habitants du coin), un bled paumé où pullulent les caravanes et les engins de chantier. L’auteur du chanteur de gospel est envoyé sur place par le magazine Playboy pour écrire un reportage sur la construction d’un oléoduc trans-Alaska de 1300 kilomètres de long. A terme, deux millions de litres de pétrole devront transiter chaque jour dans ce gros tuyau, quitte à défigurer un paysage jusqu’alors protégé et à bouleverser une biodiversité dont les huit sociétés pétrolières chargées de l’exploitation du gisement n’ont strictement rien à cirer.
1974. Harry Crews débarque en Alaska, à Valdez (à prononcer Valdiiiz pour que ça rime avec disease selon les habitants du coin), un bled paumé où pullulent les caravanes et les engins de chantier. L’auteur du chanteur de gospel est envoyé sur place par le magazine Playboy pour écrire un reportage sur la construction d’un oléoduc trans-Alaska de 1300 kilomètres de long. A terme, deux millions de litres de pétrole devront transiter chaque jour dans ce gros tuyau, quitte à défigurer un paysage jusqu’alors protégé et à bouleverser une biodiversité dont les huit sociétés pétrolières chargées de l’exploitation du gisement n’ont strictement rien à cirer.Crews arrive dans une ville en pleine évolution, poussant trop vite, sans infrastructures adaptées à l’inflation de population en cours et à venir. Il y rencontre Dave le contremaître, Hap le cuistot, Chris le pêcheur, Jay l’autochtone et sa femme esquimaude, le chef d’une police comptant en tout et pour tout trois membres, un dealer de marijuana, une prostituée venue de Californie certaine de crouler sous la clientèle ou encore un tatoueur frappadingue. Il arrive aux derniers instants avant la tempête, à ce moment crucial où Valdez va basculer dans une autre dimension, absolument pas prête à devenir une ville champignon de 17 000 habitants uniquement attirés par des salaires juteux : « Une tension, une violence même flotte dans l’air de Valdez, en équilibre précaire et sur le point de basculer vers quelque chose d’inédit. Vers quoi, personne ne le sait ».
Crews reporter, c’est du Crews pur jus, avec cette tendresse particulière pour les paumés magnifiques, cette prose déjantée et ces dialogues au cordeau. Il enchaîne les situations rocambolesques, se saoule et danse au seul bar du coin, se réveille dans sa voiture de location avec une gueule de bois terrible et un tatouage réalisé à son insu pendant qu’il était dans les vapes : « J’ai commencé à hurler et à gueuler qu’ils ne peuvent pas tatouer quelqu’un de complètement déchiré, que je n’aurais jamais accepté d’être tatoué, car seuls les trous-du-cul se font tatouer et je n’en étais pas un ». Du Crews pur jus je vous dis, et une forme de journalisme à l’ancienne, proche du gonzo de Hunter S. Thompson. Forcément j’ai adoré…
Descente à Valdez d’Harry Crews (traduction de Bruno Charoy). Allia, 2016. 65 pages. 7,50 euros.