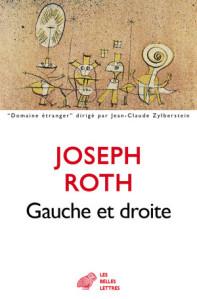
En des temps où les vérités deviennent rares, rien n'est plus crédible qu'un bruit ; et plus il est cousu de fil blanc, plus il est extravagant, plus les gens à l'imagination romanesque sont prêts à l'accepter.
Qu'est ce qui fait, qu'à un moment donné de l'Histoire, l'individu choisisse tel positionnement ou embrasse telle doctrine politique ? C'est, pour Joseph Roth des souvenirs d'enfance et des fatalités de caractère, saupoudrées d'histoire familiale ; des petits riens, en somme, mais qui tracent un parcours presque inéluctablement. Gauche et droite raconte d'abord le destin de deux frères en rivalité l'un avec l'autre : l'aîné, Paul, est un jeune homme charmant, qui est parti étudier quelques mois à Oxford et en gardera une nostalgie toute sa vie ; le plus jeune, Théodore, est plus fragile et souffre d'avoir vécu dans l'ombre de son frère.
Le roman s'ouvre sur un potentiel : tout est destiné à réussir à l'aîné Bernheim. Mais les temps changent, et entre la guerre, les mauvais placements et l'évolution des logiques économiques,il se retrouve bientôt - presque - sans le sou. A trente ans, Paul, qui n'était qu'un immense et capricieux potentiel, se demande ce qu'il s'est bien passé pour qu'il en soit encore à chercher sa place. Ne devait-il pas devenir quelqu'un ? Et malgré leurs désaccords profonds, couve chez les deux frères un profond sentiment de déclassement, qui explique jusqu'à la jalousie qu'ils ressentent pour leur position respective.
Ceux-ci répondent à ce sentiment de deux façons très différentes. C'est par le nationalisme et l'antisémitisme que Théodore trouve la réponse au paradoxe fondamental de la défaite de l'Allemagne et des difficultés financières croissantes de sa famille qui avait pourtant réussi. C'est son moyen de retrouver une dignité perdue, voire de la créer de toutes pièces puisqu'il n'avait pu jusque là que ramasser les miettes laissées par son frère. Paul, lui, opère toujours aux moments de crise un retour sur son passé glorieux et ses études anglaises : derrière l'opposition des deux frères, se cachent peut-être deux retours instinctifs vers un passé glorieux et idéalisé.
J'ai gardé le souvenir d'une époque où Paul Bernheim promettait de devenir un génie.
Mais Paul Bernheim a un autre Doppelgänger : c'est Nikolas Brandeis, juif russe qui a émigré dans la République de Weimar après avoir tout perdu. Aussi bizarre par lui-même qu'étranger à cette société, Brandeis se fait peu à peu une place, en multipliant les investissements qui rapportent. Ce qui le distingue des frères Bernheim, c'est de fait sa capacité à évoluer et à suivre les métamorphoses du monde d'après-guerre. Pour Aurélie Le Née, dans " L'univers duel des romans de retour de guerre : Zipper et son père et Gauche et droite " ( Cahiers de l'Herne, Joseph Roth), les transformations perpétuelles de Brandeis sont justement la réponse qu'il trouve à la perte des valeurs connues et de sa patrie ; un besoin naturel, en somme, après l'effondrement de son univers.
" Je suis dix ! répondait-il. Je suis instituteur, étudiant, paysan, tsariste, assassin, traître ! J'ai connu la satiété, la paix, la faim, la guerre, le typhus, la misère, la nuit et le jour, le froid glacial et la chaleur torride, le danger et la vie.
Cette troisième voie pour un troisième personnage n'est pas exempte d'ambiguïté : à se transformer et à renaître à chaque crise, en risque-t-on pas de se perdre soi-même ? Peut-être est-ce le seul moyen, dans une époque entre chien et loup, où les nationalismes montent au vu et au su des intellectuels et des pro-européanistes, pour survivre ? Aurélie Le Née voit dans les multiples métamorphoses de Brandéis le seul moyen de " préserver l'individualité face à la marche de l'histoire ".
Car tout est une question d'individualité. On peut agiter de grands concepts politiques à tout va, ce sur quoi s'attarde Joseph Roth, ce sont les individus. Il s'attache à décortiquer les plus infimes mouvements de pensée, parce que c'est là que se cachent les clés pour comprendre leurs trajectoires. La plume est fine, le regard d'une acuité remarquable, et je me suis surprise plusieurs fois à interrompre ma lecture, revenir sur un paragraphe, marquer les pages et noter des extraits. J'ai pensé à la façon dont Proust raconte, par touches, à travers la simple évolution de toute une galerie de personnages, la disparition d'un monde d'hier au lendemain de la première guerre. Le procédé est le même chez Joseph Roth : on assiste à un processus dont nous ne percevons que quelques effets, et c'est en recoupant les expériences des différents personnages que nous parvenons à en prendre la mesure.
[Ce dernier paragraphe révèle le contenu des derniers chapitres.] Le roman se termine par une fête dans la nouvelle maison de Paul, modèle d'une artificielle modernité qui sent l'huile et la térébenthine, où se réunissent gens comme il faut de tous bords. On y devine des évolutions politiques dictées par les intérêts et l'ambition, et toute l'artificialité des relations internationales et interculturelles, qui relèvent déjà davantage de la mise en scène que d'autre chose. Le roman se termine aussi par une fuite : celle, réussie, de Brandeis ; celle, ratée, de celui qui, avant-guerre, était promis à un grand destin.
Saisissant.
Soudain, une expression lui vint à l'esprit. Une expression dont la stupidité n'aurait pu, à tout autre moment, infléchir sa décision. Une de ces expressions vides de sens qui, pour toute une vie, nichent dans nos cervelles : lambeaux de maximes, de formules répétées en classe, de lectures scolaires, de récits héroïques ; qui restent là, sans bouger, comme des chauve-souris, aussi longtemps que nous sommes éveillés, et n'attendent que les premiers instants d'obscurité pour recommencer à voleter en nous.

Merci aux éditions des Belles Lettres et à Babelio pour m'avoir confié cette réédition dans une élégante traduction de Jean Ruffet, dans le cadre du programme Masse critique.


