Cette citation est tirée de la pièce "Un tramway nommé désir", elle est prononcé par le personnage de Blanche Dubois, incarnée par Vivien Leigh dans la version cinéma d'Elia Kazan. C'est la narratrice de notre roman du soir qui la prononce, et malheureusement, dans son cas, c'est plus qu'une remarque à prendre au pied de la lettre. Voici un court roman, signée par une écrivaine déjà auréolée d'un prix Pulitzer pour un de ses précédents livres. Un court roman à la fois très dur, douloureux, mais portée par des valeurs très positives, et en particulier la volonté de ne jamais rabaisser ou mépriser personne. "Je m'appelle Lucy Barton", d'Elizabeth Strout (aux éditions Fayard), c'est la confrontation d'une fille et de sa mère, avec entre elles de lourds secrets. Et, autour de cette rencontre, aussi chaleureuse que possible, étant donné les circonstances, se tisse l'histoire d'une femme qui a dû se construire dans l'adversité, la douleur, qui s'en est sortie, mais pas sans séquelle...
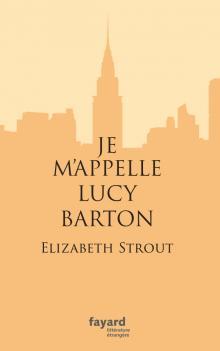
Au milieu des années 1980, Lucy Barton, narratrice de ce roman, a dû subir une intervention chirurgicale. On ignore de quoi elle souffrait exactement, mais on apprend que cela touche la région abdominale et qu'il y a eu quelques complications après l'opération. D'où une période difficile, une santé fragilisée et l'obligation de rester hospitalisée plus de deux mois.
Au cours de cette période, alors qu'elle n'est vraiment pas au meilleur de sa forme, qu'elle enchaîne les examens et que le médecin qui s'occupe d'elle redoute de devoir l'opérer une nouvelle fois, Lucy reçoit une visite pour le moins inattendue : celle de sa mère. Inattendue, parce qu'on comprend que cela fait des années que les deux femmes ne se sont pas vues, ni même parlé.
Pendant cinq jours et autant de nuit, la mère ne quitte pas le chevet de sa fille, veillant sur elle, dormant peu. Et, petit à petit, comme un moteur longtemps éteint qu'on essaye de relancer, la conversation s'instaure entre elles, cahotante, hésitante, pour parler de la pluie, du beau temps et du passé... Des échanges à fleurets mouchetés, se dit-on presque...
Alors, entre leurs discussions et les souvenirs qu'elles réveillent chez Lucy, celle-ci commence à raconter sa vie, depuis son enfance dans un coin perdu de l'Illinois, une petite ville noyée au milieu des champs de maïs, jusqu'à l'époque actuelle, où elle est devenue écrivaine et a choisi de bouleverser son existence de fond en comble.
De son passé, on découvre une famille extrêmement pauvre dans l'Amérique pourtant florissante de l'après-guerre. Une maison minuscule, branlante, sans aucun confort matériel. Une hygiène qui laisse à désirer et vaut à Lucy, son frère et sa soeur les moqueries et pires encore de la part des autres enfants et de certains adultes.
Une vie misérable qui, en soit, n'est déjà pas synonyme de départ idéal dans l'existence, mais qui s'accompagne d'autre chose. Précisément, ce ne sera jamais dit. Mais, on peut imaginer des violences de la part d'un père, ancien soldat lors de la IIe Guerre mondiale, revenu traumatisé du front. Et, peut-être pire encore que cela, ce que l'on comprend, c'est qu'il a fallu grandir dans l'indifférence de la mère.
C'est le point névralgique de cette histoire, cette relation, ou plutôt, cette absence de relation entre la mère et la fille. "Les mères sont censées protéger leurs enfants" : cette phrase est prononcée avec un détachement glaçant par la mère de Lucy, lors d'une de leurs conversations, dans cette chambre d'hôpital avec vue sur le Chrysler Building.
Elle le dit comme un constat, le constat de son incapacité à le faire. Et c'est dit sans regret, ni remords, un fait, clinique, simple... A-t-elle un jour aimé ses enfants ? La réponse n'est jamais clairement formulée, et l'on n'a pas franchement envie qu'elle le soit, tant on redoute sa nature... Ici, il ne s'agit pas d'absence d'instinct maternel, mais véritablement d'absence de sentiments...
On découvre, au fil des souvenirs, que Lucy est (et je vais mettre des guillemets) "la moins traumatisée" des trois enfants de la famille Barton. Sa soeur est animée par une inextinguible colère, tandis que son frère semble s'être muré dans une vie à part, une enfance éternelle, comme vidée de sa substance...
Si je mets des guillemets, c'est parce que tout le récit de Lucy va nous montrer qu'elle a gardé de cette enfance sans amour des séquelles profondes, dont elle voit les conséquences depuis toujours. Des séquelles qui marquent sa vie privée, sa relation aux autres, son travail et son écriture. Et, surtout, son rôle de mère, puisqu'elle aussi, à son tour, a donné naissance à des enfants.
Lucy, c'est une femme courageuse, mais rongée par un profond complexe d'infériorité (vous devez vous en douter, avec ce qui a déjà été dit) et surtout, une peur qui la ronge. Elle a grandi sans repère, elle a eu le courage de quitter très vite ce milieu familial délétère, elle a fait des choix, pas toujours heureux, elle a coupé les ponts pour se construire, sans véritable repère.
Avec un choix fondamental : fuir la petite ville où elle a grandi, mais pas pour aller n'importe où. A l'université, d'abord, pour laquelle elle obtiendra une bourse, découvrant l'indépendance, puis, à New York, ville immense, mégapole dans laquelle on peut se perdre, se fondre. Se rendre invisible. Mais, ça n'est pas la seule chose qui fait du choix de New York un élément important de ce roman.
"Je m'intéresse à la façon dont on peut se sentir supérieur à quelqu'un d'autre ou à un autre groupe de gens. Ca arrive partout, tout le temps. Quel que soit le nom qu'on donne à ce besoin de trouver quelqu'un à rabaisser, je le considère comme ce qu'il y a de plus vil en nous", écrit ainsi Lucy Barton dans son témoignage.
Elle a été sujette de ces moqueries, de situations humiliantes, pas toujours volontaires, ce qui est encore plus blessant, parfois, et elle s'est construite en fonction de cela. Tout n'a pas été aussi évident que j'ai l'air de le dire, il lui a fallu apprendre, simplement apprendre à connaître l'autre, à nouer des relations sociales sans qu'on lui en ait inculqué le mode d'emploi...
Mais, instinctivement, elle a toujours cherché à respecter les autres, quels qu'ils soient. Elle se montre choquée par la hauteur et l'arrogance de certaines personnes, qui n'ont pas conscience des blessures que leurs mots, leurs gestes infligent aux autres. Et, de la même manière, elle reconnaît celles et ceux qui ont souffert des mêmes maux qu'elle.
Et pourtant, malgré les années qui ont passé, jamais elle n'a pu se défaire de cette peur, que l'on ressent d'un bout à l'autre du livre. La peur de celle qui joue les funambules, marchant sur un fil, en sachant qu'il n'y aura pas de filet pour amortir sa chute. La peur de mal faire, de blesser, de ne pas être à la hauteur, de souffrir...
Une peur qui rejaillit lorsque Lucy devient à son tour épouse et mère de famille. Elle l'est déjà au moment de l'hospitalisation, mais c'est avec le recul qu'elle se posera des questions. Il y a quelque chose de troublant, dans cet aspect du livre : sans reproduire un modèle familial, on ressent toutes les imperfections, toute la frustration des filles de Lucy, aussi.
Et on s'interroge sur ses choix. J'ai eu le sentiment, une fois libérée du poids de ses parents, à leur décès, que Lucy espérait enfin voler de ses propres ailes et ne plus agir et réagir en fonction d'eux. Simplement pour les fuir, pour se dire qu'elle peut faire mieux qu'eux... Mais, cette nouvelle étape m'a laissé une impression douloureuse, comme un nouveau repli sur elle-même.
"Je m'appelle Lucy Barton" est un roman à la construction particulière, non pas une structure linéaire, mais des allers et retour entre le passé, le présent, avec ces cinq jours comme pivot. Lucy semble jeter des souvenirs sur le papier comme ils viennent. Un peu comme des memento mori, peut-être même pour se persuader elle-même que tout cela est arrivé.
Le livre d'Elizabeth Strout n'est pas loin de jouer aussi sur la mise en abyme : Lucy Barton, après cette hospitalisation et cette intimité aussi inédite qu'éphémère avec sa mère, se mettra à l'écriture. On saura qu'elle s'est inspirée de ce qu'elle a connu pour ce premier texte, "l'histoire d'une mère qui aime sa fille. D'un amour imparfait. Parce que nous aimons tous d'un amour imparfait".
Ce n'est pas Lucy qui parle, mais un autre personnage que je vous laisse découvrir, peut-être ce qui se rapproche le plus d'un modèle pour elle qui n'en a jamais eu. C'est la fin d'une longue tirade pleine de réconfort, non seulement sur travail littéraire de Lucy, mais certainement bien au-delà. Pour elle, sa vie de tous les jours.
On retrouve dans ce livre un thème classique, celui de la transmission sur plusieurs générations, avec un personnage central, dans tous les sens du terme, que l'on voit d'abord fils ou fille de... avant de le retrouver père ou mère. Lucy, fille qui a souffert de l'absence d'amour de sa mère, devenue mère à son tour, et une mère aimant ses propres enfants d'un amour qu'elle sait imparfait.
C'est un beau personnage, que cette Lucy Barton, parce qu'elle est justement imparfaite. Parce que, malgré ses valeurs très positives, la tolérance qu'elle essaye d'appliquer en toutes circonstances, sa bonne volonté pour échapper au risque de commettre les erreurs qu'elle a subies, elle reste une anti-héroïne, avec ses doutes, sa naïveté et ses maladresses.
Mais aussi sa peur, j'insiste, le genre de frayeur qui paralyse. Ce livre, c'est aussi l'histoire d'une absence totale de sécurité, à tort ou à raison, qu'elle soit matérielle, sentimentale, professionnelle... Pourtant, c'est une coriace que l'on a devant nous. Mille fois elle aurait pu sombrer ou renoncer, mais, à chaque fois qu'elle a trébuché, elle s'est relevée, elle a repris sa marche en avant.
Elizabeth Strout nous habitue à ces personnages complexes, délicats, pas du tout flamboyants, ne suscitant pas forcément une empathie puissante. Des personnages avec des défauts, et pourtant, tellement riche. Son Pulitzer, elle l'avait obtenu pour "Olive Kitteridge", récemment adapté en mini-série par HBO, avec Frances McDormand.
Il y a certainement beaucoup de passerelles à établir entre Olive Kitteridge et Lucy Barton, toutes deux des femmes dont l'abord semblera difficile à beaucoup. Mais, les apparences sont très souvent trompeuses et, nous aussi, il nous faut apprendre à connaître avant de juger. Exactement l'un des messages forts de "Je m'appelle Lucy Barton".
Des Lucy Barton, nous en avons tous sûrement déjà rencontré, nous en connaissons sûrement tous, et probablement sans le savoir. Comment nous comportons-nous avec ces personnes blessées, en reconstruction permanente, prudentes et craintives, cherchant à donner le change, mais souffrant de toujours se sentir inférieur (et parfois, à raison, nous sommes souvent arrogants, même sans le vouloir).
Outre les émotions que l'on partage avec les personnages, outre ce combat que Lucy Barton livre contre elle-même, avant tout, il y a donc certainement des enseignements à tirer d'une telle lecture. Un récit exempt de pathos, de sensationnalisme, tout en pudeur, en jouant habilement sur les non-dits et en évitant de proposer un livre centré sur des règlements de comptes.
Et l'on termine cette lecture, qui s'achève sur une dernière page, un dernier chapitre symbole d'apaisement, en mesurant la chance que nous avons pu avoir de ne pas dépendre de la gentillesse des inconnus, mais d'avoir eu des parents aimants et capables de nous transmettre des valeurs, des clés pour affronter la vie. Une vie dans laquelle les inconnus et ceux que nous rencontrons sont loin d'être toujours gentils...
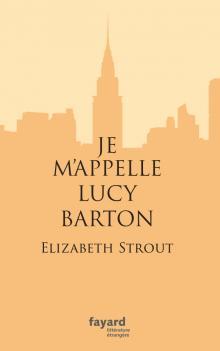
Au milieu des années 1980, Lucy Barton, narratrice de ce roman, a dû subir une intervention chirurgicale. On ignore de quoi elle souffrait exactement, mais on apprend que cela touche la région abdominale et qu'il y a eu quelques complications après l'opération. D'où une période difficile, une santé fragilisée et l'obligation de rester hospitalisée plus de deux mois.
Au cours de cette période, alors qu'elle n'est vraiment pas au meilleur de sa forme, qu'elle enchaîne les examens et que le médecin qui s'occupe d'elle redoute de devoir l'opérer une nouvelle fois, Lucy reçoit une visite pour le moins inattendue : celle de sa mère. Inattendue, parce qu'on comprend que cela fait des années que les deux femmes ne se sont pas vues, ni même parlé.
Pendant cinq jours et autant de nuit, la mère ne quitte pas le chevet de sa fille, veillant sur elle, dormant peu. Et, petit à petit, comme un moteur longtemps éteint qu'on essaye de relancer, la conversation s'instaure entre elles, cahotante, hésitante, pour parler de la pluie, du beau temps et du passé... Des échanges à fleurets mouchetés, se dit-on presque...
Alors, entre leurs discussions et les souvenirs qu'elles réveillent chez Lucy, celle-ci commence à raconter sa vie, depuis son enfance dans un coin perdu de l'Illinois, une petite ville noyée au milieu des champs de maïs, jusqu'à l'époque actuelle, où elle est devenue écrivaine et a choisi de bouleverser son existence de fond en comble.
De son passé, on découvre une famille extrêmement pauvre dans l'Amérique pourtant florissante de l'après-guerre. Une maison minuscule, branlante, sans aucun confort matériel. Une hygiène qui laisse à désirer et vaut à Lucy, son frère et sa soeur les moqueries et pires encore de la part des autres enfants et de certains adultes.
Une vie misérable qui, en soit, n'est déjà pas synonyme de départ idéal dans l'existence, mais qui s'accompagne d'autre chose. Précisément, ce ne sera jamais dit. Mais, on peut imaginer des violences de la part d'un père, ancien soldat lors de la IIe Guerre mondiale, revenu traumatisé du front. Et, peut-être pire encore que cela, ce que l'on comprend, c'est qu'il a fallu grandir dans l'indifférence de la mère.
C'est le point névralgique de cette histoire, cette relation, ou plutôt, cette absence de relation entre la mère et la fille. "Les mères sont censées protéger leurs enfants" : cette phrase est prononcée avec un détachement glaçant par la mère de Lucy, lors d'une de leurs conversations, dans cette chambre d'hôpital avec vue sur le Chrysler Building.
Elle le dit comme un constat, le constat de son incapacité à le faire. Et c'est dit sans regret, ni remords, un fait, clinique, simple... A-t-elle un jour aimé ses enfants ? La réponse n'est jamais clairement formulée, et l'on n'a pas franchement envie qu'elle le soit, tant on redoute sa nature... Ici, il ne s'agit pas d'absence d'instinct maternel, mais véritablement d'absence de sentiments...
On découvre, au fil des souvenirs, que Lucy est (et je vais mettre des guillemets) "la moins traumatisée" des trois enfants de la famille Barton. Sa soeur est animée par une inextinguible colère, tandis que son frère semble s'être muré dans une vie à part, une enfance éternelle, comme vidée de sa substance...
Si je mets des guillemets, c'est parce que tout le récit de Lucy va nous montrer qu'elle a gardé de cette enfance sans amour des séquelles profondes, dont elle voit les conséquences depuis toujours. Des séquelles qui marquent sa vie privée, sa relation aux autres, son travail et son écriture. Et, surtout, son rôle de mère, puisqu'elle aussi, à son tour, a donné naissance à des enfants.
Lucy, c'est une femme courageuse, mais rongée par un profond complexe d'infériorité (vous devez vous en douter, avec ce qui a déjà été dit) et surtout, une peur qui la ronge. Elle a grandi sans repère, elle a eu le courage de quitter très vite ce milieu familial délétère, elle a fait des choix, pas toujours heureux, elle a coupé les ponts pour se construire, sans véritable repère.
Avec un choix fondamental : fuir la petite ville où elle a grandi, mais pas pour aller n'importe où. A l'université, d'abord, pour laquelle elle obtiendra une bourse, découvrant l'indépendance, puis, à New York, ville immense, mégapole dans laquelle on peut se perdre, se fondre. Se rendre invisible. Mais, ça n'est pas la seule chose qui fait du choix de New York un élément important de ce roman.
"Je m'intéresse à la façon dont on peut se sentir supérieur à quelqu'un d'autre ou à un autre groupe de gens. Ca arrive partout, tout le temps. Quel que soit le nom qu'on donne à ce besoin de trouver quelqu'un à rabaisser, je le considère comme ce qu'il y a de plus vil en nous", écrit ainsi Lucy Barton dans son témoignage.
Elle a été sujette de ces moqueries, de situations humiliantes, pas toujours volontaires, ce qui est encore plus blessant, parfois, et elle s'est construite en fonction de cela. Tout n'a pas été aussi évident que j'ai l'air de le dire, il lui a fallu apprendre, simplement apprendre à connaître l'autre, à nouer des relations sociales sans qu'on lui en ait inculqué le mode d'emploi...
Mais, instinctivement, elle a toujours cherché à respecter les autres, quels qu'ils soient. Elle se montre choquée par la hauteur et l'arrogance de certaines personnes, qui n'ont pas conscience des blessures que leurs mots, leurs gestes infligent aux autres. Et, de la même manière, elle reconnaît celles et ceux qui ont souffert des mêmes maux qu'elle.
Et pourtant, malgré les années qui ont passé, jamais elle n'a pu se défaire de cette peur, que l'on ressent d'un bout à l'autre du livre. La peur de celle qui joue les funambules, marchant sur un fil, en sachant qu'il n'y aura pas de filet pour amortir sa chute. La peur de mal faire, de blesser, de ne pas être à la hauteur, de souffrir...
Une peur qui rejaillit lorsque Lucy devient à son tour épouse et mère de famille. Elle l'est déjà au moment de l'hospitalisation, mais c'est avec le recul qu'elle se posera des questions. Il y a quelque chose de troublant, dans cet aspect du livre : sans reproduire un modèle familial, on ressent toutes les imperfections, toute la frustration des filles de Lucy, aussi.
Et on s'interroge sur ses choix. J'ai eu le sentiment, une fois libérée du poids de ses parents, à leur décès, que Lucy espérait enfin voler de ses propres ailes et ne plus agir et réagir en fonction d'eux. Simplement pour les fuir, pour se dire qu'elle peut faire mieux qu'eux... Mais, cette nouvelle étape m'a laissé une impression douloureuse, comme un nouveau repli sur elle-même.
"Je m'appelle Lucy Barton" est un roman à la construction particulière, non pas une structure linéaire, mais des allers et retour entre le passé, le présent, avec ces cinq jours comme pivot. Lucy semble jeter des souvenirs sur le papier comme ils viennent. Un peu comme des memento mori, peut-être même pour se persuader elle-même que tout cela est arrivé.
Le livre d'Elizabeth Strout n'est pas loin de jouer aussi sur la mise en abyme : Lucy Barton, après cette hospitalisation et cette intimité aussi inédite qu'éphémère avec sa mère, se mettra à l'écriture. On saura qu'elle s'est inspirée de ce qu'elle a connu pour ce premier texte, "l'histoire d'une mère qui aime sa fille. D'un amour imparfait. Parce que nous aimons tous d'un amour imparfait".
Ce n'est pas Lucy qui parle, mais un autre personnage que je vous laisse découvrir, peut-être ce qui se rapproche le plus d'un modèle pour elle qui n'en a jamais eu. C'est la fin d'une longue tirade pleine de réconfort, non seulement sur travail littéraire de Lucy, mais certainement bien au-delà. Pour elle, sa vie de tous les jours.
On retrouve dans ce livre un thème classique, celui de la transmission sur plusieurs générations, avec un personnage central, dans tous les sens du terme, que l'on voit d'abord fils ou fille de... avant de le retrouver père ou mère. Lucy, fille qui a souffert de l'absence d'amour de sa mère, devenue mère à son tour, et une mère aimant ses propres enfants d'un amour qu'elle sait imparfait.
C'est un beau personnage, que cette Lucy Barton, parce qu'elle est justement imparfaite. Parce que, malgré ses valeurs très positives, la tolérance qu'elle essaye d'appliquer en toutes circonstances, sa bonne volonté pour échapper au risque de commettre les erreurs qu'elle a subies, elle reste une anti-héroïne, avec ses doutes, sa naïveté et ses maladresses.
Mais aussi sa peur, j'insiste, le genre de frayeur qui paralyse. Ce livre, c'est aussi l'histoire d'une absence totale de sécurité, à tort ou à raison, qu'elle soit matérielle, sentimentale, professionnelle... Pourtant, c'est une coriace que l'on a devant nous. Mille fois elle aurait pu sombrer ou renoncer, mais, à chaque fois qu'elle a trébuché, elle s'est relevée, elle a repris sa marche en avant.
Elizabeth Strout nous habitue à ces personnages complexes, délicats, pas du tout flamboyants, ne suscitant pas forcément une empathie puissante. Des personnages avec des défauts, et pourtant, tellement riche. Son Pulitzer, elle l'avait obtenu pour "Olive Kitteridge", récemment adapté en mini-série par HBO, avec Frances McDormand.
Il y a certainement beaucoup de passerelles à établir entre Olive Kitteridge et Lucy Barton, toutes deux des femmes dont l'abord semblera difficile à beaucoup. Mais, les apparences sont très souvent trompeuses et, nous aussi, il nous faut apprendre à connaître avant de juger. Exactement l'un des messages forts de "Je m'appelle Lucy Barton".
Des Lucy Barton, nous en avons tous sûrement déjà rencontré, nous en connaissons sûrement tous, et probablement sans le savoir. Comment nous comportons-nous avec ces personnes blessées, en reconstruction permanente, prudentes et craintives, cherchant à donner le change, mais souffrant de toujours se sentir inférieur (et parfois, à raison, nous sommes souvent arrogants, même sans le vouloir).
Outre les émotions que l'on partage avec les personnages, outre ce combat que Lucy Barton livre contre elle-même, avant tout, il y a donc certainement des enseignements à tirer d'une telle lecture. Un récit exempt de pathos, de sensationnalisme, tout en pudeur, en jouant habilement sur les non-dits et en évitant de proposer un livre centré sur des règlements de comptes.
Et l'on termine cette lecture, qui s'achève sur une dernière page, un dernier chapitre symbole d'apaisement, en mesurant la chance que nous avons pu avoir de ne pas dépendre de la gentillesse des inconnus, mais d'avoir eu des parents aimants et capables de nous transmettre des valeurs, des clés pour affronter la vie. Une vie dans laquelle les inconnus et ceux que nous rencontrons sont loin d'être toujours gentils...
