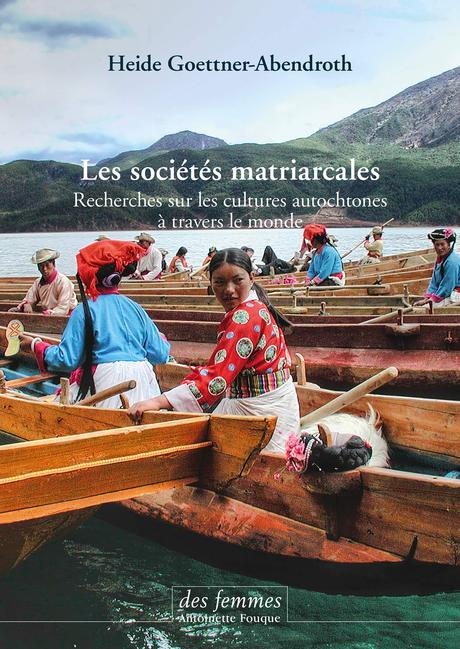
Sur les problèmes que pose le mauvais travail anthropologique de Heide Goettner-Abendroth, tout a été dit dès les années 1990, par exemple dans cet article de Beate Wagner-Hasel. Pourtant les éditions des femmes-Antoinette Fouque ont dépensé beaucoup pour mettre sur toutes les devantures de librairies ce beau livre, Les Sociétés matriarcales. Vitupérer à longueur de chapitre contre « cette institution répressive qu’est l’université » (p. 12), dénoncer un complot collectif contre sa thèse (p. 35) et accuser toutes les chercheuses en désaccord avec elle de compromissions avec le patriarcat : cette tonalité véhémente trouve donc encore un public en 2019.
La thèse : les femmes avaient le pouvoir dans le monde entier, il y a trois mille ans de cela : mais un beau jour, le matriarcat a été violemment abattu par les hommes. Toute l’anthropologie s’oppose à cette thèse défendue en 1861 par J. Bachofen, mais cela est dû seulement « à la manipulation et aux jeux de pouvoir » au sein de l’université (p. 68), veut croire H. Goettner-Abendroth.
Le sociétés matriarcales sont celles où tout se passe bien. En particulier, le sexe y est toujours consentant. Les femmes Garo du Nord-Est de l’Inde voient leur conjoint amené pieds et poings liés par leurs frères (p. 88), mais on vous prie de croire que l’un et l’autre consentent à ce procédé. Car rien, dans ces sociétés, ne passe « jamais par la force » (p. 90), ce qui est dû au fait que « le véritable pouvoir appartient aux femmes » (p. 268), sans qu’on n’apprenne jamais ce que l’autrice entend par « véritable pouvoir ».
Les sociétés identifiées comme matriarcales par l’autrice (sans que cette notion ne soit jamais définie en termes anthropologiques) se ressemblent toutes, et le livre est incroyablement ennuyeux. Plutôt qu’une argumentation, on assiste dans ce livre à une véritable litanie, dont l’itérativité tente de compenser l’absence de logique. Si l’on s’attache aux raisonnements, ils sont en effet boiteux. « Femme » et « déesse » sont le même mot en langue Khasi de l’Inde (p. 105) : l’autrice y voit la preuve que toutes les femmes ont les mêmes pouvoirs qu’une déesse, ignorant que la galanterie est parfois l’écrin de l’oppression. Dans la vallée de Katmandou, le sacrifice des animaux mâles « excédentaires » à la déesse Kali est prise pour preuve que la « femelle ne serait jamais sacrifiée » dans la société matriarcale (p. 112), et non pas simplement que les mâles sont souvent superfétatoires dans une ferme. Lorsque l’ethnographie atteste d’un partage des pouvoirs et d’une filiation cognatique dans les sociétés que l’autrice déclare matriarcales, il lui suffit de supposer que le pouvoir des hommes ne sert qu’à « aider » les femmes dans leurs grandes responsabilités (p. 469).

Et puisque l’université est patriarcale, elle nous a caché bien des scoops. Les Moae de l’île de Paques sont les signes du pouvoir des femmes (p. 255) ; les Amazones ont vraiment existé (p. 277)… Le livre d’Heide Goettner-Abendroth cherche à éblouir plutôt qu’à convaincre.
Dans Un Destin français, Éric Zemmour voir dans la France d’après François Ier (roi « efféminé ») une longue et pénible décadence. Les Sociétés matriarcales que nous donnent les éditions des femmes en cette rentrée littéraire a exactement la même méthode, à partir d’a priori inverses. « Les combinaisons de formes matriarcales et patriarcales ne sont pas une réussite » (p. 416), généralise H. Goettner-Abendroth : il y a bien pour elle deux camps incompatibles. Pour ce qui est de l’honnêteté intellectuelle, ces deux camps se valent bien.