 Barry Cohen a une vie que plusieurs pourraient trouver enviable. Ce gestionnaire de fonds spéculatifs de quarante-trois ans, multimillionnaire, vit dans une luxueuse tour de Manhattan avec sa femme indienne de vingt-neuf ans et leur fils de trois ans. Sans oublier la nounou philippine!
Barry Cohen a une vie que plusieurs pourraient trouver enviable. Ce gestionnaire de fonds spéculatifs de quarante-trois ans, multimillionnaire, vit dans une luxueuse tour de Manhattan avec sa femme indienne de vingt-neuf ans et leur fils de trois ans. Sans oublier la nounou philippine! 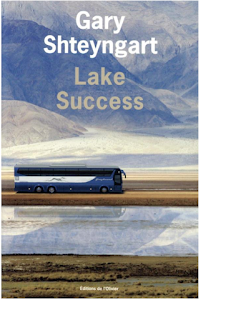 Mais voilà, tout n’est pas rose pour autant. Barry a les autorités boursières sur les talons, son mariage est en train de capoter et son fils vient d’être diagnostiqué du spectre de l’autisme. Sur un coup de tête, il descend de sa tour d’ivoire, claque la porte (mais n’oublie pas sa valise de montres de luxe) et part «affronter le monde et résoudre seul ses problèmes». Il file, en pleine nuit, à la gare routière de Port Authority. Après quelques rebondissements dignes de Kafka, il monte à bord d’un bus Greyhound. (Il faut souligné l’effort: habitué qu’il est de voyager en première classe, il va se mêler à la populace des sièges de bus.) Barry espère surtout retrouver Layla, son amour de jeunesse. Le v’la parti pour une virée à travers les États-Unis, à la rencontre du «vrai monde». Il jette son téléphone portable et sa carte de crédit noire. Il doit compter avec l’argent qu’il a en poche – sans oublier sa valise de montres! Il retourne dans les bras du passé plutôt que d’affronter le présent.
Mais voilà, tout n’est pas rose pour autant. Barry a les autorités boursières sur les talons, son mariage est en train de capoter et son fils vient d’être diagnostiqué du spectre de l’autisme. Sur un coup de tête, il descend de sa tour d’ivoire, claque la porte (mais n’oublie pas sa valise de montres de luxe) et part «affronter le monde et résoudre seul ses problèmes». Il file, en pleine nuit, à la gare routière de Port Authority. Après quelques rebondissements dignes de Kafka, il monte à bord d’un bus Greyhound. (Il faut souligné l’effort: habitué qu’il est de voyager en première classe, il va se mêler à la populace des sièges de bus.) Barry espère surtout retrouver Layla, son amour de jeunesse. Le v’la parti pour une virée à travers les États-Unis, à la rencontre du «vrai monde». Il jette son téléphone portable et sa carte de crédit noire. Il doit compter avec l’argent qu’il a en poche – sans oublier sa valise de montres! Il retourne dans les bras du passé plutôt que d’affronter le présent.Une trentaine de pages lues et ça y était: je détestais Barry. Sa lâcheté, sa naïveté, sa maladresse, sa condescendance. Je n’ai pas eu pour lui une once de compassion. Je l’ai trouvé pathétique. Même sa fuite est pathétique.Les autres personnages ne sont pas en reste, quasiment tous aussi irritants les uns que les autres. Pas seulement Barry. Sa femme, aussi. Chacun à leur manière fuit: Barry à bord d’un bus, sa femme dans les bras d’un écrivain guatémaltèque. Chacun fait du déni.En fait, seuls les moins nantis ont eu grâce à mes yeux!
Le manque de consistance des personnages secondaires m’a aussi agacée. Leur manque de relief est stupéfiant. Ils me sont apparus comme des accessoires, servant de faire-valoir.La façon qu’a Gary Shteyngart de beurrer épais sur les clichés (les méchants riches / les pauvres au grand cœur) a fini par me tomber sur les nerfs. Sans parler de ces situations qui me sont apparues invraisemblables. Une parmi d’autres: comment un homme issu d’un milieu modeste (son père nettoyait les piscines des riches)peut-il être à ce point déconnecté de la réalité?Je me suis tout de même rendue jusqu’au bout. D’abord parce que je voulais voir jusqu’où ça menait. Et aussi parce que les mots de Gary Shteyngart étaient plutôt bien tournés, assez pour me retenir.Je me rends compte à quel point les petites misères existentielles des gens riches me hérissent le poil. Quand tu te balades avec une collection de montres de luxe, que tu bois une bouteille de whisky à 33 000 $ US… Au final, même avec une roche de crack dans les poches, les pérégrinations de Barry ne lui ont rien appris. C’en était désespérant.
C’était supposé être satirique? La satire manquait définitivement d’épaisseur et de panache. Un roman beaucoup trop suffisant à mon goût.
Lake Success, Gary Shteyngart, trad. Stéphane Roques, De l’Olivier, 380 pages, 2020.
★★★★★

