En 2017, le produit intérieur brut de la Chine a dépassé celui des États-Unis : elle promettait d’écrire le destin du monde, mais on n’aurait pas imaginé qu’elle s’y prenne si vite et si fort qu’en ce printemps 2020. Pourtant, au nouvel an, j’avais pris la résolution de lire des romans chinois : je profite du confinement pour vous en présenter un, et peut-être d’autres à l’avenir.
Bien loin des centres urbains surpeuplés et malades, dans un froid sibérien qui accueille chaque année le festival de sculpture sur glace et neige, s’étend la province chinoise du Heilongjiang, la plus au nord-est de la Chine. La romancière Chi Zijian y a vu le jour, et s’y est installée après des études à Beijing. Ses romans et ses nouvelles ont rencontré un succès international ; ce sont les éditions Picquier qui ont pris en charge de les faire découvrir au public francophone, à partir de 2013.
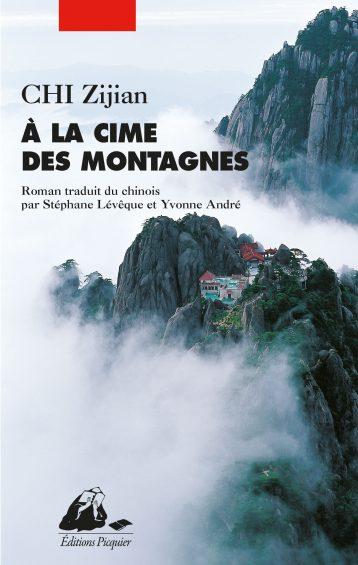
Comme disait l’écrivain autrichien Joseph Roth, la vérité d’un pays apparaît dans ses confins, et non dans ses centres. Le roman de Chi Zijian explore une petite localité frontalière de la Russie, la ville de Longzhan, dans laquelle vivent plusieurs familles aux richesses et aux histoires diverses et entremêlées, comme il convient à une société communautaire.
Dans cette société solidement familiale, un scandale arrive. Un fils adoptif commet un grand crime. Quelle drôle de vie ce doit être aussi, d’être fils adoptif venu d’une région lointaine, dans une campagne où la famille est presque la seule institution sensible au quotidien ! Le roman répare cette incongruité lorsqu’il nous apprend la véritable naissance du criminel, vers la trois centième page : à partir de ce moment-là, tout commence à rentrer dans l’ordre.
Le point d’équilibre de l’ordre social est le destin de tout roman qui se plongerait dans un petit milieu communautaire, parce qu’in fine, et l’alcool aidant, tout se sait ; chacun peut accuser les tares d’autrui pour se défendre des siennes. « – Si à l’avenir tu manques encore une fois à la parole donnée à une femme, ce ne sera pas ton tofu que je flanquerai par terre, ce sera toi ! – Peuh ! Mon salaud, pour qui tu te prends ? Tout le monde sait que tu as couché pendant des années avec une femme dont le mari était paralysé » (p. 360). À mesure que les intrigues se tissent et se croisent, ce genre de dialogues devient inévitable.
Si vous cherchez à en apprendre plus sur le mode de pensée traditionnel chinois, ce roman sera probablement décevant. Tout juste apprend-on que les Japonais sont haïs, que la beauté consiste à avoir la peau la plus claire possible, et qu’on met une écharpe rouge sur la porte des maisons où une femme vient d’avoir un enfant. Par certains aspects, le monde rural est le même partout : bourru et taiseux, mais généreux et solidaire, comme ces agriculteurs qui approvisionnent le boucher en herbe déodorante, sans le prévenir, venant seulement rehausser son tas dans un coin, par bonté d’âme (p. 168). La stupidité de gouvernements corrompus et pollueurs n’aura rien d’exotique pour un lecteur francophone ; tout juste serons-nous étonnés, ou émus, de la résistance farouche que leur oppose le maire de la ville, attaché à ses paysages.
Tout de même, certains traits de style surprennent. Prenez le mariage comme comparant : « L’habitation du boucher et l’abattoir étaient liés comme le sont épouse et concubine » (p. 167) ; « un objet échangé, c’est comme la fille que l’on marie : il ne vous appartient plus » (p. 239). Ou encore, l’expression topique du remords : « il se donna une gifle » (p. 273 et ailleurs). Les deux dernières pages, fortement allégoriques, font des quatre cents qui précèdent un chef-d’œuvre : malgré tous les efforts de vertu et le retour à l’ordre, le crime se répète comme une fatalité.
Ailleurs, les avis de : Lire pour le plaisir, Voyageons-autrement, PatiVore et L’Express.
Chi Zijian, À la cime des montagnes, trad. Stéphane Lévêque et Yvonne André, éditions Picquier, 2019, 464 p., 22,50 €.

