L’écrivain Kateb Yacine disait de la langue française en Algérie qu’elle était son « butin de guerre » des algériens. Pourtant, le français y perd du terrain. Les universités l’abandonnent pour l’anglais. Une meilleure connaissance historique de la guerre d’Algérie a résolument plombé l’image de la France, des deux côtés de la Méditerranée. Ici comme ailleurs, Macron joue à jeter de l’huile sur le feu.
Dans un cas comme celui-là, bien de la littérature est requise si l’on veut se rendre capable de saisir humainement le point de vue d’outre-Méditerranée. C’est ce que fait l’auto-fiction d’une descendante de harkis, Alice Zeniter, dans L’Art de perdre (2017). Le roman nous transporte dans un village des montagnes algériennes, d’où la France nous apparaît différemment. « La France, depuis le village de la crête, n’était ni terrifiante ni inconnue. Elle n’était pas vraiment l’étranger et encore moins el ghorba, l’exil. Les ministres français avaient affirmé les uns après les autres que pendant les années du conflit que l’Algérie, c’était la France, mais la phrase fonctionnait en sens inverse pour la plupart des villageois. La France, c’était l’Algérie » (p. 173).
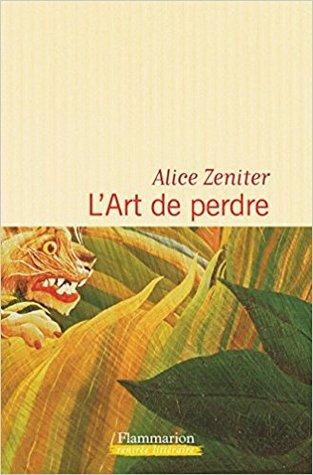
L’Art de Perdre représente la saga familiale d’un pays perdu, depuis la décolonisation jusqu’au terrorisme. Naïma, petite-fille de harkis, née en Normandie, part sur les traces de son grand-père Ali et de son père Hamed, « immigré de génération un et demie », comme disent les démographes. Lorsqu’elle voit apparaître Alger à l’horizon du ferry, Naïma comprend que « ça ne commence pas par l’Algérie. Ou plutôt si, mais ça ne commence pas par Naïma » (p. 13) ; car l’immigration a ceci de commun avec la passion amoureuse qu’elle donne le sentiment de dépasser l’individu. Parce qu’elle nous dépasse, notre identité nous bouleverse : quel désarroi dans le regard du petit Omar lorsqu’il découvre qu’il n’est pas Arabe mais Berbère (p. 38), sans comprendre au juste ce que cela implique ! Une mémorable expression concentrée des tiraillements de l’identité se trouve ainsi à la fin du voyage initiatique de Naïma en Algérie : « Elle ne veut plus partir d’ici. Elle veut absolument rentrer chez elle » (p. 494).
L’aspect historique de ce livre-événement a été très largement commenté. Ajoutons-y deux remarques littéraires. La première, que la littérature française d’aujourd’hui n’est jamais meilleure que lorsqu’elle rend compte de l’histoire mondiale de la France. L’une des pages les plus émouvantes est celle où Naïma retrouve les traits de son visage dans ceux des enfants d’un village kabyle, à peine accessible en pick-up (p. 477). Autre moment de proximité internationale, en France cette fois : un tenancier de bar raciste appelle la police pour chasser Ali, harki rapatrié, de son comptoir. Mais le policier reconnaît sur le torse d’Ali sa médaille d’ancien combattant de la bataille de Monte Cassino et lui paye un verre, après avoir copieusement enguirlandé le barman (p. 208).

La seconde que, lectrice attentive de Beauvoir, Alice Zeniter est fascinée par les prises d’autonomie. La sienne, acquise en tant qu’élève de l’ENS de la rue d’Ulm, où elle put écrire du théâtre en étant financée durant quatre ans, fut à ses yeux idéale. Celle de l’Algérie, au contraire, est brutale et sans transition : l’Algérie est « un pays sans adolescence » (p. 59). Le titre L’Art de perdre, emprunté à un poème d’Elizabeth Bishop, décrit bien la difficulté de perdre un ancien département français, voire surtout (pour les harkis) d’accepter de perdre le pays perdu.
Voir ailleurs : une interview sur France Culture, une autre dans le podcast La Poudre, la déception d’Élisabeth Philippe dans le Nouvel Obs et celle du Figaro, et la très longue et complète critique de Diacritik.
Alice Zeniter, L’Art de perdre, Flammarion, 2017, 512 p., 22€ (il est paru en poche, éd. J’ai lu, 600 p., 8,50€).

