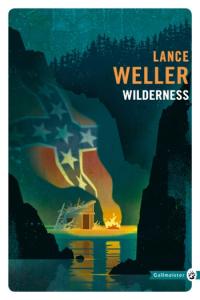 Wilderness
Wilderness
Lance Weller
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par François Happe
Gallmeister
2013
2017 pour l’édition poche
347 pages
« Ce n’était pas du tout un homme qui était étendu là, une balle dans le ventre et en train de mourir dans la terre meuble devant le remblai, mais un garçon de quatorze ou quinze ans. Il portait une veste yankee et il était allongé, les jambes remuant faiblement dans son pantalon trempé d’urine. Sous lui, le sol était rouge et les mains qu’il gardait sur sa blessure au ventre étaient les mains d’un enfant. »
Le roman s’ouvre en 1965 dans la chambre d’une maison de retraite. Une femme se réveille d’un rêve de feu de camp et de bois flotté, elle se souvient du vieil homme, son second père, celui qui l’a porté dans la neige, enveloppée dans son grand manteau. Ce chapitre, on le relit à la fin, parce que maintenant, on sait, la boucle est bouclée et on veut retrouver les indices, les objets, les personnages qui n’évoquaient alors pas grand-chose dans notre esprit. Oh ce bonheur de se replonger dedans, comme dans un vieux vêtement confortable.
Le vieil homme n’a pas toujours été vieux bien sûr, et les chapitres alternent entre l’année 1899 (l’année de sa mort) et l’année 1864 (celle de la terrible bataille de Wilderness pendant la guerre de Sécession).
Abel Truman est hanté par cette guerre, il ne s’en est jamais remis, physiquement puisqu’il a un bras inutilisable, et moralement. Il vit dans une cabane au bord de l’océan Pacifique, avec un chien, son unique compagnon. Le traumatisme de la guerre cache un autre traumatisme plus ancien qui sera révélé par bribes au fil du texte. Abel combat aux côtés des confédérés mais il aurait aussi bien pu se battre au sein de l’armée de l’Union. Il n’était nullement convaincu par la cause.
Ce roman fait passer par une foule de sensations différentes, suscite des émotions diverses et contrastées, il est d’une puissance prodigieuse. Il y a des passages difficilement soutenables, d’autres émotionnellement très forts, d’autres d’une incroyable tendresse, d’autres qui se perdent dans les méandres d’une nature magnifiée. On ne se repose pas dans ce livre, on vit, on partage le froid, la douleur, les coups, et même le réconfort des poils chauds du chien, avec le vieil homme.
Brinquebalé au gré des marches du personnage, au gré du vent dans les branches, au son des vagues, le lecteur se sent happé malgré lui par les mots de l’auteur. La langue, parfois lyrique, révèle la beauté de la nature au sein de laquelle l’homme se révèle être un animal sauvage. Dans un style plutôt descriptif qui travaille l’art du détail, l’auteur donne à ses mots un pouvoir visuel important.
Le rythme lent amplifie la tension et permet à l’auteur de laisser le lecteur réfléchir sur l’horreur de la guerre, sur la violence de l’homme, sur les raisons de se battre. Abel se souvient avec précision de l’un ou l’autre de ses compagnons d’armes, il nous livre des précisions importantes qui font de ces êtres broyés par la guerre des êtres vivants avec leur histoire, et non de la simple chair à canon. Des images perdurent dans l’esprit du lecteur, des entrailles jaillissantes et des glaires sanguinolentes au milieu de chemises colorées cousues par une mère aimante.
Le chapitre 6, le plus puissant du roman, se termine sur ces mots : « Près d’Henry Schwartzenbach, Abel Truman serra le poing droit, le porta à sa bouche et se mit à pleurer. » Et nous lecteurs, nous serrons les dents, nous fermons les yeux et posons le roman, exténués et ravagés par l’écriture impitoyable de ce chapitre.
Un grand beau roman qui, une fois refermé, continue à creuser son sillon en nous. Il est rare que je fasse cela, mais ce livre, je l’ouvre régulièrement à n’importe quelle page et je relis des passages, je me replonge dedans le temps d’un bain rapide, un bain de mots, un bain de sang, un bain de littérature.
J’ai lu ce livre grâce à Ingannmic avec qui j’ai eu le plaisir de faire cette lecture commune.