Le 3 mars 2021 sortira le prochain ouvrage de Fatou Diome, De quoi aimer vivre, un recueil de courts récits d’amour entre le Sénégal et Strasbourg, ville où elle vit depuis 1994. Autant dire qu’il me restait peu de temps pour écrire une chronique de son dernier roman Les veilleurs de Sangomar, qui dormait sur mon bureau depuis la rentrée littéraire… 2019 !
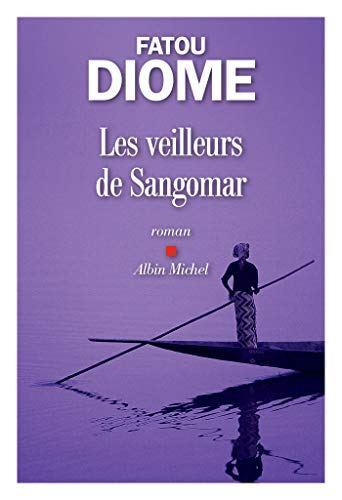
La jeune Coumba, habitante d’une île des rivages sénégalais, vient de perdre son mari Bouba dans le naufrage du Joola, en 2002. La nuit, lorsque sont enfin passées les visites quotidiennes de voisins et amis compatissants, elle s’adonne à son chagrin, les yeux rivés sur la pointe de Sangomar où, selon la tradition sérère, se rassemblent les djinns et les âmes des défunts. Commencent alors plus de trois cent pages d’une sublime plainte ininterrompue, lyrique et inventive, douce et nocturne. « Car, trépignant devant le mur des Lamentations à Jérusalem, implorant la Sainte Marie jusqu’à Rome ou psalmodiant l’Ikhlas jusqu’à La Mecque, les éprouvés conjurent le même sombre ciel. Un ciel qui, certes, leur tombe sur la tête, mais les réunit également » (p. 19). Ce long deuil intransigeant est-il une sorcellerie, comme le soupçonnent les femmes de l’île ? Peut-être, mais une sorcellerie joyeuse.
En effet, voyez-vous, Coumba a une fille, Fadikiine. Bouba est parti à jamais, et la vie continue : la plainte dit ce scandale, l’admet, le travaille. Ce n’est pas à un traumatisme irrémédiable que l’on assiste, mais bien à une culture du deuil (j’aimerais offrir ce livre à ceux qui croient qu’on doit fermer les théâtres par temps de pandémie). Au passage, on rencontrera donc certaines vérités intimes de la culture sénégalaise, par exemple : « Féminisme ou pas, la polygamie perdure parce que les mères possessives préfèrent voir leur fils en chef de harem, intraitable chef de meute, plutôt qu’heureux, avec une seule princesse régnant dans son cœur, loin des griffes de Maman » (p. 286). Comme à son habitude, Fatou Diome nous offre un livre réconciliateur et égalitariste : « Certes, l’identification influe sur le degré de compassion, mais la différence de leurs robes n’empêche pas les vaches de se reconnaître dans leur pré » (p. 88).
On pourrait croire que les plaintes sont vaines, que la douleur est incommunicable. Peut-être, mais si ce n’était pas le cas ? Et si, au contraire, l’on vivait pour se plaindre et pour lire des plaintes ? « Je choisis cette hypothèse : au moins, elle nous gardera en veille », dit une amie de Coumba (p. 245). Ce qui fait « aimer vivre », ce ne sont pas les rodomontades satisfaites des rapeurs-stars sur leurs richesses matérielles, mais la beauté qui vient parfois de la douleur d’une misérable veuve, lorsqu’elle s’étire durant tout un roman inventif et douloureusement joyeux, digne hériter de l’humour triste d’un Tristram Shandy. Appliquons à Fatou Diome sa propre formule sublime : « sur l’île, les femmes ne récoltaient pas que des fruits de mer, elles rapportaient aussi les fruits de leur imagination » (p. 41).
Voir les interviews pleines de punch de Fatou Diome dans Le Monde, France 24 et France Inter.
Fatou Diome, Les veilleurs de Sangomar, Albin Michel, 336 p., 19,90€, 2019.

