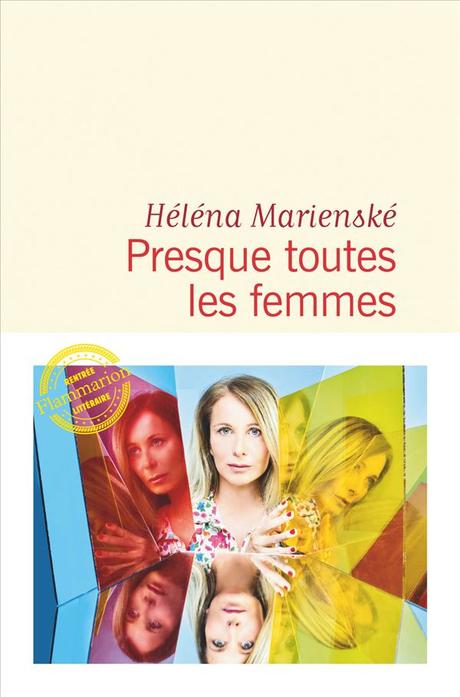
En deux mots
Une première expérience amoureuse avec une copine de classe va donner à la petite Nathalie l’envie d’explorer sa sexualité, aussi bien avec les hommes qu’avec les femmes. Une liberté qu’elle va assumer au fil des ans, mais qui va aussi lui causer bien des problèmes, avec sa famille et avec ses conquêtes.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
«L’amour a tellement de visages»
Héléna Marienské a décidé de tout dire, de ne rien cacher de sa vie amoureuse. Son autobiographie est, au-delà du récit de ses multiples rencontres amoureuses, un plaidoyer brûlant pour la liberté que les hétéros et les homos rejettent.
«Ça ne va pas être simple, cette vie. Pas simple à raconter non plus. Moi qui mens toujours, par réflexe pavlovien pour échapper à l’inquisition maternelle, mais aussi par habitude acquise et cultivée — jeu, amour de la fiction — comment dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité je le jure?» Nous voilà prévenus d’entrée, l’histoire ou plutôt les histoires qui font cette autobiographie sont passées au tamis de la littérature, de l’envie de donner une cohérence à un parcours, mais aussi d’offrir une belle perspective, celle d’une femme libre.
Pour la narratrice — qui s’appelle Nathalie Galan et deviendra Héléna Marienské — il aura fallu franchir bien des obstacles pour parvenir à s’émanciper et à oser tout dire, avec une bouleversante sincérité.
C’est vers sept ans, du côté de Montagnac, que la fillette découvre avec son amie Ange comment fonctionne son corps. Une première expérience de la sensualité qui est un encouragement à poursuivre cette exploration. À quinze ans, elle fait l’amour avec Claudine et comprend très vite combien les sentiments peuvent être fluctuants. Quand elle revient d’un séjour à Londres, où elle a trompé son exil en se jetant sur les fish and chips, les pizzas et les rhubarb pies, Claudine ne veut plus d’elle. La « grosse » se rabat alors sur les hommes, mais sans pour autant s’y attacher. Ce n’est que quatre ans plus tard, en arrivant à Paris, qu’elle retrouvera les bras d’une jeune femme, Albertine. Mais là encore, la liaison sera brève. Alors, elle navigue à vue. Sa vie amoureuse est un chaos, du coup elle se tourne vers une analyste lacanienne orthodoxe, Mme Michelangeli. Car son bilan est peu reluisant: « J’ai épousé en premières noces, à vingt ans, un amateur de nymphettes, Daniel. Il a l’âge de mon père mais lorsque je rencontre Michelangeli, je suis à vingt-trois ans déjà une vieille chose à ses yeux. À qui parler? J’ai rompu en visière avec mes parents, je n’ai aucune amie. Je veux divorcer et comme mon époux me complique la tâche, je multiplie les aventures — c’est l’époque merveilleuse de l’insouciance pré-sida. J’ai arrêté mes études et je n’ai aucun métier. » La psy lacanienne va réussir à mettre un peu d’ordre dans ce capharnaüm sentimental, éloigner les relations toxiques et faire entrer sa patiente dans un cercle vertueux. Elle trouve l’homme idéal, se marie, donne naissance à deux filles merveilleuses et connait vingt ans de bonheur. Un bonheur qui se dédouble grâce à la littérature qui va provoquer le réveil de la belle endormie. Albertine a publié un livre dans lequel elle raconte leur rencontre et évoque un regret. Il n’en faut pas davantage pour que Nathalie éprouve la nécessité de la revoir. La passion est toujours là, mais Albertine n’entend pas bouleverser sa vie. Elle se consolera alors avec Coline, avec qui elle va partager sa vie et son petit chien. Ce dernier, qu’elle promène dans le Marais, va lui permettre de faire bien des rencontres, d’engranger de nouvelles expériences. Jusqu’à excéder Coline qui la renvoie. La traversée du désert qui suit sera de courte durée. Jusqu’au jour où elle croise Naomi. « Je ne maîtrisais plus rien. J’aimais à quarante-cinq ans d’un amour adolescent. Naomi était rodée aux histoires de cœur et de corps avec les femmes, tandis que je les découvrais avec émerveillement. Albertine avait été inaccessible, je m’étais comportée comme une idiote avec Coline, mais cette fois, j’aimais. J’aimais et voulais vivre avec Naomi un amour complet. Je le désirais avec frénésie: j’avais à nouveau dix-sept ans, l’appétit de plaisirs et des effusions sentimentales qui vont avec. Cristallisation, idéalisation, aveuglement amoureux tout ensemble. Égarements du cœur et de l’esprit. »
Las, cette histoire prendra fin comme les précédentes. Avant que de nouvelles rencontres ouvrent la voie à de nouvelles relations. Cet amour non-exclusif des femmes est raconté, entrecoupé de souvenirs d’enfance, d’une carrière à la télévision commencée par hasard en tant que coco girl et abrégée après un étonnant tournage en ex-Yougoslavie qui va tourner au fiasco, les années d’études supérieures et celles d’enseignante ou encore les figures familiales qui ont marqué la romancière. À la clé de cette autobiographie, le souci de tout dire, de se livrer, de plaider pour davantage de tolérance et d’ouverture d’esprit, y compris chez les gays et les lesbiennes. Car, comme les hétéros, c’est d’abord leur propre pré carré qu’ils entendent défendre, refusant de partager leur sexualité.
Depuis Fantaisie-Sarabande et Les ennemis de la vie ordinaire, Héléna Marienské avait ouvert la voie. Avec Presque toutes les femmes, elle parachève son plaidoyer d’une plume aussi libérée qu’elle-même.
Presque toutes les femmes
Héléna Marienské
Éditions Flammarion
Roman
465 p., 22 €
EAN 9782080257932
Paru le 25/08/2021
Où?
Le roman est situé en France, à Paris, en venant de Pézenas, Béziers et Montpellier ou encore des villages de l’enfance, à Montagnac, Nissan-lez-Ensérune, Terre-Rousse, Poussan, Saint-Thibéry. On y fait régulièrement la navette entre Paris et l’Auvergne. On y passe aussi des vacances à Kavala, Thassos, Salamanque, Londres. Pour un tournage, on se rend en ex-Yougoslavie, à Ada Bojana, en passant par Zagreb et Dubrovnik. On y enseigne à Montreuil, Bobigny, Émerainville et Saint-Flour.
Quand?
L’action se déroule de nos jours, avec des retours en arrière jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle.
Ce qu’en dit l’éditeur
«Une dépression sévère, il y a deux ans. Un chagrin sans fond m’avait emplie toute, qui me clouait au lit. Étrangement, lorsque je me suis redressée, mon premier désir a été de terminer le texte que je peaufinais depuis des années : un récit intime centré sur les femmes de ma vie. Tout y était, les zigzags et les impasses, les abandons et les pardons. Tout était écrit mais rien ne fonctionnait. Je donnais à voir le même éternel sourire pour avancer guillerette dans le récit, prête à amuser mon monde. Le drame de ma mère était passé sous silence, la malédiction familiale tournait à la farce, et ma bisexualité restait dans un placard. Les histoires d’amour n’étaient que joyeuses saynètes. J’avais touché le fond : il était temps d’arracher le masque. Alors j’ai tout repris.»
Dans cette autobiographie traversée de passions et de détresses, Héléna Marienské raconte une vie passée à l’ombre des femmes, figures familiales ou rivales, autant que dans leur lumière, celle des femmes désirées ou follement aimées. Chacune à sa manière lui aura révélé celle qu’elle est : une femme libre, qui abrite résolument en elle plusieurs autres. Nous, peut-être?
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
goodbook.fr
ELLE (Flavie Philipon)
Marie Claire (Gilles Chenaille)
La Libre.be (Monique Verdussen)
Héléna Marienské présente son roman Presque toutes les femmes © Production Éditions Flammarion
Les premières pages du livre
« Le problème
J’ai vingt-huit ans. En ce temps de grand trouble, une femme me guide, enfin. Elle m’a déjà évité plusieurs murs vers lesquels je fonçais, tout droit. Je confie une attirance pour une femme une fois encore. Mme Michelangeli, lacanienne orthodoxe, m’interrompt :
— Vous plaisantez ? Les lesbiennes sont des perverses. Tenez-vous-en éloignée.
Je ne négocie pas, j’obéis. J’arrête les femmes comme on arrête une drogue.
Cependant, voilà bien un autre piège, plus redoutable encore. Enfermez une femme dans une cage mentale. Laissez-la y croupir. Elle a de bonnes chances de s’y perdre. Dans cette prison, je fuis quelque chose d’essentiel en moi. Mais les geôliers ne prévoient pas les ruses de la vie. J’ai quarante ans, et une femme aimée vingt ans plus tôt resurgit. Quelle était la probabilité pour que nous nous retrouvions ? Infime. La vie a fait son œuvre facétieuse. Face à l’amazone de ma jeunesse, j’ai aimé aussitôt, sans retenue, désiré tout autant. Rien n’était possible – trop tard, pour elle. Mais cette fois, j’ai su, sans équivoque : j’aime les femmes.
Et les hommes.
Ça ne va pas être simple, cette vie. Pas simple à raconter, non plus. Moi qui mens toujours, par réflexe pavlovien pour échapper à l’inquisition maternelle, mais aussi par habitude acquise et cultivée – jeu, amour de la fiction –, comment dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité je le jure ?
Claudine
J’avais fui l’ennui du dortoir. J’en partageais un coin avec trois adolescentes qui, pour une raison qui m’échappait et me désolait, me faisaient conjointement la gueule. J’avais dû dire quelque chose, avoir un geste qui avait déplu. Ou l’inverse, n’avoir pas dit ce que l’on attendait. Comme toujours, quelque chose en moi clochait. J’étais décalée.
J’allais avoir quinze ans, et même si je connaissais déjà mon goût pour la solitude, j’avais l’âge où l’on est bluffée par les filles qui sont à l’aise entre elles, se parlent, se confient, rient ensemble, font des projets. Leur complicité m’envoûtait. Pourquoi n’étais-je pas comme elles ? Normale ? Qu’est-ce que je ne savais pas faire ? Une fois de plus, j’avais essayé de me glisser dans l’intimité du groupe : Corinne, leader (car je voyais bien que la règle des clans est d’assigner tacitement un rôle à chacun de ses membres), m’avait à la bonne. J’avais cru que j’étais admise, cette fois. Mais j’avais dû gaffer. Comment, pourquoi, je ne savais. Avais-je été trop assertive ? Ou trop servile ? Avais-je coupé la parole de la chef ou de sa lieutenante, une Sylvie à qui je déplaisais ?
Des bandes de filles émane un langage fluide dont je connais la mélodie sans savoir la reproduire. La parole est distribuée naturellement, comme par une règle écrite que je n’ai jamais lue. J’entends, j’observe, spectatrice muette d’une pièce de théâtre qui se donne sans moi. Les rôles sont attribués, les répliques paraissent apprises. Elles fusent. Certains propos sont autorisés, et même attendus, selon qu’il s’agit d’une comédie (railleries sur les parents, les profs, les membres d’une autre bande) ou d’un drame sentimental (amour impossible, rupture). Dans cette chambrée de la colo, la banalité des dialogues me faisait bâiller, mais je m’étais appliquée à imiter les personnages en action. J’avais accepté de jouer les utilités, tenté une brève réplique au milieu d’une scène. Une fois, deux fois, à la troisième, le spectacle s’était interrompu. Silence gêné. Le rideau allait-il tomber ? Du tout : après quelques raclements de gorge, le rire aigu de Sylvie, relayé par celui de Corinne, avait sanctionné la réplique absurde. La scène avait repris, sans moi.
Mon rôle éternel : persona non grata.
Mesure de survie. Autour de moi, ces filles étaient des personnages de fiction. Autant retrouver la mienne : un livre entamé dans lequel replonger.
Mais lassée du silence tenace qui paraissait emplir la chambre et peser sur mon thorax comme une chape d’hostilité, au point de m’empêcher de penser, de me sentir exister, et même de respirer, ne parvenant plus à lire sur mon lit, j’avais filé me réfugier dans la cantine – une heure à tuer avant le repas.
J’ai oublié le titre du roman : sans doute Vian ou Salinger. Le texte enfin emportait au loin la tristesse ressentie dans la chambre. J’avais des amis, en somme, et qu’ils fussent des êtres de mots plutôt que de chair ne me gênait pas. Ils ne me condamnaient pas, ils m’invitaient ailleurs, dans un monde que je construisais au fil des phrases. Je respirais à nouveau.
Assise au fond de la grande pièce déserte, côté banquette, je lisais donc, courbée sur la table. J’avais résolu de ne plus porter les lunettes de myope qui m’enlaidissaient, pensais-je, et me débrouillais pour déchiffrer le texte en plissant les yeux. Un bruit se fit de l’autre côté de la table. J’entendis une question:
— Vous êtes lesbienne ?
Je lève à peine les yeux et replonge dans ma lecture, rouge de confusion. Une jeune femme, rousse, s’assoit en vis-à-vis et me fixe. Que se passe-t-il ? Que me veut-elle ?
Malgré moi, je me redresse et observe la questionneuse, qui m’apparaît dans un halo de lumière jaune. Elle me dévisage gravement et répète sa question.
— Est-ce que vous êtes lesbienne ?
— Je ne sais pas.
Je n’ai pas hésité. N’ai pas été choquée. Je n’ai jamais envisagé que j’étais cela, lesbienne, je n’en connais aucune. Mais les livres m’avaient appris qu’elles existaient. Dans ceux dont j’ai le souvenir, Colette, Vivien, ces amours m’exaltaient. Et Ange, je l’avais aimée, elle. Nous étions enfants : ça comptait, ou pas ?
L’inconnue insiste :
— Vous êtes sûre ?
Réfléchir. Ou, plutôt, paraître réfléchir. J’ai su dès que je l’ai vue, dès que j’ai senti ses yeux sur moi, que j’ai vu sa bouche articuler des mots comme dans un rêve, comme si le son et l’image étaient dissociés et se percutaient dans mon corps. Le frisson qui me parcourait et me paralysait confirmait que oui, je savais.
— Vous lisez quoi ?
J’adore le vouvoiement. L’autorité. Les yeux d’un vert foncé, presque noirs avec des éclats d’or. L’air de provocation. Le chant du rire.
Évidemment, je me vexe. Ce rire est charmant mais se moque.
— Je ne vois pas ce qu’il y a de drôle.
— Votre tête. Vous faites une tête à mourir de rire. Vous avez quel âge ?
— Seize ans.
Je me suis vieillie d’un an et demi. Elle s’amuse encore. Il faudra que je m’habitue à être comique.
— Et vous ?
— Dix-huit.
J’exulte. Une grande, une femme. Qui s’intéresse à moi, m’aborde et me sourit. Oubliées, les rabat-joie de la chambre et la dirlo qui me houspille souvent. Je me réveille de la torpeur où je m’étais réfugiée. Je vis. Je referme le livre.
— Vous faites quoi, ici ?
Il était grand temps d’inverser le sens de l’interrogatoire, non ?
— Duègne. J’accompagne ma petite sœur.
Claudine a obtenu l’autorisation de participer à cette colonie de ski en Andorre, réservée aux moins de dix-sept ans, pour chaperonner sa sœur qui se relève d’une mauvaise bronchite. Elles dorment dans la même chambre, avec une amie de la petite. Comme elle me voit soupirer, elle me pousse aux confidences. Je perds ma timidité, dresse un portrait au vitriol des pestes que j’ai fuies. Magie du langage, qui permet d’inverser le réel : soudain, les trois ados qui m’ont prise de haut deviennent des personnages loufoques. Je fais le récit de leurs petitesses, en les exagérant, de leurs ragots et de leurs facilités de pensée. Raconte aussi ma piètre tentative pour me faire accepter. La grande s’amuse de ma verve, m’encourage à la méchanceté et au mépris puis m’interrompt :
— Vous vous appelez comment ?
— Nathalie.
— Vous dînerez à notre table, Nathalie. Je vais me changer.
Tout oublié de ce dîner. Mais pas de l’after… Claudine me demande comment je vais supporter les trois dindes dont je partage la chambre. Je lui réponds : assez bien, car je vais m’en éloigner. Je dors dans votre chambre.
Objection de Claudine, qui n’avait peut-être pas envisagé que je prendrais les devants : tous les lits sont occupés. Sa sœur Valou est là avec sa copine. Ce n’est pas simple.
Pas question de lui laisser le monopole de la provocation. Elle veut savoir si je suis lesbienne ? Autant vérifier, the sooner, the better. Tous les lits sont pris, répète-t-elle, navrée.
J’enchaîne et pulvérise toutes ses objections. Je dormirai sous un lit, à même le plancher. Je suis un vrai yogi (j’improvise) et j’ai l’habitude de dormir n’importe où. Accepterait-elle ma présence silencieuse, sous son sommier ? Elle s’amuse, hésite : mais Mme Espeluque, la dirlo ?
Je me fiche de cette Espeluque et de sa moustache. Claudine est mise devant le fait accompli : je vais passer la nuit à quelques centimètres d’elle.
Ambiance de chahut dans la chambre de mes nouvelles amies, qui m’accueillent à demi nues, se disputent une chemise de nuit, se poursuivent en bondissant d’un lit à l’autre. Claudine me prend dans ses bras et feint de gronder les « petites », qui ont en fait presque mon âge. Des chocolats circulent. Des chaussettes sèchent sur le radiateur. Claudine caresse mes cheveux, les petites chantonnent « Oh, oh, oh, les amoureuses ! ».
Puis Valou :
— Tu vas vraiment rester ici ?
Sans lui répondre, je me glisse sous le lit où Claudine vient de prendre une pose de Titienne.
La porte s’ouvre brusquement, interrompant le tohu-bohu. Espeluque a rappliqué, et la voilà qui, pour occuper l’espace, réunit les chaussettes qui fument pour les brandir sous le nez de Claudine :
— Interdit, ça, mademoiselle !
— Bien, madame.
Depuis mon poste d’observation en contre-plongée, je la vois esquisser une révérence ironique. Espeluque se pince le nez et continue l’inspection, ramasse une peluche, un soutien-gorge. Puis :
— Vous n’auriez pas vu Nathalie Galan ?
Silence dans les rangs.
— Elle a disparu de sa chambre en prenant quelques effets et sans un mot pour ses camarades. Nous avons cherché partout cette demoiselle, comme si nous n’avions que ça à faire… Introuvable. Elle a dîné à votre table. J’ai pensé que…
— J’étais ici ?
J’ai pris une voix d’outre-tombe qui a fait sursauter la daronne. Tout le monde rit, sauf elle et moi.
— Vous m’expliquez ce que vous fichez ici ?
— Je me prépare au sommeil.
— Sous un lit ?
— C’est indéniable.
— Vous pensez vraiment pouvoir dormir sur le sol ?
— Vous savez, quand on est jeune… on dort partout.
Les rires reprennent. Espeluque me menace d’appeler mon père, qui dirige non loin une autre colonie de ski réservée aux garçons.
— Mon Dieu, je tremble. Vous lui transmettrez mon profond respect.
La vieille bique considère la situation. Que peut-elle faire ? Les menaces des représailles familiales n’ont pas fonctionné. Sans doute pourrait-elle me priver de ski : elle sait que je m’en consolerais avec des bouquins. Alors… la force ? Il n’y a pas de service d’ordre dans les colos pyrénéennes de la Fédération des œuvres laïques… Elle pourrait essayer de m’attraper par les cheveux et m’éjecter de la chambre. Il faudrait qu’elle en ait la force et le courage. Les deux lui font défaut. Elle capitule.
Je suis arrivée à ce moment de ma vie où les adultes n’ont plus aucune prise sur moi. Quelle loi fonde l’autorité qu’ils prétendent exercer sur moi ? Je pense, donc je suis, donc je suis libre de faire ce que je veux de ma vie. Elle m’appartient, ne leur déplaise. C’est jouissif, mais moins que de sentir Claudine se glisser à mes côtés, sous son lit. Nous chuchotons, attendons que les petites se calment, s’endorment. Claudine rampe sur moi, légère et déterminée. Émotion de sentir ses seins sur les miens, et son ventre pareil. Elle m’embrasse doucement. Le cou, les joues, les lèvres.
J’apprends.
Sous la douche, aussi, lorsque nous revenons du ski le lendemain soir. Souvenir ébloui de son corps nu, lisse, brillant. De sa poitrine très ronde et fière que j’ose à peine toucher. Elle me montre les gestes qu’elle aime. Mes seins sont minuscules, j’ai peur qu’elle se moque à nouveau. Mais non. Je me souviens, pour cette première fois, d’un mélange complexe de gêne – montrer mon corps nu – et d’effervescence du désir. Étrangement, c’est le seul instant érotique avec Claudine dont j’ai un souvenir précis, geste après geste. Comme si, par la suite, le discours avait effacé les corps.
Fin des vacances : elle retourne chez ses parents, près de Montpellier, moi chez les miens, dans un village qui se dresse entre les vignes. Nous nous écrivons. Elle m’envoie des lettres surprenantes : entre les lignes et dans les marges, des dessins – bouches, yeux, cuisses ou seins de femmes mêlés à des animaux psychédéliques aux membres épars – envahissent le texte et débordent sur l’enveloppe, où mon nom (Nathalie Galan) et mon adresse, réduite au minimum (34 Montagnac), sont à peine lisibles. Le courrier m’arrive malgré tout.
Ses lettres papillonnent d’un sujet à l’autre, ses cours, ses parents, son envie de me voir au plus vite, son fiancé Arnaud, son amour pour moi, ses exams, sa sœur, mes « cheveux de soie », son régime, des poèmes d’Apollinaire, des filles qui l’ont draguée, l’ineptie de certains cours. Le propos est volontairement décousu, insolite. Elle revendique une philosophie postsurréaliste. Et lit Freud : les lettres qu’elle m’écrit, m’explique-t-elle, traduisent donc le parcours capricieux de son inconscient.
Je suis déroutée. Suis-je sa muse, ou un prétexte à son envie d’être l’auteur de lettres originales ? Joue-t-elle ? Est-elle sincère ? Cet amour dont elle me parle, existe-t-il ? Est-il une chimère, comme les corps morcelés tracés au stylo Bic bleu qui occupent plus de place que le texte ?
Nous nous retrouvons à Montpellier, plusieurs fois. Chez elle, où sa mère me reçoit comme une « amie de la colo » et ne semble pas s’inquiéter des bruits qui montent de la chambre de Claudine, où nous passons l’après-midi. À Pézenas, dans mon lycée, où elle vient passer une journée. Pendant les cours, elle m’attend au parc Sans-Souci tout proche. Pendant les récréations, nous nous retrouvons dans un lieu reculé, où personne ne nous voit, normalement. Je retourne à Montpellier : à la fac ! Très impressionnée, j’assiste avec elle à un cours de chimie. Dans un amphi. Je suis aux anges, mais me fais toute petite : et si je me faisais virer ? Le prof ne paraît pas noter ma présence. Il pose une question à laquelle je ne comprends rien. Le reste de l’amphi non plus, semble-t-il. Silence prolongé. Claudine, de sa voix de soprano, donne la bonne réponse. Elle est la meilleure, je suis fière.
Elle est fière de moi quand je me distingue au concours général de français. Elle revient au lycée. En récompense de mes hauts faits scolaires, elle m’offre un collier. Nous ne nous cachons plus et nous embrassons à bouche que veux-tu au lycée puis dans les rues de Pézenas.
La grosse
Notre correspondance devient presque quotidienne. Tout nous dire, voilà notre pacte. Mais je ne lui raconte pas ce qui a changé au lycée depuis que certains ont aperçu nos privautés. Les commentaires chuchotés fort quand je passe : tiens, la gouine ! Bien sûr, je hausse les épaules dans un geste de mépris. Mais à ce mépris se mêlent de la peine, de la honte, de la rage. Je tais aussi les moqueries dans le public quand je joue avec la troupe de théâtre animée par M. Courtois, mon professeur de français. Je suis Chérubin, et lorsque j’entre en scène en costume de petit page, veste courte de soie bleue ouverte sur un jabot de dentelles, assortie à une culotte prolongée par des bas blancs, chapeau chargé de plumes et épée au côté, cheveux retenus dans un catogan, des rires fusent. Je ne suis pas une mauviette, je serre les dents et la poignée de mon épée avant de lancer joyeusement le texte. Mais lorsque je dois confier à Suzanne ma passion pour la Comtesse : « Que tu es heureuse… À tous moments, la voir, lui parler… L’habiller le matin (rires redoublés), la déshabiller le soir (chahut), épingle à épingle », je voudrais rentrer sous terre. Il était prévu que, chenapan audacieux, je pousse un grand soupir sur « déshabiller » et que, mimant le fantasme provoqué par la Comtesse, je défasse une à une les épingles qui tenaient le voile occultant la ravissante gorge de Suzon – puisque après tout, Chérubin a l’âge des émois amoureux qui rendent désirables et quasi interchangeables toutes les femmes. Aux répétitions, j’en rajoutais, faisais durer l’effeuillage, jouais avec les épingles, piquant parfois, très légèrement, la poitrine de Suzon, qui surjouait le plaisir ou la colère, selon l’inspiration. Devant le public, paralysée par les quolibets, je zappe la mise en scène. Suzanne, surprise, attend, les spectateurs aussi. Une nausée, une fatigue terrible m’accablent. Immobile, geste suspendu, je parais imbécile. La suite pourrait s’écrire comme une scène en abyme ou en vertige, où abonderaient les didascalies, le texte ayant presque disparu : Suzanne foudroie du regard Chérubin, puis, celui-ci restant les bras ballants, elle enchaîne. Chérubin s’approche d’elle pour la serrer dans ses bras. Il bute sur les pieds de la malheureuse, qui jure. Le public s’esclaffe. On attend une réplique de Chérubin, qui reste muet. En coulisse, le professeur fait des signes d’encouragement, suivis de mimiques de désespoir, avant de tourner le dos. Chérubin murmure enfin : « Mon cœur palpite au seul aspect d’une femme », tandis que les rires redoublent, puis plus bas encore : « Les mots amour et volupté le font tressaillir et le troublent. » Huées, claque en triomphe, sortie de scène de Chérubin, chapeau de travers et larmes aux yeux.
Le ridicule ne tue pas, pas plus que la honte qu’il provoque. Mais je voudrais mourir. C’est entendu : je ne remonterai plus sur scène, je partirai loin, au plus loin de ces abrutis. Je ne dis rien de cette avanie à Claudine et ne mentionne pas les appels anonymes reçus chez moi.
L’un d’eux m’a marquée : une inconnue m’affirme à voix chuchotée que je lui plais. Elle ajoute qu’elle veut me rencontrer. Je voudrais savoir qui m’appelle. « Tu me reconnaîtras tout de suite, t’inquiète. Tu n’as pas vu comment je te regardais ? » Est-ce Mylène, dont je contemple parfois les yeux rêveurs ? Ou Martine, pas très jolie, mais brillante ? L’inconnue me donne rendez-vous le samedi soir suivant. Je raccroche, tourneboulée. Envie d’y aller, crainte d’un traquenard. Mais je n’ai peur de rien, je m’en persuade.
Maman entre dans ma chambre :
— N’y va pas. Ce serait une grosse bêtise.
— Tu as écouté ?
— C’est mon devoir de mère. Te protéger. Tu es d’une naïveté confondante. Tu n’as donc pas compris ? Cette fille se moque de toi. J’entendais des bruits derrière. Elle n’était pas seule.
Interdite, je reste sans réponse. Ma mère m’espionne, alors ? Je voudrais l’étrangler, je l’envisage, l’examine de pied en cap. Par où attaquer ? Elle triomphe. J’avais compris qu’elle lisait mon journal, où je consignais, pour la punir, des fables effrayantes. Elle fait son devoir, dit-elle. Que répondre ? Elle n’a peut-être pas tort. Sans elle, je me serais « jetée dans la gueule du loup », comme elle me le répète. Humiliée, je me tais.
Je me persuade que je me fiche des moqueries, des regards outrés des unes et des autres. Je sais, de source sûre, qu’il arrive que des femmes s’aiment. Je l’ai lu, voilà. Les livres de Colette disent la vraie vie, la vie loin du lycée. La réprobation de mes camarades, cette clique d’incultes, vaut ce que valent tous les conformismes : mon mépris. L’important ? Ma vie, libre, mes lectures, quelques cours au lycée qui me passionnent et surtout Claudine. Mais je n’aime pas être la risée du lycée. Je hais le ton mi-outré mi-blagueur que prend Helen, ma correspondante anglaise venue de Lincoln, qui ne m’adresse la parole qu’une fois pendant son séjour : Are you a lez ? Devant mon hésitation, elle tourne les talons et se dirige vers sa chambre, qu’elle ferme à clé.
Je rejoins Claudine pour un week-end chez elle. Ses parents sont partis, emmenant sa jeune sœur. Nous faisons l’amour, rien que l’amour – à peine le temps de manger ou dormir. Nous dansons nues, dans sa chambre, sous la douche, dans le jardin la nuit. La vie est douce, drôle, vibrante. Mes déboires théâtraux ou téléphoniques ou british sont oubliés.
Des mois passent ensuite sans que nous nous voyions. Claudine m’écrit : elle m’aime plus que jamais, je suis sa Natachat, sa Natalionne, sa Natendresse, sa Natafolie. Elle prépare ses examens de médecine et potasse en binôme avec Arnaud. Il est question de mariage. Rien n’est sûr mais ça ne change rien pour nous : qu’est-ce qui nous empêcherait de nous aimer ? Rien, je suis d’accord, et surtout pas ce petit Arnaud qu’elle peut bien épouser. Il ne me gêne pas, sauf quand je le rencontre : il raille à peu près tout ce que je dis, et férocement mes propos « cryptocommunistes ». Ah bon, j’ai ma carte des Jeunesses communistes ? C’est la meilleure… Il s’entête à me prendre en défaut, ce qu’il parvient à faire assez facilement. Je l’emmerde, lui, ses airs condescendants et son petit esprit de toubib réac, vieux avant l’heure : c’est dit. Je suis rouge de colère, lui, blême. Claudine prétend adorer nos chamailleries – chien et chat, dit-elle. Je m’enorgueillis d’avoir le rôle du chat et me tiens à distance du toutou.
Je reviens de Londres, où j’ai passé l’été. Pendant deux mois, j’ai financé mon séjour en travaillant comme jeune fille au pair, sans enthousiasme – puis en divers jobs assez saugrenus. Je me suis nourrie de granny smith, de fish and chips, de salades, de pizzas, et de rhubarb pies nappées de custard cream. J’ai pris huit kilos. La gamine malingre est devenue une ado boulotte. Je suis effarée. D’ailleurs, je ne suis pas la seule. La mère d’une amie, me croisant dans la rue, s’arrête tragiquement, m’observe en silence et murmure : Ma pauvre… Mais tu as un problème, une maladie ! Il faut consulter.
Je me regarde nue dans le miroir de la salle de bains. Je suis joufflue, ventrue, méconnaissable. Il faut agir avant de revoir Claudine, pour qui je suis une héroïne des Rhénanes : élancée, légère comme un songe. Je cesse de manger. Ne vais plus à la cantine. Je tiens une semaine et dégonfle de trois kilos. Je suis encore dodue, totalement épuisée, mais toujours aussi déterminée. Les cours me paraissent infinis, je plane. En sortant du lycée, je passe devant une boulangerie, achète du pain au seigle. J’entame l’objet du désir dans le bus. Juste le quignon… Quand j’arrive chez moi, j’ai tout englouti, sans même m’en apercevoir. Rien de grave, le boulanger m’a assuré que ce pain était excellent pour la santé.
Le soir suivant, je garde le pain de seigle dans mon cartable. Le sort en cachette, dans ma chambre. Descends dans la cuisine, pique de la crème de marrons. Je termine le pain et le tube de crème. À ce rythme, en quelques semaines, j’ai repris les kilos anglais, et bien d’autres. Je ne me pèse plus. Ne porte plus de pantalon – je n’entre dans aucun. Je cache ce corps de cachalot dans des chemises de nuit brodées, vêtements de brocante que j’ai teints. Ma mère me dit que je suis mignonne aussi, avec des rondeurs.
Claudine m’écrit à nouveau. Pourquoi ai-je cessé de donner des nouvelles ? Suis-je fâchée à cause de cet idiot d’Arnaud, qui est jaloux de moi ? Elle m’attend, n’en peut plus de m’attendre.
Lorsque j’arrive chez elle, un silence, puis des rires. Des mots que je ne comprends pas. Claudine ne m’embrasse pas. Que s’est-il passé ? Pourquoi ai-je doublé de volume ? Bravache, je lui réponds que je me fiche des diktats de la mode : qui a dit qu’une femme devait être maigre ? L’est-elle, elle ? Je la déshabille et envoie voler ma robe teinte. Elle rit. De moi, de mes arguties, de mon bide. Ai-je vraiment cru qu’il me suffirait de changer de canons esthétiques pour être séduisante tout en étant boudinée ? (Je me souviens, des décennies plus tard, des termes exacts de sa repartie.)
— Tu ne m’aimes plus alors ?
— Si on allait au cinéma ?
On marche en silence vers le centre-ville. Claudine veut revoir Cria cuervos, mais je n’en démords pas : ce sera À la recherche de Mister Goodbar. Quand le noir se fait, Claudine s’efface dans le fauteuil, dans l’ombre. Je voudrais caresser sa main, elle la retire. Il faudrait mourir, là, tout de suite.
Ma détresse m’effare. Dans le noir, quand je pleure, rien ne se voit. Je pense à courir, loin d’elle, de son regard, de son dégoût. Heureusement, Diane Keaton est sublime. Dans la pénombre de la salle, Claudine s’estompe de plus en plus. Éblouie par la dégaine de Diane, son élégance, sa double vie, je n’existe plus que dans sa contemplation. Fascinée par son rire, ses silences. Son mystère. Sa liberté, son audace, son corps de femme.
Je regarde à peine Claudine lorsque nous sortons du cinéma. Je voudrais disparaître, ne plus avoir à subir son regard mi-attristé mi-moqueur sur mon corps transformé. Il fait froid, son nez est rouge, ses yeux absents. Je ne lui plais plus : me plaît-elle, au fond ? M’a-t-elle jamais plu ? Je me persuade qu’elle ne m’intéresse plus vraiment. Ce que je veux désormais, ce sont de vraies femmes, adultes, obscures, des démones, des tigresses. Je suis sûre qu’elles aimeront mes formes rondes. Sinon, je maigrirai.
Plus jamais je n’ai revu Claudine. Une amie m’a appris, quelques années plus tard, qu’elle avait deux enfants. Mariée, médecin, installée.
M’a-t-elle oubliée ? A-t-elle seulement imaginé le trouble dans lequel m’a jetée son dégoût soudain ? Je n’étais aimable qu’en adolescente à la David Hamilton, alors ?
Sans doute n’a-t-elle pas deviné ma détresse. J’avais, dans l’instant où la rupture paraissait entendue, donné à voir une telle indifférence qu’elle a dû penser que, comme elle, j’avais joué aux amours adolescentes : pour voir, pour essayer, pour provoquer. Sans l’aimer. Je note d’ailleurs que l’écriture de ce texte reproduit l’indifférence feinte d’alors. Évoquant le trouble, je glisse, je provoque, j’escamote et fais de l’humour.
Quand ferai-je tomber le masque ? Quand parviendrai-je à m’autoriser cette indécence ?
Albertine
Après Claudine, peu de rencontres. Des hommes, oui – mes rondeurs adolescentes les attendrissaient. Il me semble qu’il était si facile, alors, de rencontrer des hommes… Mais les femmes ? Les lesbiennes, j’entends, les seules qui m’intéressaient ? Hélas, elles ne me voyaient pas. Ne m’envisageaient tout simplement pas, dissuadées sans doute par mon apparence hétéro. Car la lesbienne invisible en rajoutait. Pour me consoler de l’indifférence femelle et de la cruauté des Claudine, je m’étais tournée vers la facilité : l’autre sexe. Sans doute ai-je alors donné une inflexion particulière à ma « féminité ». Comme on le sait, une construction.
Et donc, exagération des signaux. Maquillage, jupes marquant la taille, décolletés pigeonnants, talons hauts. L’adolescente excentrique s’était métamorphosée en jeune femme aguicheuse. La bête noire, dans le ghetto, où l’on se doit de manifester quelque signe de reconnaissance : cheveux courts, ou jean, ou Dr. Martens, ou blouson d’aviateur, tatouages, piercings, suivant les époques. Les modes changent, l’esprit demeure : on est dans un entre-soi et on montre patte saphique.
Dans ce désert de femmes, une exception quatre ans plus tard, lorsque j’arrive à Paris.
Une jeune beauté toujours vêtue de noir, en prépa… On m’apprend, dans un rire qui fustige, qu’Albertine est lesbienne. Comme je tombe des nues, on s’étonne aussi de ma naïveté : mais enfin, on ne voit que ça ! Je n’avais rien perçu, juste épatée par sa beauté de Diane très blonde et cet air de fierté toute romaine qui accompagnait naturellement son excellence. Car Albertine surclassait la cohorte des héritiers et brillait impérialement dans toutes les matières, au grand dam de ses compétiteurs, petits messieurs fils de diplomates et jeunes oies bosseuses qui jouaient les modestes en rêvant de lauriers.
De façon occulte, nous nous manifestons de l’intérêt. Une correspondance de petits mots transmis à la barbe des profs est lancée. Des rivales s’en mêlent. Ou des rivaux. Les billets se multiplient, se perdent puis se retrouvent. Qui est Valmont, qui est Merteuil ? Des petites Volange ou des Danceny semblent se déchaîner. Il faut agir. En avoir le cœur net. Je glisse une brève missive dans le cartable d’Albertine : Vous vous dérobez ? Rendez-vous place Saint-Sulpice, vendredi, 14 h 30. Soyez ponctuelle ou nous ne nous verrons pas.
Nous allons peut-être nous rencontrer, nous approcher, nous embrasser, alors que jamais nous ne nous sommes parlé. Il me semble même qu’Albertine ne m’a jamais regardée. Viendra-t-elle ? Ou bien le jeu est-il déjà terminé ? Offrant l’opportunité d’un rendez-vous secret, je lui ai peut-être concédé ce qu’elle, ou les autres, souhaitaient. Ma reddition.
Elle vient pourtant, à l’heure dite. Nous marchons sans échanger ni regard ni mot. Diantre, ce silence… Cette indifférence ! se dit Valmont (car en cet instant, piquée au vif, je suis le terrible vicomte de tout mon être, prêt à conquérir l’impudente, la faire frémir d’amour, à obtenir ses dernières faveurs, puis la laisser languir de douleur comme une Présidente).
Toujours aussi mutiques, nous prenons un café boulevard Saint-Germain, dont le tracé incurvé qui s’origine pont de la Concorde pour couler jusqu’au pont de Sully forme comme une parenthèse au sud de la Seine.
Je parviens à lui délier un peu la langue. De quoi débattons-nous dans ce bistrot qui fait l’angle avec la rue de l’Ancienne-Comédie, dont nous occupons seules le premier étage ? J’ai oublié le sujet, pas le ton : vif, enthousiaste, parfois ironique. Un silence enfin, qui s’éternise. Je lui demande de fermer les yeux, elle hausse les sourcils dans une expression d’étonnement qui vient brutalement dissiper l’impassibilité qu’elle affecte, puis s’exécute. Je l’embrasse, elle rougit, se détourne, hésite. Me rend le baiser. Ses lèvres sont douces, sa langue aussi habile que dans le débat, mais d’une manière qui me semble plus délicieuse encore. À mon tour de fermer les yeux. Cœur qui bat, exaltation, frisson qui emporte tout l’être. Si je ne me tenais pas, je me précipiterais sur elle.
Autour de nous rôde depuis le début de la conversation et de ses prolongements tendres un serveur au gilet malpropre. Il remue des chaises, fait claquer le cul des tasses sur le comptoir. Il me dérange, enfin, introduit des bruitages dans le film où je viens d’entrer. »
Extraits
« Je quitte le domicile familial à dix-sept ans, fuyant à Paris sans un sou vaillant. Depuis, je navigue à vue. Ça tangue. Jour et nuit — nuit surtout. Je souffre d’insomnies chroniques qui rendent ma vie professionnelle difficile — j’euphémise: je me gave de benzodiazépines. Ajoutons que ma vie amoureuse est un chaos. J’ai épousé en premières noces, à vingt ans, un amateur de nymphettes, Daniel. Il a l’âge de mon père mais lorsque je rencontre Michelangeli, je suis à vingt-trois ans déjà une vieille chose à ses yeux. À qui parler? J’ai rompu en visière avec mes parents, je n’ai aucune amie. Je veux divorcer et comme mon époux me complique la tâche, je multiplie les aventures — c’est l’époque merveilleuse de l’insouciance pré-sida. J’ai arrêté mes études et je n’ai aucun métier.
L’effet le plus marquant de cette vie d’incertitude est donc une insomnie tenace qui me conduit à prendre de méchantes doses de médocs. Avec un cerveau en compote, comment trouver un job? Je fais moi-même l’analyse suivante: je suis dans une impasse. Il faut en sortir fissa. Comment, je ne sais. J’envisage pour finir une thérapie. Où trouver l’argent? Je donne des cours (de tout, de français, de maths, de philo et même, c’est un comble, de physique, alors que je n’ai que quelques bases). Je constitue un pécule qui m’ouvre la porte du cabinet de Mme Michelangeli.
Elle m’écoute. Six mois d’onomatopées. Je l’engueule. Elle me secoue. Me renvoie systématiquement à mes contradictions. Elle y va fort.
Elle m’emmerde, avec ses principes de vieille catho. Je mets fin à l’analyse: je n’ai plus besoin d’elle, en tout cas je m’en persuade. J’ai compris deux trois trucs qui
devraient me permettre de rebondir.
Direction le nord de Paris: le miroir aux alouettes. » p. 38-39
« Je ne maîtrisais plus rien. J’aimais à quarante-cinq ans d’un amour adolescent. Naomi était rodée aux histoires de cœur et de corps avec les femmes, tandis que je les découvrais avec émerveillement. Albertine avait été inaccessible, je m’étais comportée comme une idiote avec Coline, mais cette fois, j’aimais. J’aimais et voulais vivre avec Naomi un amour complet. Je le désirais avec frénésie: j’avais à nouveau dix-sept ans, l’appétit de plaisirs et des effusions sentimentales qui vont avec. Cristallisation, idéalisation, aveuglement amoureux tout ensemble. Égarements du cœur et de l’esprit. » p. 121
À propos de l’auteur
 Héléna Marienské © Photo Philippe Matsas
Héléna Marienské © Photo Philippe Matsas
Héléna Marienské est l’autrice de Rhésus (P.O.L, 2006, prix Lire du meilleur premier roman, prix Madame Figaro/Le Grand Véfour, mention spéciale du prix Wepler), Le Degré suprême de la tendresse (Héloïse d’Ormesson, 2008, prix Jean-Claude-Brialy), Fantaisie-Sarabande et Les Ennemis de la vie ordinaire (Flammarion, 2014 et 2015). (Source: Éditions Flammarion)
Page Wikipédia de l’auteur
Page Facebook de l’auteur
Compte Twitter de l’auteur
Compte instagram de l’auteur
Compte Linkedin de l’auteur
Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)
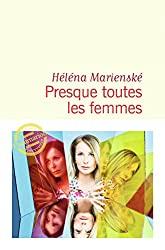



Tags
#presquetouteslesfemmes #HelenaMarienske #editionsflammarion #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2021 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #bisexualite #rentreelitteraire #rentree2021 #RL2021 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #auteur #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #Bookstagram #Book #Bookobsessed #bookshelf #Booklover #Bookaddict
