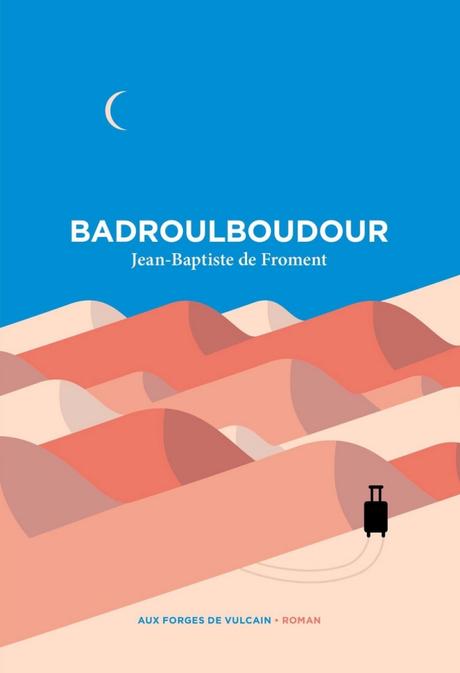
En deux mots
En partant en vacances au « Kloub » avec ses deux filles, Antoine ne se doute pas qu’il est l’objet d’une machination. Pourtant ce spécialiste des Mille et une nuits et autres contes orientaux aurait pu savoir que tout ce qui brille n’est pas d’or.
Ma note
★★★ (bien aimé)
Ma chronique
Mille et une entourloupes
Dans un second roman qui confirme la belle vivacité de sa plume, Jean-Baptiste de Froment nous entraîne en Orient. Au pays des Mille et une nuits, œuvre dont il a réhabilité son traducteur français, bien des surprises l’attendent.
Antoine, cadre supérieur ayant dépassé la quarantaine, rencontre un groupe de collègues à l’aéroport avant de prendre la direction du « Kloub » où il va passer des vacances avec ses deux filles surexcitées. Sa femme l’ayant quitté, lui a plutôt l’humeur morose, même si sa vie a pris une tournure plutôt exaltante dans les derniers mois. C’est qu’Antoine Galland est l’homonyme du traducteur des Mille et une nuits, une coïncidence qu’il a pris comme un appel à s’intéresser à cet auteur oublié, allant jusqu’à consacrer une thèse sur cette belle œuvre. Thèse qui aura au moins eu le mérite de faire tanguer le cœur de Madeleine, lui confiant le soir même de sa soutenance qu’elle attendait de lui qu’il l’aime mille et une fois. Las, après des débuts encourageants, soulignés par la naissance de Garance et d’Aubépine, le couple se séparera après un voyage à Tanger marqué par la perte d’un bagage, élément déclencheur de leur rupture.
Mais pour l’heure, le Kloub attend le père et ses enfants… avec quelques surprises. C’est ainsi qu’il retrouve là un collègue et une ancienne connaissance qu’il aurait préféré oublier, mais aussi un animateur qui semble bien connaître les Mille et une nuits puisqu’il préfère nommer la fille dont s’éprend Aladdin Badroulboudour plutôt que Jasmine, comme dans Disney. Badroulboudour, comme dans la traduction de Galland. Il faut dire que, par un étonnant concours de circonstances, Galland est devenu en quelques mois un héros dont le parcours a servi au Président de la République, Célestin Commode à redorer le roman national.
Le chef de l’État a choisi de «panthéonniser» cet homme, «parti de rien, originaire d’une province reculée du royaume, (qui) avait mis son énergie et son intelligence, qui étaient grandes, au service de la connaissance de l’Autre: c’est-à-dire de l’Arabe, du Mahométan.» Très vite les Mille et une nuits étaient devenues l’œuvre à la mode, car «avec Aladdin, les Français prenaient leur revanche sur tous les maux dont ils s’estimaient frappés. Aladdin, c’était l’ascension sociale fulgurante d’un vaurien devenu, par les vertus combinées de la chance et du mérite, plus puissant et valeureux que le sultan. C’était aussi l’amour absolu, car tous les pouvoirs de la lampe, Aladdin les avait sacrifiés à la conquête de la princesse Badroulboudour. Aladdin incarnait enfin – et cet aspect des choses n’était pas négligeable – l’Orient made in France».
Mais dans cette belle histoire comme dans les contes orientaux, il faut se méfier des apparences, des ombres qui rôdent. Pour avoir oublié ce conseil de prudence et avoir été aveuglé par la quête de sa princesse, la belle Badroulboudour, Antoine va devoir affronter des vents contraires, pris dans les rouages d’une machination habilement cachée.
Si l’on retrouve des lieux et des personnages de son précédent roman, État de nature, dans cette œuvre, c’est plutôt un clin d’œil adressé au lecteur par le romancier, car il ne gênera en rien la compréhension du texte. En revanche, on retrouve la même vivacité de ton et cette ironie qui tout au long du texte va souligner la complexité des rapports humains. Car bien entendu, ce sont bien ces rapports, et les sentiments qui les dictent, que Jean-Baptiste de Froment analyse dans ce conte délicieusement «oriental», avec son lot de perfidie, de retournements de situation et de mystère.
Badroulboudour
Jean-Baptiste de Froment
Éditions Aux forges de Vulcain
Roman
224 p., 18 €
EAN 9782373050929
Paru le 20/08/2021
Où?
Le roman est principalement situé dans un club de vacances, en Égypte. On y évoque aussi Paris, Rome, Le Vatican et Tanger.
Quand?
L’action se déroule de nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Antoine Galland se retrouve un jour dans un hall d’aéroport, en partance pour un club de vacances en Égypte. Madeleine, sa femme, l’a quitté et, pour les vacances, lui a confié leurs deux petites filles. Antoine a bien besoin de vacances. Il reste éprouvé par son divorce, mais aussi par l’agitation de ces derniers mois, où lui, l’homme discret, maladroit, féru de littérature arabe, s’est retrouvé, bien malgré lui, embrigadé dans une grande opération de communication du jeune Président de la République, Célestin Commode, qui, cherchant la synthèse parfaite pour réconcilier villes et banlieues, jeunes et vieux, modernes et réactionnaires, en même temps qu’une astuce pour relancer la diplomatie arabe de la France, a décidé de remettre au goût du jour Antoine Galland, l’illustre homonyme de notre héros, et traducteur des célèbres Mille et une nuits. Mais notre Antoine, dans ce club de vacances, se retrouve pris dans un jeu mystérieux qui consiste à identifier, cachée parmi les vacanciers, Badroulboudour, la femme parfaite. Une aventure bizarre au cours de laquelle il sera confronté à son célèbre homonyme du passé, dans un jeu de miroirs éclairant sur notre temps.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Goodbook.fr
Viabooks (Agnès Séverin)
La Montagne
The Unamed Bookshelf
Blog Mémo émoi
Blog Lily lit
Blog Lecturissime
Blog La page qui marque
Les premières pages du livre
« 1.
«Le Kloub, tu vas voir, c’est assez spécial quand même…» lui avait dit Madeleine, son ex-femme. Elle y était allée l’année dernière avec les filles. Cet été, c’était le tour d’Antoine.
Sans doute allait-il voir, mais pour l’instant, Antoine Galland n’était qu’à l’aéroport, seul avec ses filles.
Comme d’habitude, Garance et Aubépine étaient déchaînées. Avec les boîtes en carton bariolé, aux couleurs d’un célèbre fast-food, qui avaient contenu leur repas, elles s’étaient confectionnées d’énormes couronnes, qu’elles avaient solidement enfoncées sur leurs petites têtes, presque jusqu’aux sourcils. De forme rectangulaire, bombées à leur sommet, ces couronnes n’étaient pas sans évoquer, se dit-il, les tiares que portaient les despotes de l’Orient englouti, ceux de Carthage et d’Ilion, de Babylone et de Ninive, de Sumer et de Nabatène, des royaumes de Pergame et de Saba, voire des empires achéménide et séleucide. Le message, en tous cas, était clair : désormais et jusqu’à l’embarquement, les enfants d’Antoine régneraient sans partage sur cette partie du terminal B7. Pour rendre leur domination plus éclatante, juchées sur le rebord du chariot à bagages, les petites filles brandissaient les deux bâtons de Smarties géants qu’elles lui avaient extorqués dans la boutique hors taxes située juste à côté. Bâtons qui dans leurs mains, à la fois sceptres et matraques, étaient devenus les vivants symboles de l’arbitraire. Circonstance aggravante, dans son cynisme, pour appâter davantage les mioches et rendre l’acte d’achat inéluctable, comme si la promesse conjointe du chocolat et du sucre ne suffisait pas, la multi-nationale à l’origine de ces tubes de bonbons très grand format avait équipé leurs extrémités de mini-ventilateurs ludiques, qui ne rafraîchissaient pas mais émettaient, une fois mis en marche, un vrombissement entêtant comparable, à leur échelle, à celui d’un escadron d’hélicoptères américains à l’approche des rizières nord-vietnamiennes, bourrés de napalm et de soldats hystériques.
– Calmez-vous, les enfants, je vais vraiment me fâcher maintenant, proféra-t-il d’un ton exagérément comminatoire, davantage à l’intention de ses voisins adultes, pour leur montrer qu’il était conscient de la situation et ne baissait pas les bras, que de sa progéniture, dont l’hilarité avait redoublé au prononcé de la menace.
Antoine savait bien qu’il ne pouvait être véritablement question ici de sévir, qu’aucune confiscation des bâtons Smarties, en particulier, n’était envisageable, car les représailles alors seraient terribles. Elles prendraient d’abord, face à l’ampleur du crime de lèse-majesté dont il se serait rendu coupable, la forme encore symbolique de hurlements : ceux de la fierté offensée, signifiant qu’à travers leurs personnes sacrées, c’étaient les droits de tout un peuple, du peuple des petites filles à travers la Terre, qui avaient été bafoués. Puis sans transition aucune, sans la moindre sommation d’usage, s’abattrait sur lui une rouée de coups, poings et pieds mêlés, visant indistinctement toutes les parties de son anatomie, avec des conséquences potentiellement très douloureuses. Enfin, lorsqu’il tenterait de les maîtriser, ce serait l’inévitable accident, la chute de l’une des deux, plus probablement des deux, du chariot à bagages et, par conséquent, le redoublement des pleurs, le nécessaire passage à l’infirmerie. Personne ne pouvait souhaiter une telle apocalypse, dont la clameur se diffuserait de porte en porte, jusqu’aux confins du terminal.
La situation de relative paix armée, de guerre à peu près froide qui était celle du moment, était bien préférable.
– Les barbares sont à nos portes… commenta sa voisine immédiate, d’un ton lugubre, comme une réplique à son raisonnement intérieur.
Elle semblait voir dans le comportement des petites filles la confirmation de ce qu’elle pressentait depuis longtemps, l’imminence d’une catastrophe majeure. La fin de la civilisation occidentale, ou quelque chose d’apparenté.
Antoine se tourna vers elle. C’était une femme au visage étonnamment blanc. Ses longs cheveux, noirs et défaits, étaient rares comme ceux qui restent accrochés aux crânes des momies. Elle ne le regardait pas. Elle avait les mains agrippées à la poignée coulissante de sa valise Samsonite noire. Samsonite : la marque de la valise qu’Antoine avait perdue, dans un aéroport, quelques années auparavant, avec les conséquences dramatiques qui s’en étaient suivies… Elle était noire, comme celle-ci… D’ailleurs, en l’observant bien, il semblait que ce fût exactement le même modèle…
Avant qu’Antoine ne pût protester, une autre dame, assise un peu plus loin, bouclée, pimpante, répliqua :
– Mais au contraire, madame : elles sont adorables, ces enfants. Drôles comme des diables, pleines d’inventions. Détendez-vous… Ce que vous appelez barbarie, c’est la relève des générations. Personnellement, je suis quand même rassurée de savoir que le monde a un avenir !
Antoine remarqua alors, à côté de cette dame à la chevelure bouclée, un homme en fauteuil roulant, à la mine défaite et au regard vague, qui manifestement voyageait avec elle. De temps en temps, la dame bouclée lui prenait la main et la caressait.
À destination d’Antoine, elle poursuivit, d’une voix chaleureuse et tremblante :
– Je vous en prie, monsieur, ne laissez jamais personne couper les ailes de ces petites filles : car ce qu’elles portent en elles est si énergique, mais si fragile !
Antoine lui répondit par un sourire embarrassé, qui tentait de concilier deux messages parfaitement contradictoires : l’un s’adressait directement à elle, la dame bouclée, pour la remercier de son soutien, l’assurer que non, évidemment, il ne laisserait personne etc., qu’elle pouvait compter sur lui, il serait toujours du côté de l’enfance, de sa spontanéité ; l’autre était destiné à tous ceux, probablement nombreux, qui, assis dans les environs, n’étaient pas d’accord (au premier chef évidemment la femme au visage très pâle), pour leur indiquer de façon un peu subliminale qu’en réalité (même si la politesse due à la dame bouclée ne permettait pas de le dire expressément), il ne croyait pas un mot de ces sornettes démagogiques, que le seul service à rendre à la jeunesse était de la tenir en respect, de lui fixer des limites, comme disaient les pédopsychiatres, et même qu’une bonne correction de temps en temps…
À cet instant des centaines de Smarties multicolores se déversèrent sur le sol de marbre blanc, dans un tintement joyeux, salués par les cris de liesse des deux monarques, comme après un lâcher de lions sur les chrétiens dans l’arène.
– Vous voyez ! dit la femme bouclée, en éclatant de rire.
Une troisième personne, un homme cette fois, plutôt costaud et déjà bronzé, intervint :
– Oui, je vois bien, madame. Justement. Comme vous, j’aime la vie, mais à un niveau de décibels un tout petit peu moins élevé, quand même. Et sous une forme un tantinet plus civilisée, si je peux me permettre.
Le débat était lancé. Dans la foulée, quatre ou cinq autres passagers rejoignirent la conversation, moins pour tenter de régler pratiquement la situation que pour donner leur avis, le plus tranché possible, sur le problème général de l’éducation. Au bout de quelques minutes, ils se déversaient rageusement les uns sur les autres de pleins paquets de lieux communs, de part et d’autre d’une tranchée imaginaire.
Antoine, quant à lui, se gardait bien d’intervenir. D’ailleurs, ses filles s’étaient tues, sans doute pour le plaisir de contredire, une nouvelle fois, les adultes. Leurs grosses couronnes, moins bien enfoncées que tout à l’heure, penchaient légèrement au-dessus de leurs petites têtes blondes. Jusqu’à nouvel ordre, elles étaient redevenues des anges. Antoine pensa aux bébés d’Eschmoun, adorables statues de marbre que des parents, autrefois, avaient fait sculpter d’après la forme de leurs enfants, pour rendre grâce au dieu guérisseur de les avoir sauvés d’une grave maladie.
Antoine profita de ce répit pour s’intéresser de plus près à son environnement immédiat. En y réfléchissant, se dit-il, la facilité avec laquelle tous ces gens qui, en principe, ne se connaissaient pas, s’étaient mis à se parler, à faire salon dans l’aéroport, même si c’était pour s’insulter, était assez surprenante. Presque suspecte.
La plupart, il est vrai, étaient restés à l’écart de la discussion. Ils semblaient même s’en foutre royalement. Les éclats de voix ne les avaient pas un seul instant fait lever les yeux de leurs tablettes numériques. Mais précisément : cela, non plus, n’était pas normal. Ils auraient dû, comme Antoine, s’en alarmer. Leur indifférence donnait le sentiment d’une forme de connivence avec les autres qui péroraient. Ils ne les écoutaient pas, mais à la manière dont on finit par s’ignorer au sein d’une même famille lorsque, assis tous ensemble dans le salon, les uns regardent la télévision sans prêter la moindre attention à la vieille tante qui, à quelques mètres à peine, essaie pourtant de dire quelque chose.
« Ces gens-là se connaissent », conclut Antoine. D’ailleurs, s’il avait eu davantage le sens de l’observation, il aurait remarqué depuis longtemps – il ne s’en avisait qu’à l’instant – ce bracelet que tous portaient au poignet. Un mince bandeau de tissu coloré, passé dans un médaillon de plastique sur lequel était incrusté, lisible même à quelques mètres, la lettre « K ».
Le fin mot de l’énigme était là : l’intégralité des passagers du vol 407 pour Alexandrie étaient des clients du Kloub. Lequel avait spécialement affrété le Boeing qui allait bientôt décoller pour ses « M.E. », ses Membres Exquis – appelés également, plus officieusement, les « Kloubeurs », expression qu’en ce qui nous concerne, nous tâcherons d’éviter.
Antoine et ses filles ne faisaient pas exception. Eux aussi, bien sûr, se rendaient au Kloub. Mais Antoine aurait aimé que cela restât plus discret. Pour sa part, il avait laissé les bracelets dans le kit de bienvenue rangé dans sa valise. Il pensait ne retrouver les autres M.E. que sur place, une fois franchie l’enceinte du Kloub, à l’abri des regards. Or, voilà qu’il était parqué dès à présent avec ses futurs compagnons de vacances, dans un carré réservé, au vu et su de tout l’aéroport. L’aéroport, soit précisément un lieu qu’Antoine affectionnait pour l’anonymat qu’il était censé garantir, dans lequel il aimait se fondre, pour n’y être plus qu’un individu en transit parmi des milliers d’autres, sans attaches, sans passé, et avec pour seul avenir une destination étrangère inscrite sur un écran de contrôle.
– On est une bande de jeunes ! hurla une grosse voix qui fit sursauter Antoine.
– On s’fend la gueule ! répondit du tac au tac une autre.
Et plusieurs, autour d’elles, de partir dans un grand éclat de rire.
Antoine vérifia. Il était très exagéré de qualifier cette assemblée de cadres plus ou moins supérieurs à la mine jaune, épuisés par une année de vie de bureau, de « bande de jeunes ». Parmi les M.E., il y avait bien aussi quelques grands adolescents, mais ce n’était pas eux qui avaient crié. Ils avaient accueilli le numéro des adultes comme à leur habitude, avec un air consterné.
Quant à lui, Antoine, même s’il n’était pas exactement un cadre supérieur, il avait dépassé quarante ans, l’âge où l’on cesse officiellement d’être jeune. En outre, comme cela arrive souvent à cette époque de la vie, l’ensemble des certitudes sur lesquelles il avait construit la première moitié de son existence avait dernièrement volé en éclats. Sa femme l’avait quitté et d’autres problèmes, pas tout à fait menus, et dont le lecteur sera bientôt informé, étaient venus s’ajouter à cette première contrariété. On comprendra dans ces conditions qu’il ne se sentît pas immédiatement enclin au rire.
2.
– Ladies and gentlemen, nous vous demandons toute votre attention pendant la présentation des consignes de sécurité.
Sous l’épaisse couche de maquillage réglementaire, le visage de SAMIA (son prénom était inscrit en lettres capitales blanches, sur le badge épinglé sur le revers de sa veste rouge) n’était pas directement visible. On devait déduire sa beauté, comme on le fait, pour celle des souveraines disparues, du masque mortuaire qui recouvre leurs dépouilles et manifeste, pour toujours, la splendeur qui fut la leur. Superbement indifférente aux mortels qui peuplaient la cabine de l’aéronef, Samia leur donnait pourtant des instructions de survie « en cas de dépressurisation de l’appareil ». De ses mouvements hiératiques, elle mimait les gestes qui sauvent.
Pour chacune des catastrophes recensées dans la nomenclature de l’organisation de l’aviation civile internationale, elle avait une réponse. Pourvu que l’on fût calme et méthodique, que l’on pensât d’abord à soi-même (avant de venir au secours des autres, des enfants notamment), il n’était pas une situation désespérée dont on ne pût venir à bout sans peine, et sans dommage pour son rouge à lèvres. Ainsi parlait sous l’uniforme le corps de Samia, plus souple que le rameau, plus élancé que l’alif, cette première lettre de l’alphabet arabe qui ressemble à une flèche tendue vers le ciel.
Samia ne semblait pas concernée par la pièce muette qu’elle jouait à l’intention des passagers. À force de l’avoir répétée, vol après vol, parfois plusieurs fois par jour, elle devait bien sûr s’être lassée. Et parce qu’aucun accident, ni même incident grave, probablement, ne lui était jamais arrivé, peut-être voyait-elle dans cet exercice une formalité un peu vaine, presque ridicule ; peut-être avait-elle oublié, aussi, que son statut de personnel de bord ne lui conférait aucune immunité, qu’elle était exposée aux mêmes risques que les autres. Mais une tout autre interprétation était également possible : en réalité, l’espèce d’apathie de Samia pouvait tenir à ce qu’elle était morte depuis longtemps, dans un terrible accident d’avion, au cours duquel elle avait complètement paniqué, contribuant par son manque de sang-froid à en précipiter l’issue fatale ; et peut-être que de l’au-delà, désormais instruite de tous les tours pendables que sait jouer la mort, elle nous avertissait, elle nous mettait en garde, sur le mode éthéré qui était le seul désormais que lui autorisait son statut de trépassée, afin qu’on ne l’imitât pas, et qu’elle ne fût pas morte pour rien.
Cette seconde hypothèse avait la préférence d’Antoine. Et cependant, songeait-il, comme Samia était la plus belle, plus belle que toutes les vivantes de l’avion réunies, son avertissement pouvait ne pas avoir l’effet escompté. On pouvait, au contraire, avoir envie de ne pas lui obéir, et de plonger tête baissée dans la catastrophe, de s’y engloutir, afin de la rejoindre, pour toujours, dans le royaume des morts.
Garance et Aubépine étaient fascinées par tant de beauté, tant de rouge à lèvres, tant de bleu sur les yeux. Elles avaient balancé leurs couronnes quelques rangées plus loin, provoquant quelques « oh ! » rageurs, et, oublieuses des consignes de sécurité que venait de donner leur idole, elles s’étaient mises debout sur leur siège et tournées vers leurs voisins de derrière. Leurs deux têtes dépassant juste du dossier, elles les regardaient fixement avec une moue superbe de mépris. Elles aussi, déjà, voulaient être belles, irrésistibles, et mettre la foule sous le joug de leur splendeur inaccessible.
Le vol se déroula sans encombre, en dépit de ce que les avertissements de l’hôtesse de l’air avaient pu laisser craindre. Antoine et ses filles étaient maintenant sur le tarmac de l’aéroport d’Alexandrie. Avant de rejoindre le hall des arrivées, ses deux enfants dans les bras, Antoine se retourna vers l’aéronef vidé de ses passagers. Au sommet de la passerelle, sur le seuil de la porte avant de l’avion, Samia regardait au loin. Ses yeux baignés de larmes creusaient un large sillon dans le fond de teint, découvrant le frémissement de sa peau nue.
Les vacances qui commençaient ne se présentaient pas sous un jour pleinement rassurant.
3.
Disons-le d’emblée, pour couper court à tous les fantasmes : l’Antoine Galland que nous venons de voir à l’aéroport et dans l’avion n’avait aucun rapport avec Antoine Galland, le fameux traducteur des Mille et Une Nuits. Il s’agissait de deux personnes distinctes, nées à plus de trois cents années d’intervalle, et n’ayant en outre, l’une avec l’autre, aucun lien de parenté.
Au départ, cette homonymie n’avait d’ailleurs pas beaucoup affecté l’existence du second Antoine Galland. Tout simplement parce que, contrairement à ce qui vient d’être affirmé trop rapidement, l’Antoine Galland du XVIIe siècle n’était en réalité pas si fameux que cela (du moins jusqu’à ces derniers mois, qui avaient singulièrement changé la donne, mais nous verrons cela un peu plus tard). En dehors d’une poignée de spécialistes, on n’était pas très loin, même, pour être honnête, du parfait inconnu. Il y avait peu de chance, par conséquent, que l’Antoine Galland du XIXe siècle fût très souvent importuné, au guichet d’une administration, au comptoir d’un hôtel, ou encore lorsqu’un gendarme contrôlait ses papiers, par des allusions, plus ou moins explicites – clin d’œil, sourire entendu, exclamation de surprise amusée, voire réaction d’extase –, au grand arabisant mort en 1715. Être confronté à des remarques du genre : « C’est drôle, vous portez le même nom que le célèbre traducteur des Mille et Une Nuits ! », ou encore, pour les personnes fâchées avec la chronologie : « Mais alors, Antoine Galland, c’est vous ? », voire : « Waouh, je le crois pas, Antoine Galland, comme the Antoine Galland ? » était hautement improbable.
Pour dire la vérité, cela ne lui était même jamais arrivé.
D’ailleurs, une rapide recherche dans l’annuaire permettait de constater qu’il y avait, en ce moment même, des dizaines d’autres Antoine Galland résidant, comme disent les gendarmes (encore eux), sur le territoire national, ce qui était la preuve que les personnes s’appelant Galland ne voyaient pas malice à prénommer leur fils Antoine, que pour eux cela n’évoquait rien de spécial, cela sonnait bien, c’était tout. (Les choses étaient bien différentes, par exemple, pour les individus, au demeurant moins nombreux, répondant au patronyme de Commode : ils y réfléchissaient à deux fois avant de baptiser leur enfant Célestin, comme l’actuel Président de la République, Célestin Commode, un personnage de plus en plus controversé.) Les parents de notre Antoine Galland, celui de l’aéroport, étaient comme les autres : ils n’avaient jamais entendu parler du grand savant de l’époque du Roi-Soleil, ce n’était pas le genre de choses qui les intéressait. Antoine, en revanche, était un joli prénom, grave et tendre, avec ce qu’il fallait de tristesse pour être pris au sérieux – et aimé.
Si nous faisons pourtant la remarque, c’est que les destins des deux Antoine Galland, celui du XVIIe siècle et celui de l’aéroport, avaient fini par se croiser, comme tout ce livre en portera témoignage. Tâchons de comprendre comment les choses avaient commencé.
Originaire de la Douvre intérieure, qui avait eu, naguère, son quart d’heure de célébrité – quand la population de ce modeste département avait soudain décidé de se soulever contre le pouvoir central, avant de se raviser presque aussi sec1 –, le second Antoine Galland (que par commodité nous désignerons parfois sous le nom d’Antoine Galland junior, ou plus simplement encore par son prénom : Antoine) était le fils de Gisèle Galland, celle-là même qui tenait le magasin de prêt-à-porter situé au bout de la grand-rue de la petite ville de Chantaume : Chez Gisèle – du basique au très chic. Il n’avait guère connu son père, trop occupé à boire et à se quereller avec les rares Arabes que comptait la ville à propos de la guerre d’Algérie.
Selon certains de ses anciens camarades – prompts, comme c’est généralement le cas des anciens camarades, à la médisance –, Antoine avait passé sa jeunesse dans les jupons de sa mère. Ce n’était pas exact. Les jupons de sa mère l’avaient moins intéressé que ceux qu’elle exposait dans sa boutique (car dans la Douvre, au début des années 1980, on vendait encore des jupons), destinés à être portés par d’autres femmes, ses clientes, et toute la collection de sous-vêtements qu’on y trouvait. Un jour, il n’était pas vieux à l’époque, peut-être trois ans à peine, Gisèle l’avait surpris dans la cabine d’essayage, la tête tout encapuchonnée dans le bonnet extra-large d’un soutien-gorge vermillon vif. C’était depuis ce jour, dit-on à Chantaume, que sa mère, riant aux éclats, l’avait surnommé mon petit chaperon rouge.
De cette époque aussi, sans doute, remontait l’image formidable, excessive, qu’il s’était forgée de la femme, comme d’une montagne à escalader, faites de gorges et d’abîmes profonds, de vallées immenses et douces, mais glissantes, de cascades de cheveux ondulés, dans lesquels on pouvait s’enfouir, au risque de se perdre.
Au même moment avait pris naissance l’intérêt, jamais démenti par la suite, qu’il portait aux contes. Le Petit Chaperon rouge, d’abord : il lui fallait comprendre son surnom. Les récits de Perrault, découverts à cette occasion et que sa mère lui lisait le soir, après avoir fermé la boutique, le divertirent un temps. L’écoute de ces histoires, cependant, le laissait un peu sur sa faim. Elles étaient belles et terribles, bien sûr ; mais pas si belles, ni si terribles qu’il l’aurait voulu. Évidemment, il ne le formulait pas ainsi (on parle d’un enfant qui ne savait pas encore lire), mais il leur trouvait un côté provincial, un côté « c’est arrivé près de chez vous », si vous voulez, qui lui refroidissait l’imagination. Ce loup semblait rencontré dans la forêt d’à côté, qui commençait à quelques dizaines de mètres du magasin ; malgré les trois cents années d’intervalle, ce Poucet, malin comme l’étaient tous les petits paysans des environs, était le portrait craché de son camarade de classe, Nicolas Millegarde, qui se débrouillait toujours pour récupérer un goûter malgré la pingrerie de ses parents qui ne lui en donnaient jamais ; et jusqu’à cette Barbe bleue, qui évoquait le monsieur sévère, à la chevelure légèrement bleutée, justement, qui habitait dans la grosse maison à l’entrée du bourg, et qui tous les mois passait à la boutique, avec sa très jeune femme, qui ne semblait jamais la même d’un mois à l’autre, pour s’enquérir des nouveautés… La familiarité des situations – qui, en dépit des horreurs et des fées, sentait à plein nez son terroir français – lui déplaisait. Sans parler de cette morale à la fin qui empaquetait le tout, une petite morale paysanne, à la fois courte et épaisse (belles jeunes filles, il ne faut pas parler à n’importe qui dans les sous-bois, surtout lorsqu’il a de grandes dents) : un véritable tue-l’amour. Comment le dire ? Il était certaines contrées où ces histoires ne s’aventuraient pas. Et même dont elles interdisaient formellement l’accès. Or, la vie – il en avait eu la première fois l’intuition sous le vaste capuchon de dentelle rouge, dans l’éblouissement kaléidoscopique provoqué par la lumière se diffractant à travers les jours de la dentelle – était infiniment plus colorée, plus dangereuse, plus désirable. Dans son intensité véritable, elle commençait précisément au-delà des limites que Charles Perrault et ses épigones européens lui avaient fixées.
Quelques années étaient passées. Il savait lire, désormais.
Son bonheur voulut alors qu’il trouvât, à côté de l’œuvre de Perrault, sur l’étagère à livres de la maison (le terme de bibliothèque serait excessif), un gros volume à la couverture plastifiée. Trois silhouettes noires enturbannées, à dos de dromadaires, s’y découpaient dans le désert, sur lequel étaient posés quelques palmiers et une sorte de palais, dont les minces ouvertures exhalaient une lumière jaune : quelqu’un veillait. Une femme, très certainement. En arrière-plan, une lune énorme, blanche et brillante, baignait dans un ciel bleu foncé. Un cartouche un peu grossier, tout en haut, ménageait une place pour le titre : Les Mille et Une Nuits, contes arabes. Dernier détail, et non des moindres : perdu dans le sable, un peu plus bas, en guise de sous-titre, on pouvait lire :
traduction d’Antoine Galland
Qu’un petit garçon de la Douvre comme lui, et qui n’en était jamais sorti, sauf une fois pour aller voir sa grand-tante à la mer, en Charente-Maritime, pût voir son nom ainsi figurer sur la couverture d’un livre, un livre de désert et de palmiers, de palais, et surtout de femme cachée à l’intérieur du palais, voilà qui venait confirmer de façon éclatante la haute opinion qu’il s’était faite de la destinée, en dépit de la réalité immédiate qu’il avait sous les yeux. L’univers était vaste, infiniment, et des communications secrètes, des raccourcis, permettaient à des points fort éloignés en apparence de se rejoindre. On mettait la tête dans un soutien-gorge et, de fil en aiguille, on se retrouvait sur le sable de l’Arabie, à deux pas des appartements de la sultane.
Sans doute n’était-ce pas exactement lui, sur la couverture, qui était à l’honneur, mais ce savant du XVIIe siècle dont il a déjà été question plus haut, et dont nous reparlerons plus bas, l’auteur de la traduction. La coïncidence, cependant, était loin d’être négligeable. Ce nom et ce prénom sur la couverture, c’était comme un laissez-passer, l’autorisation d’entrer dans un monde dont il avait, dans la cabine d’essayage, pressenti l’existence, et qu’il parcourait maintenant dans la réalité, au fil des pages de ce récit stupéfiant.
Lorsqu’on lui demanderait, des années plus tard, ce qui lui plaisait dans ce livre, il répondrait : « C’est la vie même, la vie sans fards. » Dieu sait pourtant qu’on n’y lésinait pas sur le maquillage, sans compter les voiles et les parfums, les bijoux et les pierreries. Mais l’âme humaine, dans le même temps, y était présentée dans son plus complet dénuement. Les dimensions véritables de la destinée lui semblaient ici rétablies, sans rapport avec la moindre proportion justement, affranchies de tout canon ; débarrassées de cette chape de raison qui d’ordinaire, sous nos latitudes en particulier, pesait sur elles si durement, »
Extraits
« Ça y est, monsieur le Président, je crois que nous y sommes.
Dans le bureau lambrissé, un petit jeune homme, assez dégarni déjà, avait fait irruption sans frapper, en brandissant un gros volume à la couverture plastifiée. Trois silhouettes noires enturbannées, à dos de dromadaires, s’y découpaient dans le désert sur fond de lune et de palais scintillant. Le lecteur attentif aura reconnu l’édition, déjà rencontrée, de la traduction des Mille et Une Nuits par Antoine Galland.
– Antoine Galland: voilà l’oiseau rare que vous cherchez, expliqua le collaborateur déplumé. Ce petit Français du Grand Siècle coche toutes les cases. Parti de rien, originaire d’une province reculée du royaume, il a mis son énergie et son intelligence, qui étaient grandes, au service de la connaissance de l’Autre: c’est-à-dire de l’Arabe, du Mahométan. Il l’a révélé au public occidental sous son plus beau jour, celui du faste de ses palais, du ventre généreux à ses femmes, de la malice de ses djinns. Catholique fervent, il a voulu cependant que les musulmans fussent compris et aimés. Il a poussé la générosité jusqu’à enrichir leur propre patrimoine littéraire. Car je ne vous ai pas dit encore le plus incroyable. La plus fameuse histoire des Mille et Une Nuits, Aladdin et la Lampe merveilleuse, n’est pas l’œuvre d’un Arabe: mais d’Antoine Galland lui-même ! Et Ali Baba et les Quarante Voleurs, qui est à peine moins connu, qui croyez-vous qui l’ait écrit? Antoine Galland, encore. Un petit Français bien de chez nous! Et c’est le cas de beaucoup d’autres contes, plus vrais que nature, plus orientaux que les orientaux d’origine. Antoine Galland ne s’en est jamais vanté. Au contraire, toutes ces histoires confectionnées par son prodigieux cerveau, il les a fait passer pour de simples traductions. Il a gardé le silence, avec une modestie admirable, sur son propre rôle de créateur. La France, c’est cela, c’est Antoine Galland: cette générosité, cette façon de connaître et de comprendre les autres – parfois même, il faut bien le dire, notre modestie dût-elle en souffrir, mieux qu’eux-mêmes ne le peuvent ! On ne le dira pas trop fort, bien sûr, ajouta le conseiller, mais on chercherait en vain, dans tout le monde arabo-musulman, une telle curiosité, une façon aussi désintéressée de parcourir le vaste monde pour en célébrer les beautés d’où qu’elles viennent. Monsieur le Président, Galland, dans l’histoire de la littérature, c’est un événement… » p. 67-68
« Avec Aladdin, les Français prenaient leur revanche sur tous les maux dont ils s’estimaient frappés. Aladdin, c’était l’ascension sociale fulgurante d’un vaurien devenu, par les vertus combinées de la chance et du mérite, plus puissant et valeureux que le sultan. C’était aussi l’amour absolu, car tous les pouvoirs de la lampe, Aladdin les avait sacrifiés à la conquête de la princesse Badroulboudour. Aladdin incarnait enfin – et cet aspect des choses n’était pas négligeable – l’Orient made in France, une façon, avait déclaré un proche de l’Élysée à la presse, sous couvert d’anonymat, de rappeler à «nos amis musulmans, dont certains du reste sont nos compatriotes, que leur civilisation n’a guère de secrets pour nous, que depuis bien longtemps déjà, nous l’avons assimilée dans ce qu’elle a de meilleur, meilleur dont nos amis musulmans, soit dit au passage, feraient bien de s’inspirer eux aussi. » p. 74
À propos de l’auteur
 Jean-Baptiste de Froment © Photo DR
Jean-Baptiste de Froment © Photo DR
Jean-Baptiste de Froment est né à Paris le 7 octobre 1977. Haut-fonctionnaire, homme politique et écrivain, il est Normalien et agrégé de philosophie. Ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, il est membre du Conseil d’État et depuis 2014. A été élu au Conseil de Paris, ainsi qu’à la métropole du Grand Paris. Après un premier roman, État de nature (2019), il publie Badroulboudour en 2021. (Source: Babelio)
Page Wikipédia de l’auteur
Page Facebook de l’auteur
Compte Twitter de l’auteur
Compte instagram de l’auteur
Compte Linkedin de l’auteur
Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)
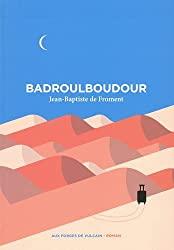



Tags
#Badroulboudour #JeanBaptistedeFroment #AuxForgesdeVulcain #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2021 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #VendrediLecture #RentréeLittéraireaout2021 #rentreelitteraire #rentree2021 #RL2021 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #auteur #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #Bookstagram #Book #Bookobsessed #bookshelf #Booklover #Bookaddict
