En deux mots
En 1929 Szonja quitte la Hongrie pour venir travailler dans les usines textiles de la région lyonnaise. Les rêves de liberté qu’elle caresse vont vite se heurter à la dure réalité des cadences infernales et des odeurs toxiques. Peut-être qu’un mari pourra lui ouvrir de nouvelles perspectives.
Ma note
★★★ (bien aimé)
Ma chronique
Szonja ou la vraie vie
Paola Pigani s’est plongée dans l’histoire industrielle de la région lyonnaise pour retracer le destin des immigrés engagés pour produire la soie artificielle. À travers l’histoire de Szonja, ce sont les luttes ouvrières des années 1930 qu’elle fait revivre.
Deux jeunes filles essaient de dormir un peu dans le train qui les mène de Budapest à Lyon. Márieka et Szonja font partie d’un contingent d’ouvrières recrutées en Hongrie pour servir de main d’œuvre dans les usines de viscose. Depuis 1923, de «bons patrons» recrutent à tour de bras, notamment en Italie, en Pologne et en Hongrie, mais aussi en Arménie et en Espagne pour faire tourner ces usines monstrueuses ou la chimie transforme les matières premières en soie artificielle.
À peine débarquées de la gare de Perrache, un bus les conduit dans un pensionnat aux règles strictes où les religieuses les logent et les nourrissent contre un loyer défalqué de leur paie qui est inférieure à celle des françaises et à celles des hommes qui touchent 3,50 francs de l’heure. Là encore, il n’est pas question de se reposer, le travail attend. Après avoir pointé, dix heures éprouvantes attendent les salariés dans des relents de vapeurs chimiques. Pour Szonja comme pour les autres, il faut tenter d’apprivoiser les étapes de fabrication, tenir la cadence, apprendre une langue et des termes techniques qui ne lui disent rien.
«Szonja fixe des yeux les flottes de viscose, ces écheveaux visqueux; il lui faut rester attentive à la transformation de la matière souple jusqu’au débit du fil sans fin qu’elle tire avec les mêmes pensées. Elle se crée des rituels, imagine des choses pour oublier la fatigue, y fait un nœud mental à chaque heure écoulée de la matinée. Ensuite, elle oublie, puise dans la coulée des gestes répétitifs. Une mélancolie nouvelle s’étire alors, tandis que la pluie s’abat sur la verrière.»
Au fur et à mesure que les semaines passent, il n’y a guère que les sorties dominicales avec ses sœurs d’infortune qui mettent un peu de baume au cœur. Elles font alors le constat de leur échec. Leur rêve de liberté s’est transformé en une nouvelle servitude que leur maigre pécule ne pourra compenser. Reste la perspective de trouver un mari, de quitter le pensionnat Jeanne d’Arc, de fonder une famille. Méfiante, Szonja finit par répondre aux avances de Jean et accepte de l’épouser. Le couple va pouvoir emménager dans un appartement au quatrième étage de la cité. Une nouvelle expérience qu’ils doivent Gérer, trouver leurs marques, afin de partager au mieux leur quotidien de misère. Mais le combien le conte de fées est bien loin et très vite les soucis se transforment en griefs puis en coups. La crise de 1929 se fait aussi sentir aussi à Vaulx-en-Velin. Le travail se fait plus rare. Il faut fermer des unités, licencier. Le tout accompagné de relents xénophobes. Ceux qui échappent à la porte voient leurs conditions de travail se dégrader encore. La maladie, l’alcool et la violence domestique sont des fléaux qui s’étendent bien plus vite que les mouvements syndicaux qui réclament juste un peu de justice sociale.
En étudiant les archives et en fouillant la mémoire ouvrière, Paola Pigani ne donne pas uniquement de la chair et de la véracité à son récit, elle brosse un pan d’histoire qui résonne tout particulièrement aujourd’hui, au moment où une frange croissante de la population voit dans les immigrés la cause de tous leurs maux. Vision simpliste et nauséabonde qui ne tient pas au regard d’une réalité bien plus complexe. Szonja n’est pas sans rappeler, bien des années plus tard Elise ou la vraie vie de Claire Etcherelli ou encore, pour la solidarité ouvrière, le Germinal de Zola. Un roman fort, de ceux qui laissent une marque indélébile à ses lecteurs.
Et ils dansaient le dimanche
Paola Pigani
Éditions Liana Levi
Roman
240 p., 19 €
EAN 9791034904303
Paru le 26/08/2021
Où?
Le roman est situé en France, à Vaulx-en-Velin et dans la région lyonnaise. On y évoque aussi les pays d’origine des migrants, et principalement la Hongrie et l’Italie.
Quand?
L’action se déroule de 1929 à 1936.
Ce qu’en dit l’éditeur
Sur le quai de la gare de Perrache, un jour de l’année 1929, une jeune Hongroise, Szonja, a rendez-vous avec son avenir : la France où brillent encore les Années folles et l’usine qui l’a embauchée à la production de viscose. Répondre au désir des femmes d’acquérir ces tissus soyeux à bas prix ne lui fait pas peur. Son rêve, c’était de quitter le dur labeur de paysanne. À Vaulx-en-Velin, dans la cité industrielle, elle accepte la chambre d’internat chez les sœurs, les repas au réfectoire et les dix heures quotidiennes à l’atelier saturé de vapeurs chimiques. Les ouvriers italiens ne font-ils pas de même ? Elsa, Bianca, Marco et les autres tiennent les rythmes épuisants, encaissent les brimades des chefs, inhalent les fumées nocives contre de maigres salaires. Cela ne les empêche nullement de danser le dimanche au bord de la Rize.
Dans ces modestes vies d’immigrés, la grande crise fera irruption, amenant chômage, mise à l’écart des étrangers et affrontements avec les ligues. Portée par une inébranlable solidarité et une détermination à vivre, la colère constituera le socle de leur rassemblement, jusqu’à aboutir au Front populaire.
Après les soyeux, la légende lyonnaise des viscosiers.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Goodbook.fr
L’usine Nouvelle (Christophe Bys)
France 3 Auvergne Rhône Alpes (Franck Giroud)
SoundCloud (Lyon demain, Gérald Bouchon)
Blog Le tourneur de pages
Blog Surbooké (Laurent Bisault)
Blog Le fil de Mirontaine
Blog Alex mot-à-mots
Paola Pigani présente Et ils dansaient le dimanche © Production Librairie Mollat
Les premières pages du livre
« Prologue
« Je t’attends, je serai patiente », m’a-t-elle dit dans un rêve, son visage voilé par un rideau. À peine ai-je eu le temps de distinguer une silhouette, des boucles brunes, des jambes maigres au ras d’une combinaison, une poignée d’épingles à cheveux sur une sorte de guéridon. De toutes mes forces, j’ai essayé de retrouver ses traits, de parfaire le rêve, donner chair à une image furtive, l’habiller de temps, de mémoire. Je serai patiente.
Ces mots m’ont poursuivie alors que je tentais de distinguer la provenance d’un bruit étrange dans la chambre. Il m’a semblé entendre une feuille tomber, puis deux. J’ai arpenté mon petit périmètre de silence. Le bruit a repris, comme la chute d’une présence infime. J’ai laissé mon regard flotter de part et d’autre de la pièce, oubliant tout ce qui pouvait parvenir de l’extérieur, oubliant la ville et ses rumeurs d’asphalte, le soleil trop fort qui cognait au carreau. Aux aguets entre les murs, je me sentais devenir la proie de moi-même. C’est alors que j’ai aperçu contre la plinthe une sorte de phasme, un brin de vie mi-paille mi-herbe qui tentait de retrouver le plein air, le plein jour, la pleine clarté. Une créature minuscule, une fibre froissée dans un coin de ma chambre et de ma vie.
« Je t’attends, je serai patiente, je reviendrai. » C’était elle, la femme de mon rêve. J’ai compris alors que je partirais de rien, d’un soupçon d’existence, d’un fil de rayonne aussi ténu que celui d’une araignée.
J’allais devoir écarter le rideau doucement, l’approcher, la nommer, la déloger aussi d’une des alcôves de la mémoire ouvrière. Cerner son histoire traversée de toutes les fatigues, de tous les élans. Suivre la ligne de l’Est jusqu’au passage des migrants, m’attacher à ceux qui avaient fondé une ville de banlieue autour d’une des plus grandes usines de textile artificiel en France, marcher dans les gravats, imaginer derrière chaque pan de l’effondrement ce qui s’était construit de la solidarité. Une épopée ouvrière, cosmopolite et fragile, au siècle dernier.
Parce que rien n’éblouit cette mémoire, sinon les traces de l’effort humain.
Épaule contre épaule, leurs deux visages dans l’anse de leurs cheveux mêlés. Impossible pour l’une de remuer une main sans réveiller l’autre. Szonja s’est endormie contre Márieka. Ni elles ni ceux du convoi ne traverseront l’océan, n’atteindront les Amériques. Tous suivront la voie tracée dit-on par MM. Gillet et Chatin. De bons patrons les attendent en France, convoitant depuis 1923 une main-d’œuvre servile et bon marché, qui ont cru en l’avènement de la viscose, cette soie artificielle dont se vêtent déjà à bas prix toutes les femmes d’Europe, dont on va pouvoir fabriquer les meilleurs parachutes pour la prochaine guerre.
Lorsqu’elle se réveille, Szonja fixe à l’angle du wagon les reposoirs en bois où valises et cabas à provisions ont été hissés. Une louche en cuivre dépasse de l’un d’eux et prend la lumière des réverbères à chaque gare. Un petit soleil témoin pour elle seule. Le voyage est si long depuis Budapest qu’un fragile mouchoir de poussière s’est accroché à la hauteur des rideaux en gros drap. Son regard oscille entre ces deux points d’accroche.
Des poivrons, des oignons crus passent de main en main, puis des œufs durs, des petits pains au pavot. Szonja voudrait tout avaler à la fois sans rien connaître des villes traversées – Vienne, Linz, Munich, Berne, Genève – ni des villages perdus dans le magma de la nuit. Être déjà arrivée, trois ou quatre jours plus tard à Lyon avec une vraie faim, un espace dans son corps et dans sa tête où pourraient s’incruster l’attente, le désir, une autre Szonja.
Pour l’heure, elle a du mal à se déplier dans ce compartiment où les voyageurs sont tellement serrés les uns contre les autres. Entre les pépiements des femmes, les montées de tabac des hommes et le tempo régulier du train sur les rails, elle n’a droit qu’à un sommeil coupé menu. Elle sait à peine ce qui l’attend, là-bas, un contrat pour quelques mois, chambre et repas dans un pensionnat dont les frais seront prélevés sur sa paie. Travailler dans une usine en France, loin des paysans de Sárvár, des champs de houblon, de betteraves, avoir une place parmi les hommes, gagner son propre argent. Szonja ne pense pas à être libre. Le pays qui s’annonce au-delà des brumes n’a pas de contours. Liberté et rêve ne ressemblent à rien.
Dans les couloirs du wagon, le petit monsieur à chapeau gris repasse pour la troisième fois avec une jeune femme qui traduit en hongrois ses consignes à tous. Ensemble, ils vérifient les noms sur un registre que l’homme tient avec autant de dévotion qu’une bible, s’assurent que personne ne manque, qui aurait renoncé la veille du départ, ravalé par une fiancée ou une mère en larmes, ou par le sentiment de trahir les siens. Peut-être se sent-il prophète à cette heure, l’homme si grave au registre, ayant le devoir de guider leur petit peuple indigent ? Parmi les six cents voyageurs, près de la moitié ira à Vaulx-en-Velin, en périphérie de Lyon, les autres à Izieux et à Échirolles. Un contingent a déjà été détaché pour une usine de Colmar.
L’aventure en grise certains. Pour eux, la chance penche vers des collines, des rivières, des villes aux vitrines illuminées. Pour les autres, la peur se niche entre les mains croisées sur des genoux secs et sages. Ne pas remuer l’air, ne pas réagir à la promiscuité, ne pas entraver l’allant dans le convoi des vaillants.
Avant la prochaine gare, un couple s’agite, s’habille à la hâte. L’homme enjambe plusieurs paires de genoux couverts d’enfants et de victuailles, saisit leur unique valise. Sa femme secoue la tête sans un mot face aux visages étonnés du wagon entier. Tous les deux se dirigent vers le bout du couloir avant de sauter comme des fugitifs sur le quai désert. Des centaines d’yeux les regardent disparaître dans le noir. On ne veut pas savoir s’ils ont raison ou tort, s’il faut croire à la suite aveugle du voyage pour émigrer dans l’espoir.
Szonja imagine qu’après ce train il y en aura d’autres, et au bout des voies ferrées un tramway ou un autocar jusqu’à l’usine. Ses chaussures sentent déjà l’immobilité moite. Elle les ôte, traverse le wagon en socquettes, puis le suivant, une forêt avec ses odeurs fauves, ses hommes à la lisière des compartiments qui fument et l’avalent du regard. Elle s’écarte d’eux, se plaque contre les parois du couloir pour éviter de les frôler. Un grand brun lui glisse tout bas qu’elle ressemble à Erzébet Simon, lui demande si elle est juive, comme cette Miss Europa 1929 qui vient d’être élue plus belle femme d’Europe, beauté consolante pour le peuple hongrois depuis la dislocation de l’Empire. Szonja s’éloigne des garçons, ne rougit même pas à leurs allusions. Ils sont quelques-uns, comme eux, à vouloir mettre à profit les longues heures du voyage pour faire la cour aux filles, gagner du temps, ne pas risquer de les voir un jour entre les bras d’un Français. Ils rêvent de fiançailles sauvages en chemin de fer. Ils aimeraient franchir à deux, enlacés, les grilles du paradis de l’Homme nouveau.
Le crépuscule brouille les visages dans les coursives mal éclairées. Szonja revient s’affaler sur la banquette du wagon. La pluie bat les vitres tandis que ses voisins mangent un fruit en silence, gardent le plus longtemps possible leur couteau dans une main, un morceau de pain dans l’autre, pour que dure le goût d’hier. Leurs doigts attentifs autour du fruit ou de la miche déjà un peu rassie.
La jeune fille essaie de les oublier et de rendormir les dernières images qui s’enroulent autour d’elle comme la vieille laine de son chandail où glissent ses mains froides.
C’était quelques semaines avant le départ. Elle était restée assise sur un talus en bordure de champ, avait frotté la terre qui maculait ses bas de laine, s’était relevée un peu trop brusquement comme pour secouer le ciel de bruine et l’impression d’appartenir à un monde las. Une oie s’était approchée de la mare, à dix pas de Szonja, lourde et laide dans son gloussement poussif. Cette vision de grasse volaille sans désir de voler l’avait soudain traversée. Non, elle n’allait pas devenir ainsi. Faire sa vie avec un paysan de Sárvár ou de la plaine de Pécs. N’avoir pour horizon que des lignes tremblantes de blé, les houblonnières, les touffes bleues des choux, le vieux verger du père. Ne porter qu’une robe par saison, les mêmes chaussures toute la vie pour les mêmes routes villageoises.
Sa cousine Márieka l’avait rejointe et elles étaient allées à l’épicerie acheter du sucre et du fil à coudre, s’étaient attardées dans leurs rires, l’oubli des besognes, avaient gaspillé quelques minutes encore à lire des avis à la population sur le mur de l’école. Un vol de cigognes était passé au-dessus de l’église. Leurs deux visages tournés vers le ciel avaient suivi les ailes, les nuages dans la même blancheur de céruse, un flou presque sale. Szonja avait tiré sa cousine par la manche et l’avait contrainte de revenir sur leurs pas. Peut-être n’avaient-elles pas tout saisi de l’affiche de recrutement.
« Recherchons ouvriers hommes, femmes de seize à quarante ans, familles, couples, célibataires bien-portants pour un travail dans une nouvelle usine de textile en France. Contrat de trois mois renouvelable en fonction de la valeur à la tâche. Transport et logement assurés et déduits de la paie par quinzaine. Se présenter ici même le 4 novembre à partir de neuf heures. Priorité sera donnée aux anciens ouvriers de l’usine de Sárvár. »
Elles s’étaient demandé un instant ce que signifiait « bien-portants », s’étaient tâté les bras et pincé les hanches. Oui, elles pouvaient prétendre à un travail d’ouvrières là-bas, loin des terres magyares et de leurs hommes à longue moustache. Le balancement du panier qu’elles tenaient à deux avait repris entre leurs jupes. Márieka avait fait halte soudain. Grave, elle avait cherché dans les yeux de Szonja ce bleu d’enfance qui dansait encore. Lui avait secoué les mains. « Toi et moi, on va y aller ! »
Deux bouches en moins à nourrir dans leurs familles. Moins de draps à laver. Deux bouches à remplir de mots nouveaux, France, ouvrière, usine. Deux bouches qui redoubleraient d’audace, d’une faim vorace. Elles allaient se faire leur propre dot d’avenir.
Puis tout était allé très vite. Être pauvre, c’est savoir se jeter sans état d’âme dans un ailleurs. Plier sa vie dans une valise en carton bouilli, entre quelques vêtements et des rêves de second choix.
Leur grand-mère leur avait donné un coupon de tissu qu’elles avaient partagé pour se coudre deux robes identiques toutes droites, et avec les chutes elles s’étaient fait des rubans un peu grossiers pour se nouer les cheveux. Elles n’en aimaient pas le motif, des rayures gris et grenat. Elles n’aimaient ni leurs souliers plats, ni les premières, ni les dernières lamentations de la grand-mère, ni l’idée de monter dans un train interminable avec des villageois trop familiers.
Un matin, déjà éprises de leur nouvelle vie, elles avaient coupé leurs lourdes nattes pour dégager leur nuque, à la mode de Budapest, et elles s’étaient promis de ne jamais porter de fichu sur la tête. Une envie d’avoir une longueur d’avance sur la beauté des femmes alors que leurs pommettes rosies et leur allure gauche trahissaient encore leurs dix-sept ans. Les parents, eux, ne disaient rien, leurs filles ne partiraient pas pour longtemps, six-huit mois tout au plus. On les avait recommandées aux agents du recrutement et au prêtre, garant de la moralité des travailleurs : des jeunes filles droites et courageuses, ayant déjà embauché à la sucrerie près de Sárvár. Au moins, elles reviendraient avec un peu d’argent, après cette crise qui jetait tant de désœuvrés sur les routes.
La veille du grand départ, Szonja avait encore aidé le père à remplir un tombereau de betteraves, poussé les oies dans leur enclos, curé ses ongles terreux, lavé ses cheveux avec une excessive lenteur, enduit ses mains de saindoux pour en atténuer les gerçures. Puis elle était allée vider la bassine dehors pour regarder le soleil rougir les chaumes derrière le puits. Elle avait voulu provoquer contre l’anse du seau en zinc le petit cri de rouille de la chaîne qui l’amusait enfant, se donner le courage de balancer aussi les doutes et les craintes de la grand-mère. Après ça, ne rien entendre, ne plus rien voir, laisser l’eau noire, au fond, tout au fond. Tourner en rond dans le jour finissant, essayer de repousser la lumière alentour, penser à des choses simples et idiotes.
Szonja avait juré, craché sur le cuir de ses chaussures qu’elle les jetterait par la fenêtre du train même si elle n’en avait pas d’autres. Avec une vieille chaussette, elle les avait pourtant fait briller autant que possible pour leur donner un aspect neuf malgré les traces de betterave mauves. Elle avait usé encore de crachats pour ne pas gaspiller le cirage, changé les lacets effilochés. Bientôt elle marcherait sur le quai d’une gare, dans les rues d’une ville inconnue, se tiendrait autrement au bras de Márieka, le cou dégagé. Elles seraient deux marcheuses de l’avant, éprises d’une légèreté qui claquerait au soleil.
Ensemble, les deux cousines avaient préparé des œufs durs, du pain, glissé à l’intérieur des miches des messages de chance griffonnés sur des bouts de papier roulés, choisi des pommes pas trop mûres, cassé des noix, saupoudré des petits fromages de paprika et de poivre. Les éternuements de Szonja s’étaient mêlés aux larmes de sa cousine pour lui revenir en rires soulevant son corps de spasmes nerveux. Un instant, elles s’étaient laissées aller, sans aucun mot à la bouche, à des grimaces mêlant peur contenue et excitation idiote.
Au moment de partir, Szonja avait regardé trembler ce qu’il y avait de plus réel dans sa petite vie, les branches nues du tilleul dans la cour dont l’ombre sèche passait et repassait sur leur grand-mère assise au milieu des volailles, les mains serrées autour de l’écuelle de maïs. La vieille dame avait levé les yeux vers elles. De ses lèvres s’écoulait une prière. Seule Szonja l’avait deviné.
Entre les arrêts du train pour recharger la locomotive en eau et charbon, une fatigue inexorable s’accumule, dans l’attente d’une escale plus longue. À Vienne, heureusement, les passagers ont pu arpenter les grands halls, acheter du pain frais, du lait, quelques crêpes, du tabac. Ils ont dû compter chaque pièce avec anxiété, prendre garde à réserver un peu d’argent pour les prochaines étapes. La plupart d’entre eux n’ont pas changé leur peu de monnaie hongroise. Pour les dernières escales en Suisse, en France, ils se contenteront d’aller aux toilettes, de respirer l’odeur métallique des gares.
Après deux jours de voyage, le train siffle longuement avant de s’arrêter au milieu de nulle part. Il faut habituer ses yeux aux fumées et vapeurs qui se mêlent au brouillard épais pour distinguer un semblant de gare et les toits d’une ville presque irréelle. Où sont-ils ? dans quel pays ? Les mécaniciens de la locomotive sautent sur le quai, affolés. Seuls le petit homme en gris et la traductrice sont autorisés à descendre pour s’informer : ils préviennent qu’on ne repartira pas avant plusieurs heures. Ils longent le train entier sous les fenêtres, répétant l’information et interdisant toute sortie. On détache la locomotive. L’opération secoue les premiers wagons et transmet l’onde d’inquiétude aux suivants jusqu’à l’extrémité perdue dans la brume.
Une nuée de corneilles afflue : de vieilles femmes tout en noir qui se précipitent et sortent de leurs cabas maintes choses à vendre. Leur haleine fume dans l’air glacé. Leurs mains qui semblent avoir été passées au brou de noix tendent à la portière et aux fenêtres des petits fromages, des chaussettes en tricot, des flacons d’eau-de-vie, des pommes. Après un bref marchandage, Szonja et Márieka en achètent quatre pour le prix de deux. Un géant passe ses gros bras à travers la vitre pour tirer à lui un sac entier. Il agite deux billets, demande encore trois fioles d’eau-de-vie. Des envieux regardent ses achats passer par les fenêtres, laissant entrer le froid. Szonja et Márieka ont l’impression de ne manger que des pommes depuis trois jours, ça lave les dents, ça fait briller nos bouches, mais une heure après, on a encore faim. Tant pis, elles s’en contenteront.
Toutes les vieilles s’agglutinent pour écouler le reste de leurs marchandises. Le monsieur gris essaie de les chasser en déclarant que, dans ce train à destination de la France, on n’a besoin de rien. Il crie presque À DESTINATION DE LA FRANCE. Mais dans ce convoi pour la France, on n’a prévu que l’eau et le pain, durci en moins d’une nuit.
Les pauvres femmes finissent par disparaître dans la brume, un fatras d’ailes sombres laissant derrière elles l’impression d’une halte dans une contrée hors du temps.
On ne sait plus si on attend le soleil ou la lune. Les va-et-vient reprennent dans les couloirs. Des soupirs de résignation gagnent tous les compartiments, que couvrent peu à peu les bruits d’allumettes qu’on craque pour une pipe, une cigarette, une lampe torche. Entre le froissement des pages tournées, missels ou journaux, le fil des bavardages las, des berceuses murmurées.
Le train repart enfin à la nuit tombée.
Les garçons qui ont remarqué Szonja repassent dans le couloir, insomniaques et nerveux. Szonja détourne la tête, baisse les yeux dans l’espoir qu’ils ne la reconnaissent pas, essaie de dormir un peu dans les bruits de papiers froissés, de mâchoires appliquées. Ils dévisagent toutes les jeunes filles, cherchent un peu de joie, en vain.
Márieka s’agite dans son sommeil, enfouit son visage dans son châle. Puis un à un s’éteignent les mouvements humains, le compartiment sombre dans le silence. Seule la plainte lancinante du train rythme la nuit. Szonja rêve qu’il s’arrête en plein champ. En quelle saison ? À quelle heure du jour ? Les wagons se vident en un instant. Une foule de femmes, d’hommes et d’enfants se répand dans l’herbe, sans bagage, sans chapeau ni manteau. Restée seule derrière la vitre du train, elle s’écrie « Revenez ! », mais personne ne l’entend.
Elle se réveille en sursaut. Tout le monde dort. Sauf une mère qui lange discrètement un bébé sur ses genoux. L’odeur des selles accroît le malaise de Szonja. La femme roule le linge souillé dans un vieux journal et, le temps de le porter dans le seau à déchets au bout du wagon, lui confie le petit. Elle caresse son crâne couvert d’un bonnet de coton, sa respiration lente lui fait du bien. Tous deux se laissent bercer jusqu’au retour de la mère. Les jeunes femmes échangent encore quelques signes. Une odeur de tabac s’échappe du couloir. L’aube est lente à venir. »
Extrait
« Szonja fixe des yeux les flottes de viscose, ces écheveaux visqueux; il lui faut rester attentive à la transformation de la matière souple jusqu’au débit du fil sans fin qu’elle tire avec les mêmes pensées. Elle se crée des rituels, imagine des choses pour oublier la fatigue, y fait un nœud mental à chaque heure écoulée de la matinée. Ensuite, elle oublie, puise dans la coulée des gestes répétitifs. Une mélancolie nouvelle s’étire alors tandis que la pluie s’abat sur la verrière. Elsa, à la sortie, la prend par le bras. » p. 46-47
À propos de l’auteur
 Paola Pigani © Photo Melania Avantazo
Paola Pigani © Photo Melania Avantazo
Paola Pigani est romancière et poète. Elle est l’auteure de trois romans remarqués, N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures (2013), Venus d’ailleurs (2015) et Des orties et des hommes (2019). (Source: Éditions Liana Levi)
Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)
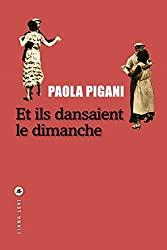


Tags
#etilsdansaientledimanche #PaolaPigani #editionslianalevi #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2021 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #MardiConseil #RentréeLittéraireaout2021 #rentreelitteraire #rentree2021 #RL2021 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #auteur #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #Bookstagram #Book #Bookobsessed #bookshelf #Booklover #Bookaddict

