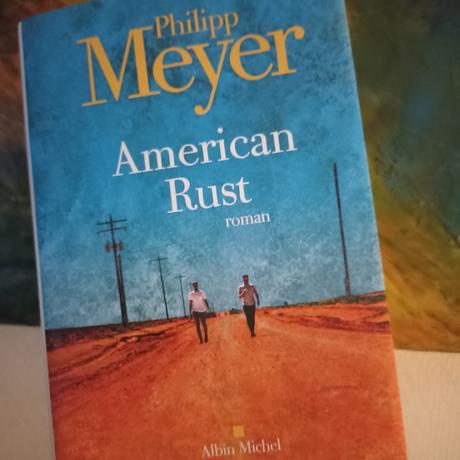
American Rust, Philipp Meyer, traduit de l’américain par Sarah Gurcel, 2021 pour cette édition chez Albin Michel, collection Terres d’Amérique, 483 pages.
Pourquoi ai-je mis autant de temps à ouvrir ce roman ? Il était gros, je me disais que je ne trouverais jamais le temps de le lire pleinement, à grandes goulées. J’avais peur de le picorer et de n’en pas gouter la véritable saveur. Et bien, je n’avais pas mesuré la capacité de ce livre à me tenir éveillée. Lorsqu’un roman nous tient dès les premières lignes, nous prenons le temps de nous installer pour entrer dans son monde. Nous peinons à le poser le soir (même si la fatigue se fait sentir) et nous nous réjouissons de le reprendre le matin ou le lendemain en fin d’après-midi. Il devient tellement attractif, que nous n’imaginons pas faire autre chose que de l’ouvrir pour voyager avec les personnages, pour les épauler, les écouter, leur tendre la main.
Ce roman, c’est l’histoire de deux jeunes hommes qui vont être confrontés à de graves difficultés. Un drame va faire basculer leur vie. Ils ne seront plus jamais les mêmes.
Isaac, a perdu sa mère, il vit seul avec son père invalide et il rêve de Californie. Il est brillant, atypique et peu enclin à lier des amitiés. Billy Poe vit avec sa mère dans un mobil-home, son père est toujours parti par monts et par vaux, il a été une star de l’équipe locale de football américain. Il est paumé.
Pour être sauvé, il faut partir. Comme l’a fait la sœur d’Isaac.
Dans cette Amérique malade, qui s’éteint dans ses coins les plus reculés, la misère, la violence, règnent en maître. Et c’est cette crise profonde que Phipp Meyer pointe avec talent.
« Tout ça formait un système complexe : quand les usines avaient fermé, c’est toute la vallée qui s’était effondrée. L’acier en était le cœur. Isaac se demanda combien de temps il faudrait à la rouille pour tout ronger, à la vallée pour retrouver son état sauvage. Seules resteraient les pierres.
Pendant un siècle, la vallée de la Monongahela River, que tout le monde appelait la Mon, avait été la plus grosse région productrice d’acier du pays, et même du monde en fait, mais le temps qu’Isaac et Poe grandissent, cent cinquante mille emplois avaient disparu et nombre de villes n’avaient plus les moyens d’assurer les services publics de base – la police, notamment. Comme la sœur d’Isaac avait dit à un ami de fac : La moitié des gens se sont tournés vers les services sociaux, les autres sont redevenus chasseurs-cueilleurs. »
La peinture de cette Amérique n’est pas nouvelle mais ce qui est passionnant dans ce roman, c’est le point de vue. Le lecteur suit les personnages et observent leurs façons de réagir, leurs interactions avec les autres, que ce soit en milieu fermé, ou en pleine errance sur les routes, la même insécurité règne, et on tremble pour ces deux jeunes, on s’attache à leurs basques, on ne veut pas les perdre, on a peur pour eux.
Et puis aux côtés de ces jeunes, il y a Harris, un flic au caractère complexe, ni tout blanc, ni tout noir, tout simplement humain et qui se questionne sur ce qu’il doit faire ou ne pas faire. Car tout est histoire de choix dans ce roman.
Les mauvais choix. Tous les personnages remettent en cause leurs décisions, l’un pense qu’il aurait dû se lever dans la nuit pour ne pas se faire dévaliser, l’autre qu’il n’aurait pas dû accepter de tabasser un maton… chacun porte le poids de ses propres erreurs et essaie de s’en sortir comme il peut.
Ce roman choral est excellent (je n’avais aucune envie de le terminer, je l’aurais bien poursuivi encore sur cinq cents pages) et chose incroyable, c’est le premier roman de Philipp Meyer qui nous offrira quelques années après Le fils. Hâte de découvrir un prochain roman…
Merci aux éditions Albin Michel qui m’ont fait parvenir ce livre il y a bien longtemps…