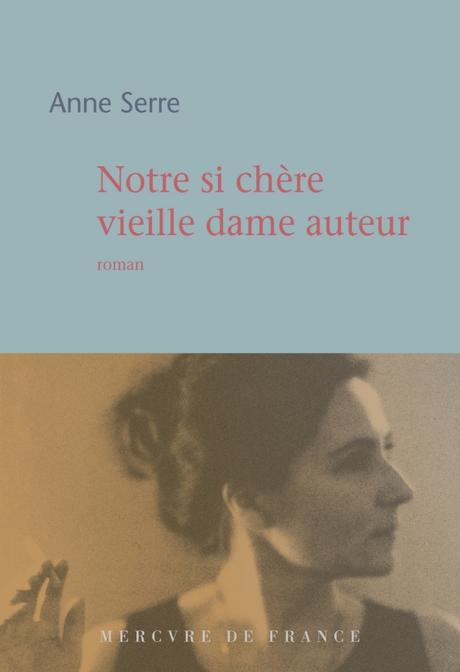
Finaliste du Prix Médicis 2022
En deux mots
Un réalisateur, un cameraman et une scripte se rend auprès d’une romancière mourante pour recueillir ses confidences et tenter de lire son dernier manuscrit. Mais la tâche s’annonce ardue, car il manque de nombreux passages.
Ma note
★★★ (bien aimé)
Ma chronique
La fabrique du roman
Autour d’une vieille dame auteur, Anne Serre joue avec le lecteur. Son court roman décortique avec finesse la façon dont l’écrivaine construit son histoire et ses personnages. Avant que ces derniers ne lui échappent.
Une vieille dame auteur, au crépuscule de sa vie, continue à s’amuser avec ses personnages. Elle ne laisse pas seulement un manuscrit, elle poursuit son dialogue avec Hans, le narrateur, sous le regard un peu circonspect de Holl, l’homme qui partage sa vie et doit bien laisser un peu de place à cet autre homme, même si pour l’instant il est dans son grenier, à regarder le paysage par un interstice.
Une équipe de tournage, réalisateur, cameraman et scripte s’invitent à ce moment pour recueillir le récit qu’elle laisse inachevé et ses confidences: «De la même manière qu’il m’est arrivé de penser qu’avec la seule force de mon désir je pourrais me retrouver réellement dans mon passé, j’ai parfois pensé qu’il ne tenait qu’à moi de faire sortir mon narrateur de son grenier et de l’entraîner sur les routes, en chair et en os, dans son costume gris démodé».
Alors le miracle du roman opère. Il entraîne le réalisateur-narrateur avec Jacques, le musicien-cameraman, et Édith, la scripte-tricoteuse et sculpteur, sur le chemin qu’a emprunté Hans, «sans s’étonner ni questionner davantage». Car ils entendent bien redonner au manuscrit son entièreté, combler les passages manquants. Un travail d’équipe qui va finir par payer.
Ensemble, ils vont revisiter l’enfance et la jeunesse de la vieille dame, les pages évoquant son père, l’homme de la Riviera dans son blazer froissé. Lui qui est parti trop tôt ne va cesser de jeter un regard bienveillant sur l’œuvre en cours. Ils retrouveront aussi Hans, qui les a longtemps tenus en haleine et dont ils n’apprendront finalement guère plus que les quelques mots lâchés au détour de son errance.
Dans ce court roman, Anne Serre explore avec malice l’acte créateur et nous propose de la suivre dans la fabrique du roman. Un jeu de miroirs assez fascinant, déroutant à souhait, qui permet à la romancière de jouer sur de nombreux registres simultanément, à la manière d’une organiste qui, à elle seule, joue une symphonie. Un peu comme si ce qu’elle faisait jusque-là livre après livre, en explorant le conte avec Petite table, sois mise! Le scénario avec Film, le théâtre avec Dialogue d’été ou le pastiche avec Voyage avec Vila-Matas était désormais rassemblé ici. Voilà comment Anne Serre est devenue virtuose!

Signalons le numéro d’octobre du Matricule des Anges qui fait sa Une avec Anne Serre à l’occasion de la parution de «Notre si chère vieille dame auteur». Et ses très justes mots de présentation : «en redoutable marionnettiste, l’écrivaine se joue des temporalités et des réalités qui nous entraîne loin dans la littérature.»
Notre si chère vieille dame auteur
Anne Serre
Éditions du Mercure de France
Roman
128 p., 14 €
EAN 9782715256538
Paru le 25/08/2022
Où?
Le roman est situé en France, dans le sud, à Thézan-lès-Béziers. On y évoque aussi Bordeaux et Fontainebleau ainsi que des voyages à New York, Milan, Venise, Vérone.
Quand?
L’action se déroule de nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Une vieille femme écrivain, donnée pour mourante, laisse un manuscrit inédit et désordonné avec des pages manquantes. Venus pour la filmer, un réalisateur, un cameraman et une scripte vont s’acharner à le reconstituer. Mais la vieille dame auteur n’est pas seule : il y a auprès d’elle la jeune femme qu’elle fut, un étrange personnage qui fut son père, un garçon à bonnet rouge qui fut son compagnon d’été, un certain Hans qui ne prononce jamais qu’une seule phrase…
À son habitude, Anne Serre livre ici un roman plein de chausse-trappes, aux allures de conte, sur l’enfance mystérieuse et l’écriture à l’œuvre. Chez elle, comme le disait W.G. Sebald de Robert Walser: «Le narrateur ne sait jamais très bien s’il se trouve au milieu de la rue ou au milieu d’une phrase.»
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Blog Partage lecture
Anne Serre présente Notre si chère vieille dame auteur © Production Librairie Mollat
Les premières pages du livre
« Le narrateur est assis sur une chaise, les pieds posés sur la barre supérieure, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains, un peu voûté donc, dans l’angle de ce qui apparaît être un grenier un peu sombre mais éclairé tout de même par une drôle de fente qui n’est pas une lucarne mais une sorte d’ouverture étroite, pareille à un cartouche ou à une meurtrière horizontale plutôt que verticale, par laquelle, Dieu soit loué, il peut considérer le paysage s’il en a envie. Et le paysage est ravissant. Il est tout à fait du genre de celui que pouvait voir Hölderlin de son grenier à lui chez le meunier : une vue champêtre, paisible, à la fois solennelle et exacte, faite d’arbres élégants, de petits troupeaux, de lignes vallonnées, de belle lumière et de quelques toits. Bravo au paysage. Le narrateur semble ruminer, réfléchir en tout cas, en dépit de sa posture un peu accablée, mais après tout, peut-être n’est-il pas si accablé, peut-être s’est-il simplement retiré dans son grenier pour avoir la paix, parce qu’il s’y sent bien – l’odeur du bois est agréable –, parce qu’il aime bien regarder par cette petite ouverture ? Il est vrai que c’est plus joli qu’au cinéma. Même moi qui suis à l’autre bout du grenier – assez vaste –, regardant tour à tour le narrateur assis de profil et cette ouverture lumineuse comme une espérance, je me sens heureuse et tranquille dans cette situation.
Normalement, on ne peut pas s’approcher aussi près d’un narrateur. Ce n’est pas que c’est interdit ou tabou ; c’est plutôt que cela ne se fait pas. C’est presque inconvenant. Mais nous en sommes arrivés à une telle situation, lui et moi, que l’inconvenance n’est plus un obstacle valable. Il ne tourne pas les yeux vers moi même s’il sait parfaitement que je suis là. De mon côté, je me sens avec lui comme on peut se sentir avec un être imaginaire ou un fantôme, ou une présence sauvage qui pourrait aussi bien bondir et vous assassiner, mais curieusement, alors que je suis assez peureuse d’ordinaire, je n’ai absolument pas peur de lui. Enfin nous y voilà ! lui dis-je en chuchotant. Cela fait tant de temps que je souhaitais te retrouver. Je n’arrivais pas à mettre la main sur toi. Où que je me tourne, tu n’étais pas. Tu semblais avoir déserté. Et te voilà à ton poste, dans ce grenier, regardant par cette fente lumineuse ce qui peut bien se passer dans le paysage.
Il porte ce costume gris un peu défraîchi et démodé que je lui ai toujours connu. C’est un narrateur assez élégant, au fond. S’il avait porté des baskets et un tee-shirt je me serais sentie mal à l’aise car il aurait ressemblé à une personne réelle. Son genre de costume me fait penser qu’il vient forcément du passé, d’un passé pas si lointain d’ailleurs, début vingtième siècle, je dirais. Après-guerre ? Avant-guerre ? Hors la guerre. Il n’a pas connu la guerre. Je crois même qu’il ne sait pas ce que c’est. C’est peut-être parce qu’il a toujours vécu au fin fond de la campagne. Il me donne l’impression – pas uniquement maintenant, c’est toujours ainsi que je l’ai vu – de n’avoir contemplé que des toits, des arbres, des silhouettes. On a l’impression aussi qu’il n’a pas été engendré. Supposer une mère ou un père, ou une mère et un père au narrateur, c’est difficile. Ou alors dans son enfance, lorsqu’il était petit et promis à son destin de narrateur comme des enfants tibétains sont promis au rôle de Rinpoché. En tout cas il est seul, isolé dans le monde mais sans en souffrir du tout ; c’est son statut. Je ne me suis jamais vraiment posé la question de sa virginité. A-t-il connu ou connaît-il parfois le contact charnel avec un ou une autre ? Il se peut que le narrateur ait un double, un triple fond. Déjà, son existence et sa présence sont bien mystérieuses, mais comme avec le cosmos, les planètes et les univers, on peut imaginer qu’au-delà de ce que l’on voit et perçoit, il y a une vie enténébrée du narrateur à des millions d’années-lumière. On pourrait d’ailleurs dire cela d’à peu près tout le monde, non ?
Moi-même, je dois être un drôle de corps pour me sentir si bien avec lui, en sa présence. Attention : je peux me sentir bien avec d’autres êtres, vivants, gentils et doux. Et d’ailleurs je ne pourrais pas me contenter de ma relation avec le narrateur. Si je n’avais que celle-là, me manqueraient mille autres choses : il faut bien que je vive. Car avec lui, on ne vit pas, on est ailleurs, on est dans un temps suspendu, éternel, comme si tout s’était arrêté. J’ai un attrait que je pourrais qualifier d’érotique pour ce temps suspendu, arrêté, car c’est celui de la plus grande félicité de mon âme, de mon esprit, et presque de mon corps. Je me rappelle un ami qui me disait fort justement qu’au fond, dans l’existence, on fait mille choses, mais que la seule chose qu’on attend, c’est de faire l’amour, et que tout le reste est en quelque sorte du remplissage dans l’attente de ce moment. De mon côté, je pourrais dire cela de ma rencontre avec le narrateur. Tout le reste est du remplissage, parfois bien agréable, mais dans l’attente de cette rencontre muette dans le grenier ou ailleurs – parfois c’est ailleurs. Enfin, pas si muette cette rencontre, même si l’on ne parle pas, car alors passent des courants d’une force et d’une fluidité peu communes entre lui et moi. Je pourrais même dire que c’est là la vraie conversation.
Nous allons donc demeurer ensemble quelque temps, lui et moi. Je jette un œil dans le grenier où à vrai dire il n’y a pas grand-chose. J’ai connu un grenier de ce genre dans mon enfance, dans la maison de vacances de mes grands-parents maternels à Thézan-lès-Béziers. C’était une drôle de maison qu’on n’ouvrait qu’en juillet et qui restait fermée tout le restant de l’année, aussi, quand nous y arrivions, le premier soin de mon père était-il de s’armer d’un balai et de se rendre sur la terrasse que surmontait l’énorme tête d’un tilleul planté plus bas, pour en repousser et chasser l’amas de feuilles qui s’y étaient accumulées depuis un an, parmi lesquelles circulaient peut-être des scorpions. La pièce à vivre, les chambres et la terrasse étaient au premier. Au second, il y avait un grand grenier vide auquel, j’ignore pourquoi, nous n’avions pas accès. On pouvait cependant en entrouvrir la porte et considérer ce grand grenier entièrement vide, mais il n’était pas question d’y jouer et encore moins de s’y installer. Le grenier de mon narrateur n’est pas aussi vide que celui de Thézan-lès-Béziers, et d’abord, il est plus petit, plus sombre, plus bas de plafond ou plutôt de combles. Il y a bien quelques meubles ou caisses dans un coin et un autre. Par son plancher disjoint, on peut, non pas distinguer le jour, mais parfaitement entendre les sons de la pièce au-dessous.
Je regarde si c’est ce qu’il écoute, mais non, il n’écoute pas ou guère. Ce qu’il fait surtout et même exclusivement, semble-t-il, c’est regarder par la fente lumineuse, et encore, pas tout le temps, pas comme un guetteur, non, plutôt comme quelqu’un qui vérifierait quelque chose en jetant des coups d’œil, ou que le spectacle de la nature aiderait à rêver. Je regarde avec lui, mais située plus loin de l’ouverture puisque je suis à l’autre bout du grenier, ce qui fait que de mon côté j’en suis quasiment réduite à ne voir qu’une fente lumineuse, tandis que lui, très bien situé par rapport à cette ouverture, peut distinguer les innombrables détails sans cesse changeants du paysage.
(…) (manque ici, dans le manuscrit, une dizaine de pages, que l’auteur du texte, interviewée sur son lit de mort, résuma ainsi) :
Si je me souviens bien – mais il est si loin, ce texte –, suite à la phrase précédente, la narratrice raconte qu’elle essaie de se mettre à la place du narrateur pour imaginer ce qu’il voit. Elle dit : je joue à être lui. Puis elle dit qu’au premier plan il voit des arbres grands et beaux, une grange auprès de laquelle un homme s’affaire avec des vaches, et un peu plus loin un troupeau de boucs « aux poils jaunes et aux cornes extraordinaires » qu’elle décrit entre autres comme « pyramidales ». Puis elle dit que ce troupeau semble sortir du Parnasse, de la mythologie antique, et qu’elle le voit comme un signe, probablement le signe qu’elle va se mettre à raconter une histoire. Mais elle précise qu’elle ne veut pas trop interpréter car elle ne veut pas « délirer comme Strindberg ». Mais il est clair que ce troupeau n’a rien à faire là : « Dans cette région il y a peu de moutons et de chèvres, plutôt des vaches, des chevaux et des ânes », dit-elle. Ensuite, elle dit qu’elle l’a remarqué en arrivant au village (avant de monter dans la maison et d’accéder au grenier), et elle raconte comment elle est partie, le matin, de son village à elle, à pied, pour venir à celui-ci, parce qu’elle s’était rappelée qu’elle s’y était promenée avec son père lorsqu’elle avait vingt ans et que ce souvenir pourtant un peu flou était celui d’une grande joie. Elle raconte comment elle a quitté sa maison le matin, en annonçant à Holl (son compagnon ?), qui semble y passer l’été avec elle (elle précise que c’est sa maison d’été), qu’elle partait se promener. Holl lui recommande de rentrer « avant la nuit tombée ». Elle emporte un sandwich et une petite bouteille d’eau et elle dit qu’elle ne prend jamais de téléphone quand elle part ainsi vagabonder, car elle en a assez d’être toujours « joignable », et que si elle avait toujours été « joignable » et avait toujours pu joindre les gens, elle ne serait jamais devenue écrivain. Elle dit enfin – je résume, je résume, il y avait bien dix pages déjà écrites et vraiment écrites – qu’il y a douze kilomètres entre sa maison d’été sur un plateau et le village où elle veut se rendre, appelée par son souvenir. Que du plateau elle doit descendre dans une vallée si profonde qu’elle est noire vue d’en haut, puis monter sur l’autre versant, marcher sur les crêtes, avant d’apercevoir au loin le village. Elle dit aussi – mais c’est avant, je m’en souviens maintenant – que le paysage vu de son plateau est magnifique, avec d’un côté une barrière de montagnes massives et bleues d’où l’on voit s’envoler des deltaplanes et des parapentes, et que de chaque côté du sentier où elle marche – toujours sur son plateau – il y a de hautes fleurs jaunes raides, des chevaux qui se baignent dans des étangs, « et c’est à peu près tout ». Je ne me rappelle plus à quel temps des verbes elle parle, dit la vieille dame auteur sur son lit de mort, mais il me semble qu’à ce moment-là du récit, c’est au passé composé, du type : j’ai traversé le plateau, je me suis dit que, j’ai pensé que. Mettez ce temps-là, dit la vieille dame, bien sûr ce ne sera plus le texte, ce ne sera pas le texte qui était vraiment écrit et qui commençait, je me rappelle, à vraiment me porter. On devait en être vers la page douze à peu près, le roman commençait vraiment. Je pensais très vaguement à Lenz de Büchner, dit la vieille dame, mais vraiment vaguement (et elle rit un peu) car je n’avais plus le moindre souvenir exact de Lenz, mais juste un souvenir très vague, vague exactement comme celui de ma promenade avec mon père dans ce village que j’avais décidé d’aller revisiter : souvenir vague d’une joie profonde. Là, la vieille dame se met à fermer les paupières, qu’elle a bombées et translucides. Madame la vieille dame, lui dis-je – moi qui l’interroge en qualité de réalisateur/interviewer –, désormais vous êtes entrée dans votre roman avec cette interview que nous faisons de vous, je vous en prie ne mourez pas tout de suite car cela est intéressant, cela apporte quelque chose au livre dont nous aurions été déçus qu’il ressemble trop au Lenz de Büchner. Madame la vieille dame, please, réveillez-vous, un peu de vie encore, et même beaucoup de vie : nous voulons reconstituer cette histoire, il faut absolument que vous nous assistiez.
Je vous ai tout dit ou à peu près pour ce passage manquant, dit la vieille dame, les yeux toujours fermés mais paraissant moins morte. Reprenez là où vous retrouverez du texte, et s’il manque quelque chose, interrogez-moi à nouveau. J’ai beau être mourante, mes textes me sont encore assez présents à l’esprit. Il me semble que juste après les dix, douze pages disparues, la narratrice disait quelque chose de la sécurité qu’il y avait à se promener, même seule, même nuitamment, dans ce paysage de plateaux, de montagnes, de vallées. Poursuivez, mes amis, et là où cela manquera, faites appel à moi. Je ne suis pas encore passée dans l’autre monde.
(Suite du texte trouvé dans un fichier intitulé « roman » dans l’ordinateur de l’auteur) :
(…) il semble que dans ce pays on ne haïsse point. Ce qui est étrange, car dans les fermes et maisons isolées il doit bien y avoir des ressentiments, des désirs de vengeance, de l’envie et des folies rôdeuses. Je me sentais toujours un peu coupable de laisser Holl derrière moi quand j’allais à la rencontre du narrateur. C’était comme le tromper d’une certaine manière, ou du moins être traître. Je passais ma vie à persuader Holl que je l’aimais – ce qui était vrai –, mais au moindre appel du narrateur j’étais capable de quitter Holl pour lui. Holl eût-il été à la dernière extrémité et le narrateur m’eût-il appelée, y serais-je allée ? Oui. Mais Holl le savait. Il me connaissait par cœur. L’appel du narrateur, c’était la flûte d’Hamelin, il n’y avait vraiment rien à faire, c’était ce qu’il y avait de plus fort au monde. Tout d’un coup mon œil se plissait, mon corps rajeunissait, et je partais, quoi qu’il se passe dans ma vie, pour le rejoindre et jouer avec lui une mystérieuse partie de cartes.
Je ne vais pas ici raconter mon trajet du plateau au village, car je l’ai déjà fait trente-six fois dans d’autres livres et maintenant j’en ai un peu assez. Et puis c’est fait. Revenons au grenier, où, comme je l’ai dit, je me trouve en compagnie du narrateur assis sur une petite chaise, de profil, dans son costume gris. Cette chaise est curieuse, d’ailleurs, je ne cesse de l’examiner pour trouver ce qu’elle a de bizarre, voilà, j’y suis : si l’on veut, on peut la déplier et alors elle forme un escabeau. Il y avait des chaises de ce genre autrefois. Et dans ce grenier, enfin c’est la paix. Ce n’est pas que ma vie soit particulièrement agitée mais il y a tout de même toujours trop de bruit, de rumeurs, de voix, de choses à faire et à prévoir pour l’avenir. Avec Hans (j’ai décidé d’appeler le narrateur Hans, pour ne pas répéter cent fois le mot « narrateur »), nous vivons dans un silence traversé de mille voix, mille rires, mille murmures silencieux qui s’enchevêtrent, forment des réseaux légers et transparents comme les toiles d’araignée éclairées par le jour. Ce qui est drôle, c’est qu’il observe le dehors et que je l’observe observant. On dirait un tableau. Je vois par exemple qu’il porte des chaussettes rouges, comme dans les tableaux de Corot où il y a toujours quelqu’un de minuscule dans un grand paysage vert, jaune et brun portant un bonnet rouge. À peine est-ce un bonnet, d’ailleurs. C’est comme un point final, une signature. J’ai toujours pensé – mais il faudrait que je vérifie cela auprès de critiques d’art – que Corot posait ce point rouge à la fin de son tableau, une fois que tout le reste était en place et peint à l’extrême, à l’extrême de ce qu’il pouvait faire et qui était assez prodigieux. Sans le point rouge, avais-je pensé, le tableau n’aurait pas été fini, il aurait même été beaucoup moins beau. On se serait dit, oui, c’est une très belle toile mais il manque quelque chose pour que cette toile soit vraiment un chef-d’œuvre. Il posait le point rouge – coquelicot parfois, vermillon – et c’était fait, c’était un chef-d’œuvre. Je me suis demandé pourquoi Hans avait des chaussettes rouges dans ce grenier gris, blond puis brun par endroits, et j’ai pensé que c’était quelque chose qui avait à voir avec Corot.
Quand nous sommes ainsi réunis silencieusement et longuement, lui et moi, il y a toujours une femme pour se charger de nous apporter quelque chose à manger, à boire, faire un brin de ménage. C’est une vieille femme pas bavarde elle non plus, je suis toujours un peu gênée qu’elle ait à monter l’escalier pour nous, mais il semble que les choses soient réparties ainsi et lorsque l’organisation des choses vient du ciel, il serait non seulement idiot de vouloir les changer, mais sacrilège. L’histoire se forme tandis que Hans observe au-dehors et que je l’observe observant. De temps en temps tout de même, il tourne la tête et pose une question, le plus souvent inattendue. Comment se porte Holl ? m’a-t-il demandé ce matin. Il va bien, ai-je répondu en me balançant doucement dans mon rocking-chair. Il s’occupe de notre maison d’été sur le plateau, il adore aller se promener sur le sentier et regarder les vaches, les chevaux qui se baignent, puis il rentre et lit longuement. Il y a peu, ai-je dit à Hans, nous nous sommes disputés un soir et violemment, Holl et moi. Il prétendait que dans certaines circonstances, je le manipulais, et c’était cette idée de manipulation qui le mettait hors de lui. Hans n’a pas tourné la tête, mais je pense qu’en regardant par la fente lumineuse il avait cette information en tête et que cette information ajoutait quelque chose à sa manière de regarder.
Parfois, il éclate de rire, d’un rire franc, très frais, et j’aime beaucoup cela. Je me lève alors et je m’approche de lui très près, un peu trop près, et je regarde par l’ouverture sur la campagne ce qui a bien pu l’amuser autant. Je ne vois que des branches admirables, si élégantes (ah, si les êtres pouvaient être élégants comme des branches !), des prés, de la lumière, de petits mouvements au loin. Je crois que c’est sa Joie qui le fait rire, il ne rit que de ça, de toute cette joie dans son corps discret revêtu de gris et de chaussettes rouges, assis dans un grenier à guetter une toute petite partie du monde. »
Extraits
« De la même manière qu’il m’est arrivé de penser qu’avec la seule force de mon désir je pourrais me retrouver réellement dans mon passé, j’ai parfois pensé qu’il ne tenait qu’à moi de faire sortir mon narrateur de son grenier et de l’entraîner sur les routes, en chair et en os, dans son costume gris démodé.» p. 33-34
« Nous avons donc avancé dans le chemin, Jacques, Édith et moi, à la recherche de Hans enfui ou jouant avec nous. Que, moi, je suive un narrateur en cavale, sois capable de passer mon été, mon automne, mon hiver à faire cela, que je m’accroche aux derniers mots d’une vieille dame auteur moribonde pour tenter de combler les trous et pages manquantes de l’un de ses manuscrits, c’est une manière de vivre absurde et particulière, mais c’est la mienne. Mais que des gens comme Jacques, musicien-cameraman, et Édith, scripte-tricoteuse et sculpteur, prennent ce chemin avec moi sans s’étonner ni questionner davantage, c’est presque plus intéressant. Et cela me fit penser à mon père qui était fait ainsi: il ne s’intéressait guère aux narrateurs de roman — croyait-il —, il aimait les romans pour s’y fondre comme dans un paysage, et pourtant, à chaque fois que je m’éprenais d’une œuvre, de son auteur, que mes yeux devenaient soudain écarquillés, mon énergie décuplée, il se mettait à mon service aussitôt, très désireux d’ôter de ma route tout obstacle. » p. 52
« Ma chère Marie, ce fut une bonne soirée. Nous y étions tous, personne n’a manqué à l’appel. Il y avait ma jeunesse, mon enfance, mon père parti trop tôt qui était là dans son blazer froissé. Hans, comme d’habitude, nous a tenus en haleine sans nous donner grand-chose mais comme nous étions heureux de le voir, dos à nous, regarder par la fenêtre dans ce costume gris un peu clérical qui nous plaît toujours tant! » p. 90
À propos de l’auteur
 Anne Serre © Photo Francesca Mantovani
Anne Serre © Photo Francesca Mantovani
Née à Bordeaux en 1960, installée à Paris depuis ses études, Anne Serre est l’auteur d’une quinzaine de romans et de nombreux textes (surtout des nouvelles) parus en revue. Elle a d’ailleurs commencé par publier dans diverses revues avant de publier son premier roman, Les Gouvernantes (Champ Vallon, 1992). Souvent décrits comme appartenant au genre du « réalisme magique », ses romans ont été jugés aussi comme « jouant avec les limites des genres littéraires »: celles du conte avec Petite table, sois mise! (Verdier, 2012), du scénario avec Film (Le Temps qu’il fait, 1998), du théâtre avec Dialogue d’été (Mercure de France, 2014), ou du pastiche avec Voyage avec Vila-Matas (Mercure de France, 2017). Plusieurs de ses livres ont été couronnés par des prix, dont un prix de la Fondation Cino Del Duca (pour Un chapeau léopard, en 2008). Elle a reçu le Prix des étudiants du Sud, en 2009, pour l’ensemble de son œuvre, et le Prix Goncourt de la nouvelle, en mai 2020, pour Au cœur d’un été tout en or. Traduits aux Etats-Unis, en Angleterre, en Espagne et en Allemagne, ses livres sont en cours de traduction en Corée et en Hollande. (Source: anneserre.fr/)
Site internet de l’auteur
Page Wikipédia de l’auteur


Tags
#notresicherevieilledameauteur #AnneSerre #editionsduMercuredeFrance #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2022 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #RentreeLitteraire22 #rentreelitteraire #rentree2022 #RL2022 #GoncourtdesDétenus #RentreeLitteraire22 #livre #lecture #books #blog #littérature #autrices #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #passionlecture #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots

